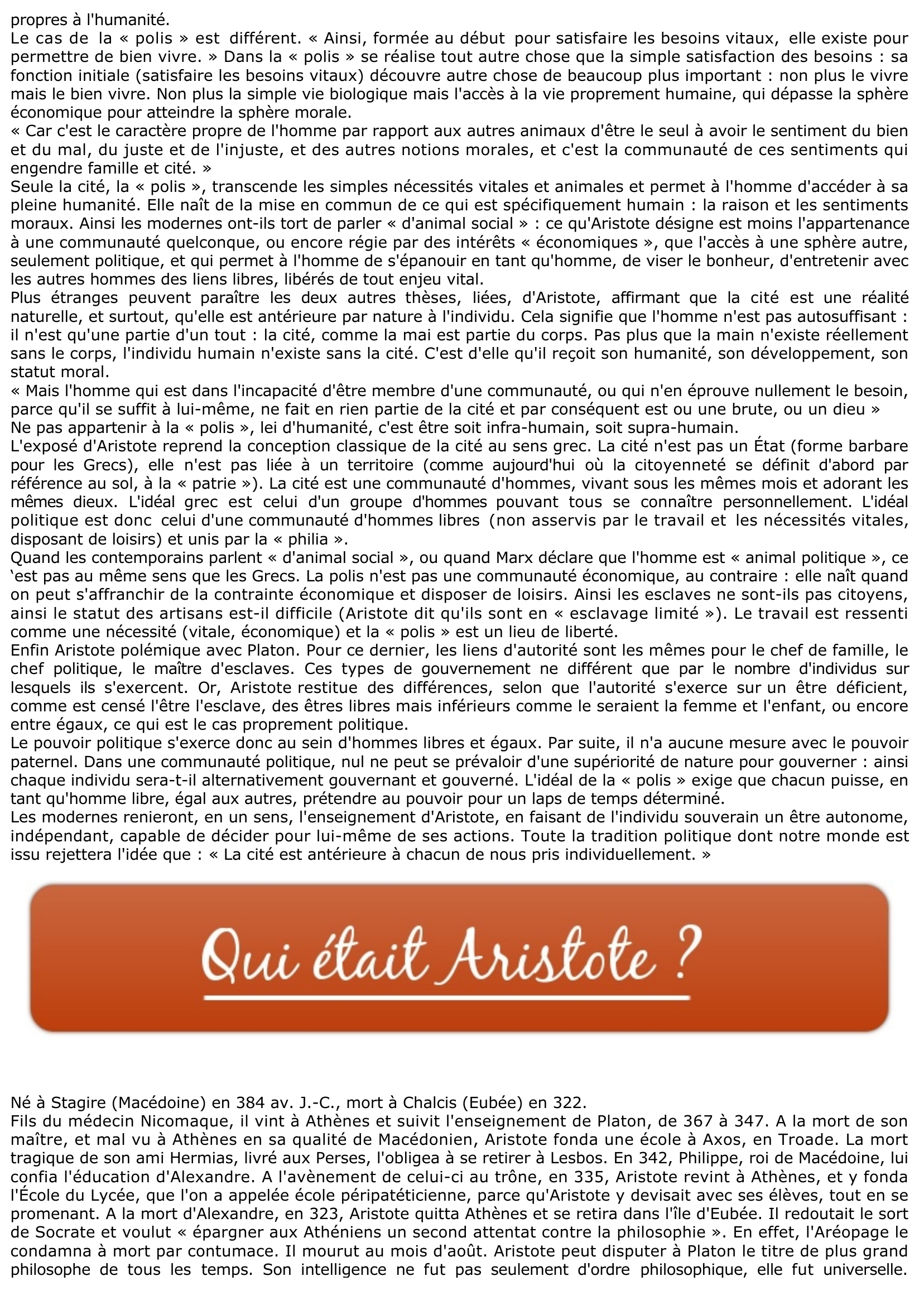Aristote et la citée
Publié le 14/04/2005

Extrait du document

HTML clipboard Aristote développe dans la Politique sa conception de la société. il donne à l'État une place essentielle, le considérant comme la forme achevée de la vie sociale. Certes, il est précédé par le clan et la famille, mais qui à ses yeux sont des formes moins élaborées, beaucoup plus dépendantes de la nature. Problématique Aristote expose les raisons qui le conduisent à penser que l'homme est un animal politique. Il se demande ce qui justifie que l'homme vive en société. Est-ce parce qu'il dispose d'une nature différente des autres êtres vivants ? Enjeux En fait, l'homme n'est pas le seul être vivant à vivre en société mais il est le seul à avoir inventé la vie politique. Si les animaux disposent de la voix, ils ne parlent pas. Ce qu'ils expriment dépend directement de leurs sensations. Seul l'homme est capable de distinguer le juste et l'injuste, de donner une valeur à la vie. La vie humaine revêt donc une autre dimension que la vie animale, parce que l'homme se reconnaît dans un ordre social.

«
propres à l'humanité.Le cas de la « polis » est différent.
« Ainsi, formée au début pour satisfaire les besoins vitaux, elle existe pourpermettre de bien vivre.
» Dans la « polis » se réalise tout autre chose que la simple satisfaction des besoins : safonction initiale (satisfaire les besoins vitaux) découvre autre chose de beaucoup plus important : non plus le vivremais le bien vivre.
Non plus la simple vie biologique mais l'accès à la vie proprement humaine, qui dépasse la sphèreéconomique pour atteindre la sphère morale.« Car c'est le caractère propre de l'homme par rapport aux autres animaux d'être le seul à avoir le sentiment du bienet du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions morales, et c'est la communauté de ces sentiments quiengendre famille et cité.
»Seule la cité, la « polis », transcende les simples nécessités vitales et animales et permet à l'homme d'accéder à sapleine humanité.
Elle naît de la mise en commun de ce qui est spécifiquement humain : la raison et les sentimentsmoraux.
Ainsi les modernes ont-ils tort de parler « d'animal social » : ce qu'Aristote désigne est moins l'appartenanceà une communauté quelconque, ou encore régie par des intérêts « économiques », que l'accès à une sphère autre,seulement politique, et qui permet à l'homme de s'épanouir en tant qu'homme, de viser le bonheur, d'entretenir avecles autres hommes des liens libres, libérés de tout enjeu vital.Plus étranges peuvent paraître les deux autres thèses, liées, d'Aristote, affirmant que la cité est une réaliténaturelle, et surtout, qu'elle est antérieure par nature à l'individu.
Cela signifie que l'homme n'est pas autosuffisant :il n'est qu'une partie d'un tout : la cité, comme la mai est partie du corps.
Pas plus que la main n'existe réellementsans le corps, l'individu humain n'existe sans la cité.
C'est d'elle qu'il reçoit son humanité, son développement, sonstatut moral.« Mais l'homme qui est dans l'incapacité d'être membre d'une communauté, ou qui n'en éprouve nullement le besoin,parce qu'il se suffit à lui-même, ne fait en rien partie de la cité et par conséquent est ou une brute, ou un dieu »Ne pas appartenir à la « polis », lei d'humanité, c'est être soit infra-humain, soit supra-humain.L'exposé d'Aristote reprend la conception classique de la cité au sens grec.
La cité n'est pas un État (forme barbarepour les Grecs), elle n'est pas liée à un territoire (comme aujourd'hui où la citoyenneté se définit d'abord parréférence au sol, à la « patrie »).
La cité est une communauté d'hommes, vivant sous les mêmes mois et adorant lesmêmes dieux.
L'idéal grec est celui d'un groupe d'hommes pouvant tous se connaître personnellement.
L'idéalpolitique est donc celui d'une communauté d'hommes libres (non asservis par le travail et les nécessités vitales,disposant de loisirs) et unis par la « philia ».Quand les contemporains parlent « d'animal social », ou quand Marx déclare que l'homme est « animal politique », ce‘est pas au même sens que les Grecs.
La polis n'est pas une communauté économique, au contraire : elle naît quandon peut s'affranchir de la contrainte économique et disposer de loisirs.
Ainsi les esclaves ne sont-ils pas citoyens,ainsi le statut des artisans est-il difficile (Aristote dit qu'ils sont en « esclavage limité »).
Le travail est ressenticomme une nécessité (vitale, économique) et la « polis » est un lieu de liberté.Enfin Aristote polémique avec Platon.
Pour ce dernier, les liens d'autorité sont les mêmes pour le chef de famille, lechef politique, le maître d'esclaves.
Ces types de gouvernement ne différent que par le nombre d'individus surlesquels ils s'exercent.
Or, Aristote restitue des différences, selon que l'autorité s'exerce sur un être déficient,comme est censé l'être l'esclave, des êtres libres mais inférieurs comme le seraient la femme et l'enfant, ou encoreentre égaux, ce qui est le cas proprement politique.Le pouvoir politique s'exerce donc au sein d'hommes libres et égaux.
Par suite, il n'a aucune mesure avec le pouvoirpaternel.
Dans une communauté politique, nul ne peut se prévaloir d'une supériorité de nature pour gouverner : ainsichaque individu sera-t-il alternativement gouvernant et gouverné.
L'idéal de la « polis » exige que chacun puisse, entant qu'homme libre, égal aux autres, prétendre au pouvoir pour un laps de temps déterminé.Les modernes renieront, en un sens, l'enseignement d'Aristote, en faisant de l'individu souverain un être autonome,indépendant, capable de décider pour lui-même de ses actions.
Toute la tradition politique dont notre monde estissu rejettera l'idée que : « La cité est antérieure à chacun de nous pris individuellement.
»
Né à Stagire (Macédoine) en 384 av.
J.-C., mort à Chalcis (Eubée) en 322.Fils du médecin Nicomaque, il vint à Athènes et suivit l'enseignement de Platon, de 367 à 347.
A la mort de sonmaître, et mal vu à Athènes en sa qualité de Macédonien, Aristote fonda une école à Axos, en Troade.
La morttragique de son ami Hermias, livré aux Perses, l'obligea à se retirer à Lesbos.
En 342, Philippe, roi de Macédoine, luiconfia l'éducation d'Alexandre.
A l'avènement de celui-ci au trône, en 335, Aristote revint à Athènes, et y fondal'École du Lycée, que l'on a appelée école péripatéticienne, parce qu'Aristote y devisait avec ses élèves, tout en sepromenant.
A la mort d'Alexandre, en 323, Aristote quitta Athènes et se retira dans l'île d'Eubée.
Il redoutait le sortde Socrate et voulut « épargner aux Athéniens un second attentat contre la philosophie ».
En effet, l'Aréopage lecondamna à mort par contumace.
Il mourut au mois d'août.
Aristote peut disputer à Platon le titre de plus grandphilosophe de tous les temps.
Son intelligence ne fut pas seulement d'ordre philosophique, elle fut universelle..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Qui peut le plus peut le moins » ARISTOTE
- « L’amitié est une âme en deux corps » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- « Il n’y a point de génie sans un grain de folie » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- Méthode expérimentale; CHAPITRE 2 ARISTOTE : LOGIQUE ET RHÉTORIQUE
- commentaire Aristote Métaphysique