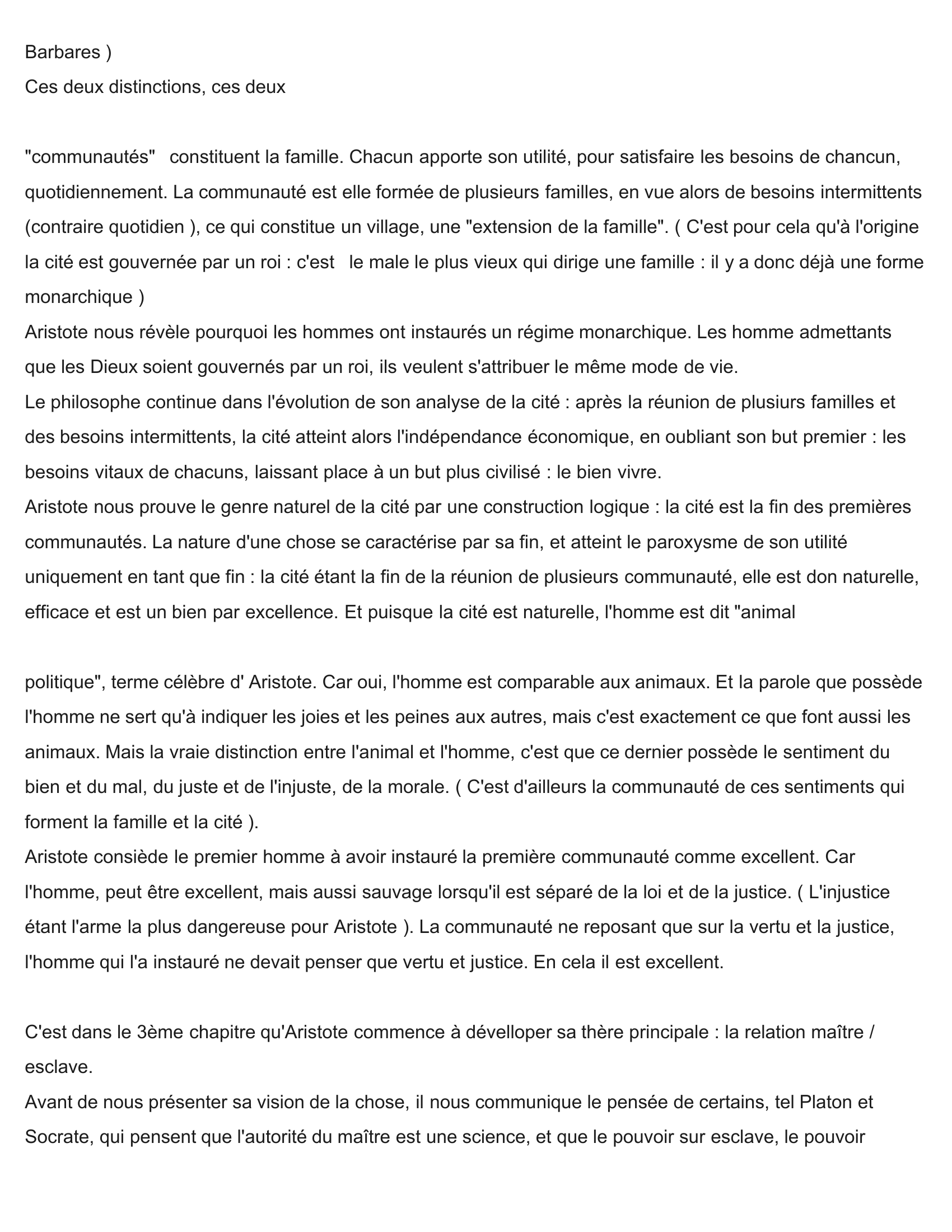Aristote et le rapport Maître / Esclave
Publié le 05/11/2012

Extrait du document

Aristote en vient à l'aspect physique des esclaves, qui sont reconnaissables : ils sont vigoureux,
contrairement aux libres, qui sont comme une "station droite" ( expression d'Aristote ) ils ne sont pas aptes à
effectuer le travail d'un esclave. Mais parfois, Aristote ne dit pas le contraire, la nature ne fait pas la
différence, il peut y avoir l'âme d'un homme libre dans un corps d'esclave et inversement. On se base
généralement sur le physique de la personne, alors qu'on peut tout aussi se baser sur l'âme de cette
dernière. Même si cela est une entreprise plus difficile, on ne constate pas immdiatement la beauté d'une
âme.
Nous constatons dans le chapitre 6 que la position d'Aristote est nuancée à propos de la légitimité de
l'esclavage. Il reste sur sa position en affirmant que l'esclavage par nature est salutaire et légitime, mais ne
va pas à l'encontre de ceux qui pensent que l'esclavage dû à une loi ou à un droit de guerre est injuste. On
ne peux réduire en esclave un homme naturellement libre après guerre apr le vainqueur. C'est une
"exception d'illegalité".

«
Barbares )
Ces deux distinctions, ces deux
"communautés" constituent la famille.
Chacun apporte son utilité, pour satisfaire les besoins de chancun,
quotidiennement.
La communauté est elle formée de plusieurs familles, en vue alors de besoins intermittents
(contraire quotidien ), ce qui constitue un village, une "extension de la famille".
( C'est pour cela qu'à l'origine
la cité est gouvernée par un roi : c'est le male le plus vieux qui dirige une famille : il y a donc déjà une forme
monarchique )
Aristote nous révèle pourquoi les hommes ont instaurés un régime monarchique.
Les homme admettants
que les Dieux soient gouvernés par un roi, ils veulent s'attribuer le même mode de vie.
Le philosophe continue dans l'évolution de son analyse de la cité : après la réunion de plusiurs familles et
des besoins intermittents, la cité atteint alors l'indépendance économique, en oubliant son but premier : les
besoins vitaux de chacuns, laissant place à un but plus civilisé : le bien vivre.
Aristote nous prouve le genre naturel de la cité par une construction logique : la cité est la fin des premières
communautés.
La nature d'une chose se caractérise par sa fin, et atteint le paroxysme de son utilité
uniquement en tant que fin : la cité étant la fin de la réunion de plusieurs communauté, elle est don naturelle,
efficace et est un bien par excellence.
Et puisque la cité est naturelle, l'homme est dit "animal
politique", terme célèbre d' Aristote.
Car oui, l'homme est comparable aux animaux.
Et la parole que possède
l'homme ne sert qu'à indiquer les joies et les peines aux autres, mais c'est exactement ce que font aussi les
animaux.
Mais la vraie distinction entre l'animal et l'homme, c'est que ce dernier possède le sentiment du
bien et du mal, du juste et de l'injuste, de la morale.
( C'est d'ailleurs la communauté de ces sentiments qui
forment la famille et la cité ).
Aristote consiède le premier homme à avoir instauré la première communauté comme excellent.
Car
l'homme, peut être excellent, mais aussi sauvage lorsqu'il est séparé de la loi et de la justice.
( L'injustice
étant l'arme la plus dangereuse pour Aristote ).
La communauté ne reposant que sur la vertu et la justice,
l'homme qui l'a instauré ne devait penser que vertu et justice.
En cela il est excellent.
C'est dans le 3ème chapitre qu'Aristote commence à dévelloper sa thère principale : la relation maître /
esclave.
Avant de nous présenter sa vision de la chose, il nous communique le pensée de certains, tel Platon et
Socrate, qui pensent que l'autorité du maître est une science, et que le pouvoir sur esclave, le pouvoir.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Aristote - La politique: Maître et Esclave
- « L'être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir, est par nature un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par sa nature même un subordonné et un esclave : de là vient que l'intérêt du maître et celui de l'esclave se confondent. » Aristote, La Politique, Ive s. av. J.-C. Commentez cette citation.
- Aristote, Éthique à Nicomaque: communauté de rapport entre deux médecins
- Phénoménologie de l'esprit Georg Hegel Dialectique du maître et de l'esclave D'abord, la
- Epictète par Victor Goldschmidt Maître de Conférence à la Faculté des Lettres de Rennes Le stoïcisme antique s'achève sur le contraste édifiant entre Epictète et Marc-Aurèle : l'esclave phrygien et le maître de l'Empire ont communié dans la même doctrine.