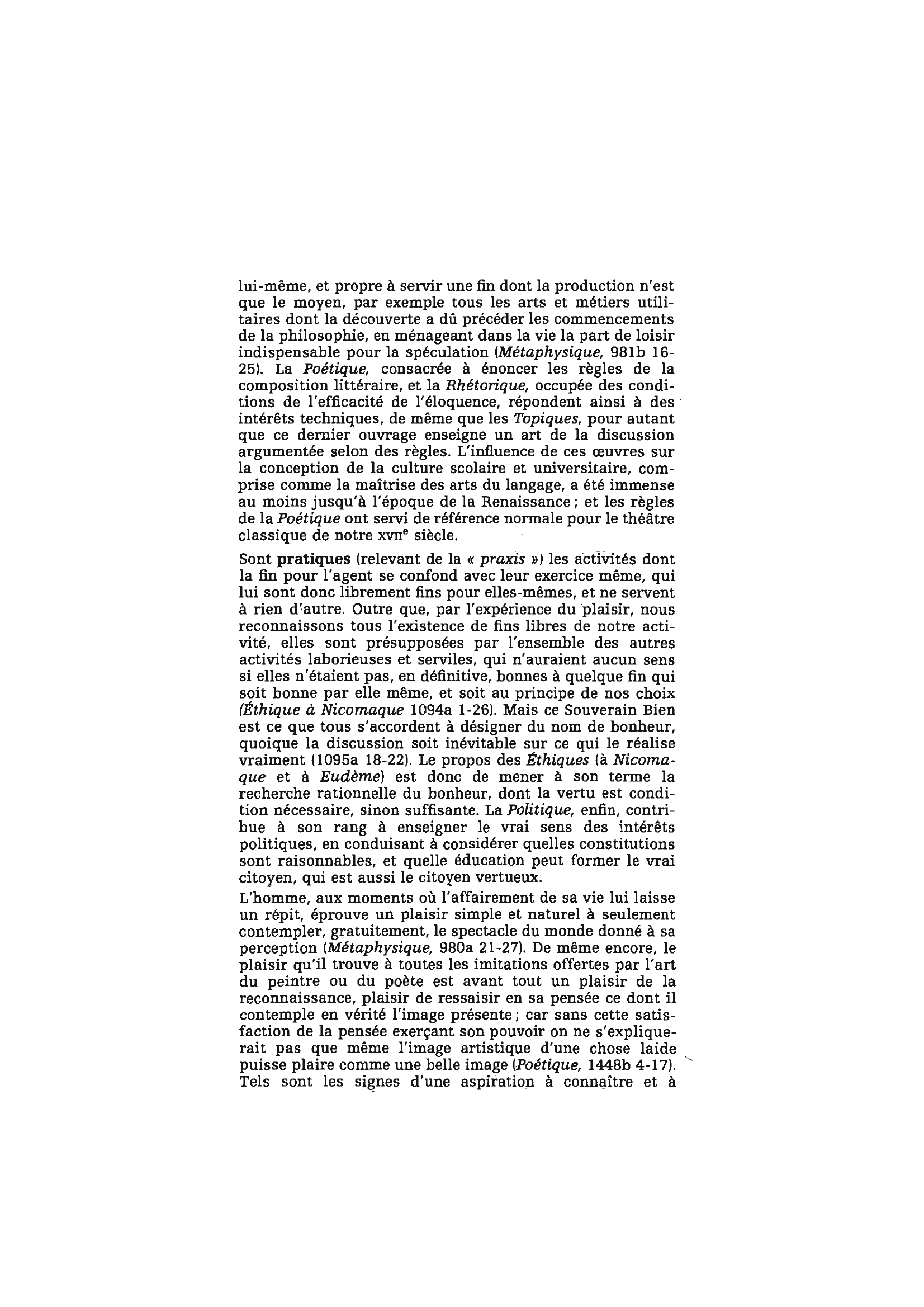Aristote, l'encyclopédiste
Publié le 01/08/2011

Extrait du document

Tout comme il y a des aveugles de la couleur, il y a des aveugles de la Nature (Physis). (...) Les aveugles de la Nature ne sont qu'un genre d'aveugles de l'être. Il faut croire que leur nombre non seulement est bien plus grand que celui des aveugles de la couleur, mais leur puissance aussi est plus forte et plus obstinée, d'autant plus qu'ils sont davantage cachés, et la plupart du temps non reconnus. En conséquence, les aveugles de l'être finissent même par passer pour les seuls authentiques voyants. Et pourtant il est manifeste que cette relation de l'homme à ce qui se montre par avance de soi-même tout en se retirant à toute entreprise de démonstration ne peut qu'être difficile à maintenir dans son originaire vérité. Sinon, Aristote déjà n'aurait pas eu à y ramener l'attention, en attaquant la cécité ontologique.

«
lui-même, et propre à servir une fin dont la production n'est
que le moyen, par exemple tous les arts et métiers utili-
taires dont la découverte a dû précéder les commencements
de la philosophie, en ménageant dans la vie la part de loisir
indispensable pour la spéculation
(Métaphysique, 981b 16-
25).
La
Poétique, consacrée à énoncer les règles de la
composition littéraire, et la
Rhétorique, occupée des condi-
tions de l'efficacité de l'éloquence, répondent ainsi à des
intérêts techniques, de même que les
Topiques, pour autant
que ce dernier ouvrage enseigne un art de la discussion
argumentée selon des règles.
L'influence de ces œuvres sur
la conception de la culture scolaire et universitaire, com-
prise comme la maîtrise des arts du langage, a été immense
au moins jusqu'à l'époque de la Renaissance
; et les règles
de la
Poétique ont servi de référence normale pour le théâtre
classique de notre xvn e siècle.
Sont pratiques (relevant de la «
praxis ») les activités dont
la fin pour l'agent se confond avec leur exercice même, qui
lui sont donc librement fins pour elles-mêmes, et ne servent
à rien d'autre.
Outre que, par l'expérience du plaisir, nous
reconnaissons tous l'existence de fins libres de notre acti-
vité, elles sont présupposées par l'ensemble des autres
activités laborieuses et serviles, qui n'auraient aucun sens
si elles n'étaient pas, en définitive, bonnes à quelque fin qui
soit bonne par elle même, et soit au principe de nos choix
(Éthique à Nicomaque 1094a 1-26).
Mais ce Souverain Bien
est ce que tous s'accordent à désigner du nom de bonheur,
quoique la discussion soit inévitable sur ce qui le réalise
vraiment (1095a 18-22).
Le propos des
Éthiques (à Nicoma-
que et à Eudème) est donc de mener à son terme la
recherche rationnelle du bonheur, dont la vertu est condi-
tion nécessaire, sinon suffisante.
La
Politique, enfin, contri-
bue à son rang à enseigner le vrai sens des intérêts
politiques, en conduisant à considérer quelles constitutions
sont raisonnables, et quelle éducation peut former le vrai
citoyen, qui est aussi le citoyen vertueux.
L'homme, aux moments où l'affairement de sa vie lui laisse
un répit, éprouve un plaisir simple et naturel à seulement
contempler, gratuitement, le spectacle du monde donné à sa
perception (Métaphysique, 980a 21-27).
De même encore, le
plaisir qu'il trouve à toutes les imitations offertes par l'art
du peintre ou du poète est avant tout un plaisir de la
reconnaissance, plaisir de ressaisir en sa pensée ce dont il
contemple en vérité l'image présente
; car sans cette satis-
faction de la pensée exerçant son pouvoir on ne s'explique-
rait pas que même l'image artistique d'une chose laide
puisse plaire comme une belle image (Poétique, 1448b 4-17).
Tels sont les signes d'une aspiration à connaître et à.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Qui peut le plus peut le moins » ARISTOTE
- « L’amitié est une âme en deux corps » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- « Il n’y a point de génie sans un grain de folie » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- Méthode expérimentale; CHAPITRE 2 ARISTOTE : LOGIQUE ET RHÉTORIQUE
- commentaire Aristote Métaphysique