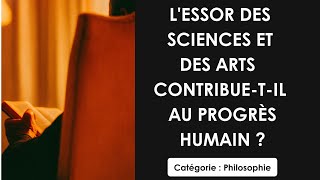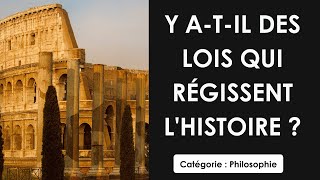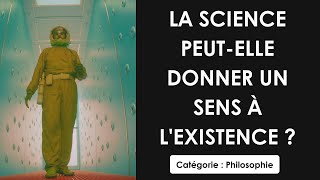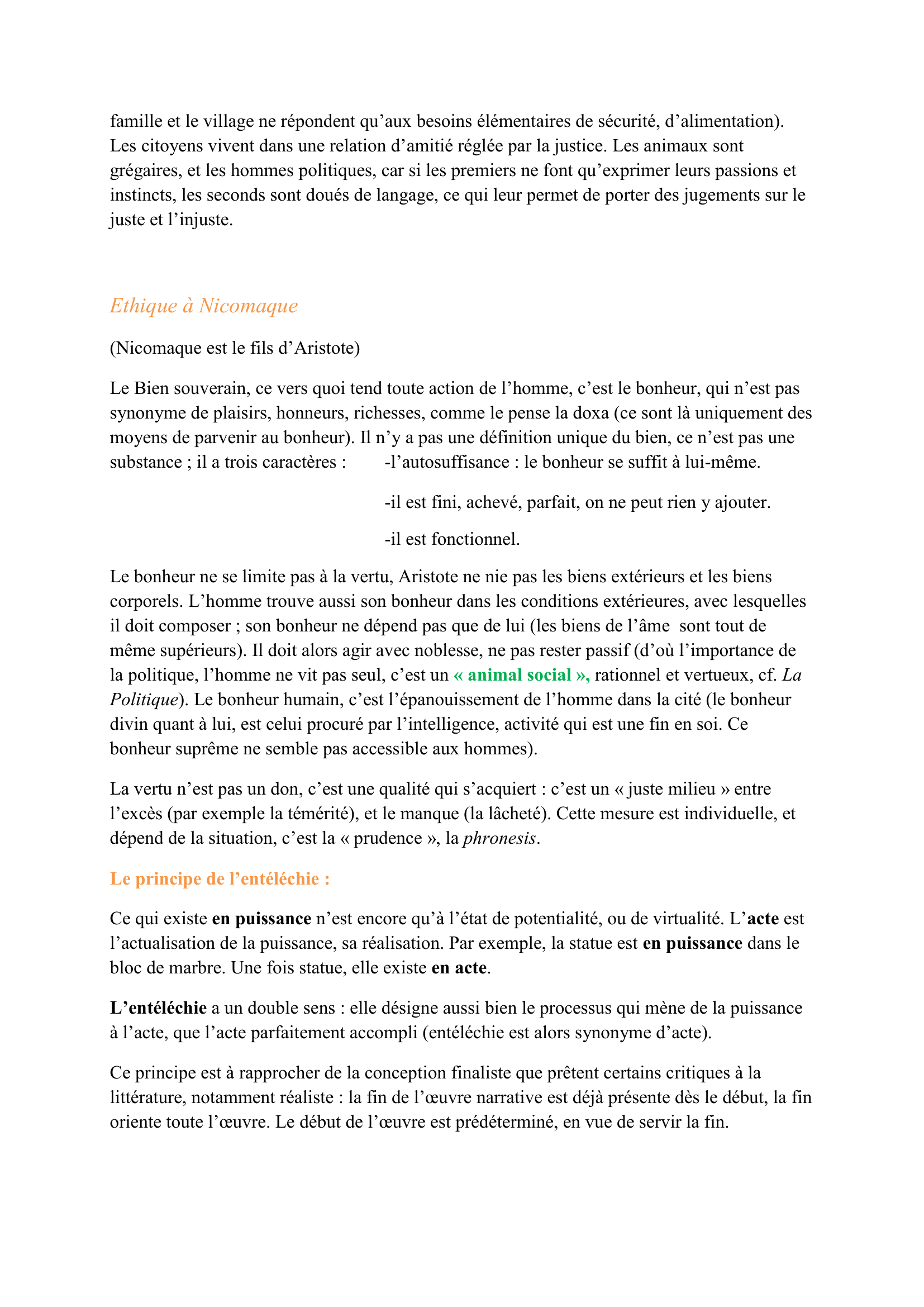Aristote: poétique et politique
Publié le 26/09/2012

Extrait du document


«
famille et le village ne répondent qu’aux besoins élément aires de sécurité, d’alimentation).
Les citoyens vivent dans une relation d’amitié réglée par la justice.
Les animaux sont
grégaires, et les hommes politiques, car si les premiers ne font qu’exprimer leurs passions et
instincts, les seconds sont doués de l angage, ce qui leur permet de porter des jugements sur le
juste et l’injuste.
Ethique à Nicomaque
(Nicomaque est le fils d’Aristote)
Le Bien souverain, ce vers quoi tend toute action de l’homme, c’est le bonheur, qui n’est pas
synonyme de plaisirs, honneurs, richesses, comme le pense la doxa (ce sont là uniquement des
moyens de parvenir au bonheur).
Il n’y a pas une définition unique du bien, ce n’est pas une
substance ; il a trois caractères : -l’autosuffisance : le bonheur se suffit à lui -même.
-il est fini, achevé, parfait, on ne peut rien y ajouter.
-il est fonctionnel.
Le bonheur ne se limite pas à la vertu, Aristote ne nie pas les biens extérieurs et les biens
corporels.
L’homme trouve aussi son bonheur dans les conditions extérieures, avec lesquelles
il doit composer ; son bonheur ne dépend pas que de lui (les biens de l’âme sont tout de
même supérieurs).
Il doit alors agir avec noblesse, ne pas rester passif (d’où l’importance de
la politique, l’homme ne vit pas seul, c’est un « animal soc ial », rationnel et vertueux, cf.
La
Politique ).
Le bonheur humain, c’est l’épanouissement de l’homme dans la cité (le bonheur
divin quant à lui, est celui procuré par l’intelligence, activité qui est une fin en soi.
Ce
bonheur suprême ne semble pas access ible aux hommes).
La vertu n’est pas un don, c’est une qualité qui s’acquiert : c’est un « juste milieu » entre
l’excès (par exemple la témérité), et le manque (la lâcheté).
Cette mesure est individuelle, et
dépend de la situation, c’est la « prudence », l a phronesis .
Le principe de l’entéléchie :
Ce qui existe en puissance n’est encore qu’à l’état de potentialité, ou de virtualité.
L’ acte est
l’actualisation de la puissance, sa réalisation.
Par exemple, la statue est en puissance dans le
bloc de marbre.
U ne fois statue, elle existe en acte .
L’entéléchie a un double sens : elle désigne aussi bien le processus qui mène de la puissance
à l’acte, que l’acte parfaitement accompli (entéléchie est alors synonyme d’acte).
Ce principe est à rapprocher de la concep tion finaliste que prêtent certains critiques à la
littérature, notamment réaliste : la fin de l’œuvre narrative est déjà présente dès le début, la fin
oriente toute l’œuvre.
Le début de l’œuvre est prédéterminé, en vue de servir la fin..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Qui peut le plus peut le moins » ARISTOTE
- « L’amitié est une âme en deux corps » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- « Il n’y a point de génie sans un grain de folie » ATTRIBUÉ À ARISTOTE
- Méthode expérimentale; CHAPITRE 2 ARISTOTE : LOGIQUE ET RHÉTORIQUE
- commentaire Aristote Métaphysique