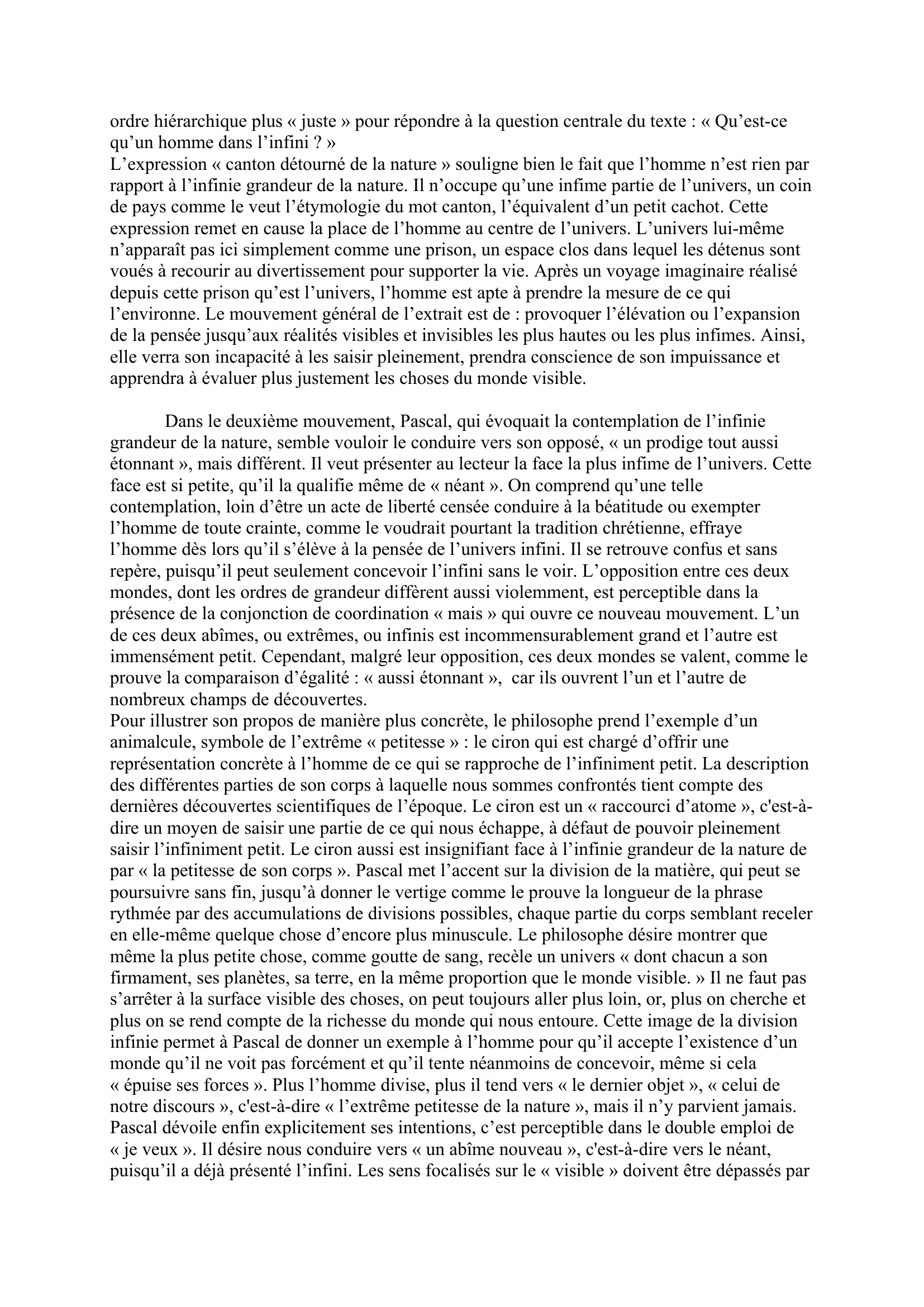Blaise PASCAL : Les deux infinis...
Publié le 10/01/2013

Extrait du document


«
ordre hiérarchique plus « juste » pour répondre à la question centrale du texte : « Qu’est -ce
qu’un homme dans l’infini ? »
L’expression « canton détourné de la nature » souligne bien le fait que l’homme n’est rien par
rapport à l’infinie grandeur de la nature.
Il n’occupe qu’une infime partie de l’univers, un coin
de pays comme le veut l’étymologie du mot canton, l’équivalent d’un petit cachot.
Cette
expression remet en cause l a place de l’homme au centre de l’univers.
L’univers lui-même
n’apparaît pas ici simplement comme une prison, un espace clos dans lequel les détenus sont
voués à recourir au divertissement pour supporter la vie.
Après un voyage imaginaire réalisé
depuis ce tte prison qu’est l’univers, l’homme est apte à prendre la mesure de ce qui
l’environne.
Le mouvement général de l’extrait est de : provoquer l’élévation ou l’expansion
de la pensée jusqu’aux réalités visibles et invisibles les plus hautes ou les plus infimes.
Ainsi,
elle verra son incapacité à les saisir pleinement, prendra conscience de son impuissance et
apprendra à évaluer plus justement les choses du monde visible.
Dans le deuxième mo uvement, Pascal, qui évoquait la contemplation de l’infinie
grandeur de la nature, semble vouloir le conduire vers son opposé, « un prodige tout aussi
étonnant », mais différent.
Il veut présenter au lecteur la face la plus infime de l’univers.
Cette
face est si petite, qu’il la qualifie même de « néant ».
On comprend qu’une telle
contemplation, loin d’être un acte de liberté censée conduire à la béatitude ou exempter
l’homme de toute crainte, comme le voudrait pourtant la tradition chrétienne, effraye
l’homme dès lors qu’il s’élève à la pensée de l’univers infini.
Il se re trouve confus et sans
repère, puisqu’il peut seulement concevoir l’infini sans le voir.
L’opposition entre ces deux
mondes, dont les ordres de grandeur diffèrent aussi violemment, est perceptible dans la
présence de la conjonction de coordination « mais » qui ouvre ce nouveau mouvement.
L’un
de ces deux abîmes, ou extrêmes, ou infinis est incommensurablement grand et l’autre est
immensément petit.
Cependant, malgré leur opposition, ces deux mondes se valent, comme le
prouve la comparaison d’égalité : « auss i étonnant », car ils ouvrent l’un et l’autre de
nombreux champs de découvertes.
Pour illustrer son propos de manière plus concrète, le philosophe prend l’exemple d’ un
animalcule, symbole de l’extrême « petitesse » : le ciron qui est chargé d’offrir une
représentation concrète à l’homme de ce qui se rapproche de l’infiniment petit.
La description
des différentes parties de son corps à laquelle nous sommes confrontés tient compte des
dernières découvertes scientifiques de l’époque.
Le ciron est un « raccou rci d’atome », c'est-à -
dire un moyen de saisir une partie de ce qui nous échappe, à défaut de pouvoir pleinement
saisir l’infiniment petit.
Le ciron aussi est insignifiant face à l’infinie grandeur de la nature de
par « la petitesse de son corps ».
Pascal met l’accent sur la division de la matière, qui peut se
poursuivre sans fin, jusqu’à donner le vertige comme le prouve la longueur de la phrase
rythmée par des accumulations de divisions possibles, chaque partie du corps semblant receler
en elle- même quelque chose d’encore plus minuscule .
Le philosophe désire montrer que
même la plus petite chose, comme goutte de sang, recèle un univers « dont chacun a son
firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible.
» Il ne faut pas
s’arrêter à la surface visible des choses, on peut toujours aller plus loin, or, plus on cherche et
plus on se rend compte de la richesse du monde qui nous entoure.
Cette image de la division
infinie permet à Pascal de donner un exemple à l’homme pour qu’il accepte l’existence d’un
monde qu’il ne voit pas forcéme nt et qu’il tente néanmoins de concevoir, même si cela
« épuise ses forces ».
Plus l’homme divise, plus il tend vers « le dernier objet », « celui de
notre discours », c'est-à -dire « l’extrême petitesse de la nature », mais il n’y parvient jamais.
Pascal dévoile enfin explicitement ses intentions, c’est perceptible dans le double emploi de
« je veux ».
Il désire nous conduire vers « un abîme nouveau », c'est-à -dire vers le néant,
puisqu’il a déjà présenté l’infini.
Les sens focalisés sur le « visible » doivent être dépassés par.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Blaise PASCAL: Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
- « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Blaise Pascal, Pensées
- « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Blaise Pascal, Pensées, 206. Commentez cette citation.
- Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Pensées (1670), 206 Pascal, Blaise. Commentez cette citation.
- Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. [ Pensées (1670), 206 ] Pascal, Blaise. Commentez cette citation.