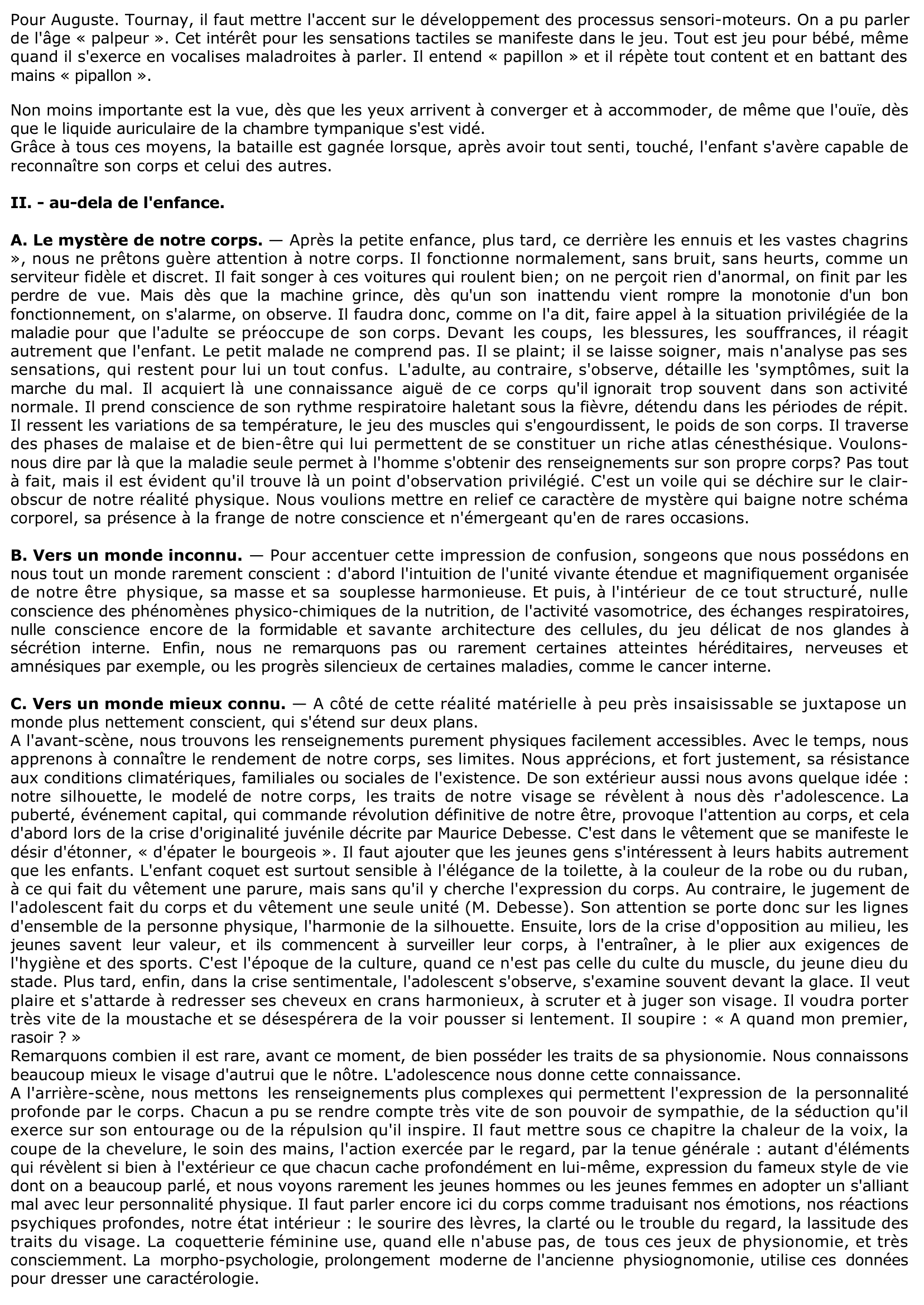Comment connaît-on notre propre corps ?
Publié le 20/06/2009

Extrait du document
Nous vivons familièrement avec notre corps, nous vivons tous les jours avec lui. Nous avons à le nourrir, à le déplacer, à lui donner du repos, ou au contraire à le lancer avec force dans l'action, selon les circonstances. A certains jours, nous lui imposons des privations, des souffrances,, et à d'autres c'est lui qui nous tourmente ou nous entraîne. Il n'en demeure pas moins toujours l'ami, le compagnon fidèle et dévoué et parfois capricieux de notre cheminement terrestre. Et pourtant pouvons-nous dire que nous le connaissions bien ? Que nous ayons pris sur lui renseignements et garanties? Questions qui se posent, questions plus importantes qu'elles ne semblent au premier abord; c'est ce que souligne Jean Lhermitte lorsqu'il écrit : « Comment pourrions-nous agir sur le monde extérieur, si nous n'étions pas en possession d'un schéma de nos attitudes et de notre situation dans l'espace, si nous n'avions pas en nous le sentiment complexe, mais fort et toujours présent, de notre conscience de notre personnalité physique ? « Questions délicates dont s'occupe la science moderne. Elle compte des noms tels que Jean Lhermitte, en France, avec Limage de noire corps; Henri Head, de Londres, avec son Schéma corporel; P. Schilder, de New-York, avec son Image de soi; Van Boggaert, d'Anvers, avec sa Somatopsychè. Aussi, en nous inspirant de leurs travaux, mettons-nous en quête des renseignements que nous avons sur notre propre corps. Pour ne pas nous perdre en si vaste champ d'exploration, posons trois poteaux indicateurs sur notre route : les premières données de la somatognosie, les plus utiles et les plus nécessaires, ne remontent-elles pas à notre première enfance ? En avons-nous d'autres plus tard ? Et comment les obtenons-nous ? I. — La petite enfance. Avec la petite enfance, nous plongeons dans le chaos primitif. Gomme le remarque fort justement Jean Rimaud dans Éducation et direction de la croissance, p. 60 et suiv. : « Nous savons maintenant que les philosophes avaient raison contre l'illusion du sens commun : l'univers est d'abord pour nous une représentation, un monde d'images dont l'enfant ne se distingue pas. Pour en émerger par la conscience, pour pouvoir, comme disent ces mêmes philosophes, faire exister le monde en existant lui-même pour lui-même, penser le monde et se penser, l'enfant doit conquérir son corps sur cet univers indistinct de la représentation, prendre possession de son corps, « Cette enquête s'avère lente, progressive : elle s'exprime dans un jeu difficile et croissant.
«
Pour Auguste.
Tournay, il faut mettre l'accent sur le développement des processus sensori-moteurs.
On a pu parlerde l'âge « palpeur ».
Cet intérêt pour les sensations tactiles se manifeste dans le jeu.
Tout est jeu pour bébé, mêmequand il s'exerce en vocalises maladroites à parler.
Il entend « papillon » et il répète tout content et en battant desmains « pipallon ».
Non moins importante est la vue, dès que les yeux arrivent à converger et à accommoder, de même que l'ouïe, dèsque le liquide auriculaire de la chambre tympanique s'est vidé.Grâce à tous ces moyens, la bataille est gagnée lorsque, après avoir tout senti, touché, l'enfant s'avère capable dereconnaître son corps et celui des autres.
II.
- au-dela de l'enfance.
A.
Le mystère de notre corps. — Après la petite enfance, plus tard, ce derrière les ennuis et les vastes chagrins », nous ne prêtons guère attention à notre corps.
Il fonctionne normalement, sans bruit, sans heurts, comme unserviteur fidèle et discret.
Il fait songer à ces voitures qui roulent bien; on ne perçoit rien d'anormal, on finit par lesperdre de vue.
Mais dès que la machine grince, dès qu'un son inattendu vient rompre la monotonie d'un bonfonctionnement, on s'alarme, on observe.
Il faudra donc, comme on l'a dit, faire appel à la situation privilégiée de lamaladie pour que l'adulte se préoccupe de son corps.
Devant les coups, les blessures, les souffrances, il réagitautrement que l'enfant.
Le petit malade ne comprend pas.
Il se plaint; il se laisse soigner, mais n'analyse pas sessensations, qui restent pour lui un tout confus.
L'adulte, au contraire, s'observe, détaille les 'symptômes, suit lamarche du mal.
Il acquiert là une connaissance aiguë de ce corps qu'il ignorait trop souvent dans son activiténormale.
Il prend conscience de son rythme respiratoire haletant sous la fièvre, détendu dans les périodes de répit.Il ressent les variations de sa température, le jeu des muscles qui s'engourdissent, le poids de son corps.
Il traversedes phases de malaise et de bien-être qui lui permettent de se constituer un riche atlas cénesthésique.
Voulons-nous dire par là que la maladie seule permet à l'homme s'obtenir des renseignements sur son propre corps? Pas toutà fait, mais il est évident qu'il trouve là un point d'observation privilégié.
C'est un voile qui se déchire sur le clair-obscur de notre réalité physique.
Nous voulions mettre en relief ce caractère de mystère qui baigne notre schémacorporel, sa présence à la frange de notre conscience et n'émergeant qu'en de rares occasions.
B.
Vers un monde inconnu.
— Pour accentuer cette impression de confusion, songeons que nous possédons en nous tout un monde rarement conscient : d'abord l'intuition de l'unité vivante étendue et magnifiquement organiséede notre être physique, sa masse et sa souplesse harmonieuse.
Et puis, à l'intérieur de ce tout structuré, nulleconscience des phénomènes physico-chimiques de la nutrition, de l'activité vasomotrice, des échanges respiratoires,nulle conscience encore de la formidable et savante architecture des cellules, du jeu délicat de nos glandes àsécrétion interne.
Enfin, nous ne remarquons pas ou rarement certaines atteintes héréditaires, nerveuses etamnésiques par exemple, ou les progrès silencieux de certaines maladies, comme le cancer interne.
C.
Vers un monde mieux connu. — A côté de cette réalité matérielle à peu près insaisissable se juxtapose un monde plus nettement conscient, qui s'étend sur deux plans.A l'avant-scène, nous trouvons les renseignements purement physiques facilement accessibles.
Avec le temps, nousapprenons à connaître le rendement de notre corps, ses limites.
Nous apprécions, et fort justement, sa résistanceaux conditions climatériques, familiales ou sociales de l'existence.
De son extérieur aussi nous avons quelque idée :notre silhouette, le modelé de notre corps, les traits de notre visage se révèlent à nous dès r'adolescence.
Lapuberté, événement capital, qui commande révolution définitive de notre être, provoque l'attention au corps, et celad'abord lors de la crise d'originalité juvénile décrite par Maurice Debesse.
C'est dans le vêtement que se manifeste ledésir d'étonner, « d'épater le bourgeois ».
Il faut ajouter que les jeunes gens s'intéressent à leurs habits autrementque les enfants.
L'enfant coquet est surtout sensible à l'élégance de la toilette, à la couleur de la robe ou du ruban,à ce qui fait du vêtement une parure, mais sans qu'il y cherche l'expression du corps.
Au contraire, le jugement del'adolescent fait du corps et du vêtement une seule unité (M.
Debesse).
Son attention se porte donc sur les lignesd'ensemble de la personne physique, l'harmonie de la silhouette.
Ensuite, lors de la crise d'opposition au milieu, lesjeunes savent leur valeur, et ils commencent à surveiller leur corps, à l'entraîner, à le plier aux exigences del'hygiène et des sports.
C'est l'époque de la culture, quand ce n'est pas celle du culte du muscle, du jeune dieu dustade.
Plus tard, enfin, dans la crise sentimentale, l'adolescent s'observe, s'examine souvent devant la glace.
Il veutplaire et s'attarde à redresser ses cheveux en crans harmonieux, à scruter et à juger son visage.
Il voudra portertrès vite de la moustache et se désespérera de la voir pousser si lentement.
Il soupire : « A quand mon premier,rasoir ? »Remarquons combien il est rare, avant ce moment, de bien posséder les traits de sa physionomie.
Nous connaissonsbeaucoup mieux le visage d'autrui que le nôtre.
L'adolescence nous donne cette connaissance.A l'arrière-scène, nous mettons les renseignements plus complexes qui permettent l'expression de la personnalitéprofonde par le corps.
Chacun a pu se rendre compte très vite de son pouvoir de sympathie, de la séduction qu'ilexerce sur son entourage ou de la répulsion qu'il inspire.
Il faut mettre sous ce chapitre la chaleur de la voix, lacoupe de la chevelure, le soin des mains, l'action exercée par le regard, par la tenue générale : autant d'élémentsqui révèlent si bien à l'extérieur ce que chacun cache profondément en lui-même, expression du fameux style de viedont on a beaucoup parlé, et nous voyons rarement les jeunes hommes ou les jeunes femmes en adopter un s'alliantmal avec leur personnalité physique.
Il faut parler encore ici du corps comme traduisant nos émotions, nos réactionspsychiques profondes, notre état intérieur : le sourire des lèvres, la clarté ou le trouble du regard, la lassitude destraits du visage.
La coquetterie féminine use, quand elle n'abuse pas, de tous ces jeux de physionomie, et trèsconsciemment.
La morpho-psychologie, prolongement moderne de l'ancienne physiognomonie, utilise ces donnéespour dresser une caractérologie..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MAÎTRE DE SON PROPRE CORPS (résumé) Slavko Kolar
- Comment connaissons-nous notre propre corps?
- Celui qui connaît seulement son propre argument dans une affaire en connaît peu de chose.
- Comment prenons-nous conscience de notre propre corps et le distinguons-nous des objets extérieurs ?
- Qu'est-ce que le corps propre ?