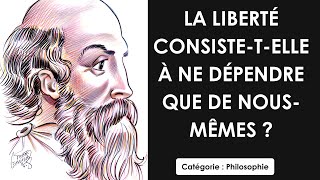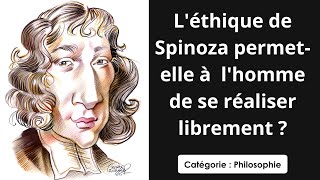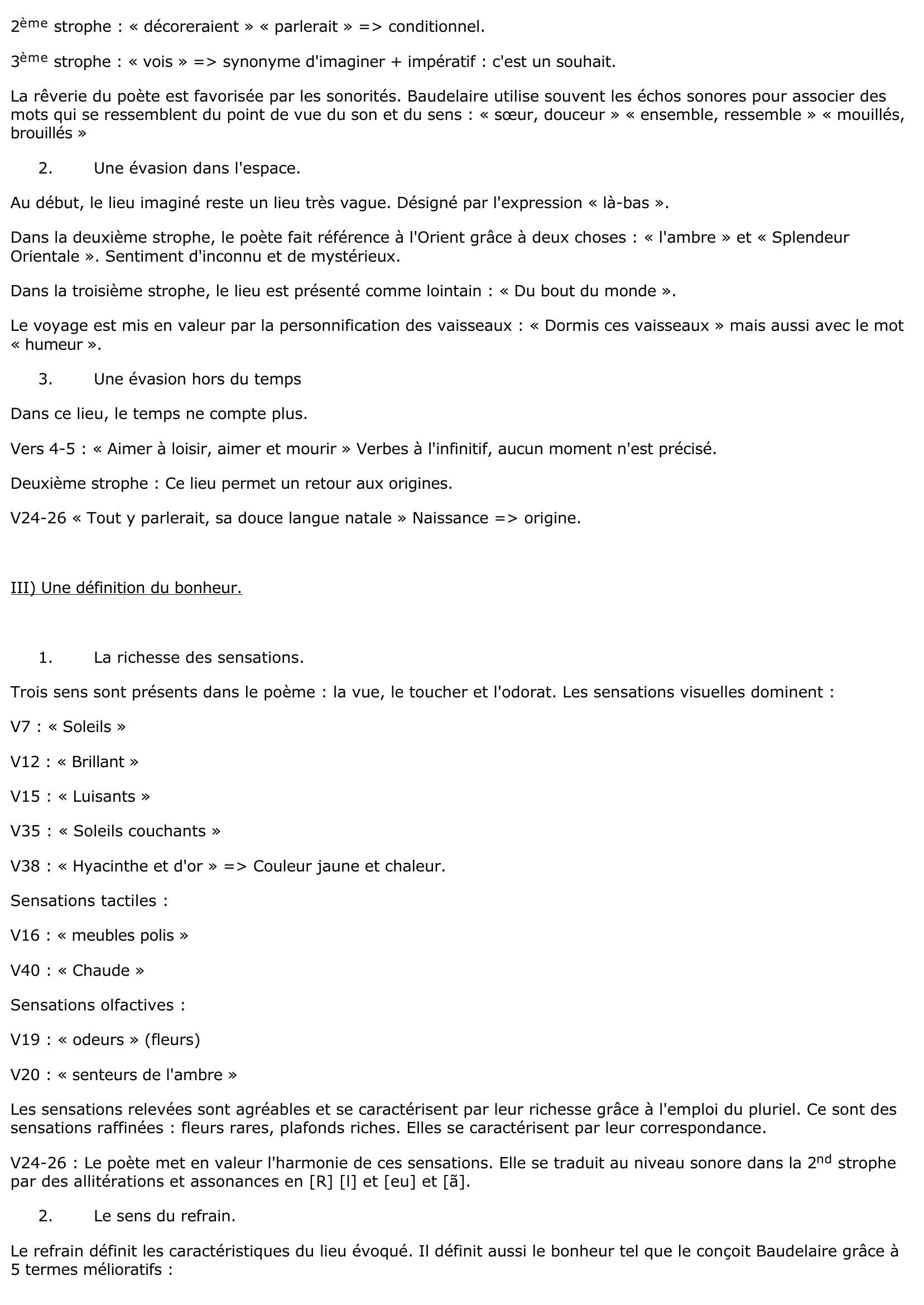Comment une oeuvre d'art nous touche-t-elle ?
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
«
2ème strophe : « décoreraient » « parlerait » => conditionnel.
3ème strophe : « vois » => synonyme d'imaginer + impératif : c'est un souhait.
La rêverie du poète est favorisée par les sonorités.
Baudelaire utilise souvent les échos sonores pour associer desmots qui se ressemblent du point de vue du son et du sens : « sœur, douceur » « ensemble, ressemble » « mouillés,brouillés »
2.
Une évasion dans l'espace.
Au début, le lieu imaginé reste un lieu très vague.
Désigné par l'expression « là-bas ».
Dans la deuxième strophe, le poète fait référence à l'Orient grâce à deux choses : « l'ambre » et « SplendeurOrientale ».
Sentiment d'inconnu et de mystérieux.
Dans la troisième strophe, le lieu est présenté comme lointain : « Du bout du monde ».
Le voyage est mis en valeur par la personnification des vaisseaux : « Dormis ces vaisseaux » mais aussi avec le mot« humeur ».
3.
Une évasion hors du temps
Dans ce lieu, le temps ne compte plus.
Vers 4-5 : « Aimer à loisir, aimer et mourir » Verbes à l'infinitif, aucun moment n'est précisé.
Deuxième strophe : Ce lieu permet un retour aux origines.
V24-26 « Tout y parlerait, sa douce langue natale » Naissance => origine.
III) Une définition du bonheur.
1.
La richesse des sensations.
Trois sens sont présents dans le poème : la vue, le toucher et l'odorat.
Les sensations visuelles dominent :
V7 : « Soleils »
V12 : « Brillant »
V15 : « Luisants »
V35 : « Soleils couchants »
V38 : « Hyacinthe et d'or » => Couleur jaune et chaleur.
Sensations tactiles :
V16 : « meubles polis »
V40 : « Chaude »
Sensations olfactives :
V19 : « odeurs » (fleurs)
V20 : « senteurs de l'ambre »
Les sensations relevées sont agréables et se caractérisent par leur richesse grâce à l'emploi du pluriel.
Ce sont dessensations raffinées : fleurs rares, plafonds riches.
Elles se caractérisent par leur correspondance.
V24-26 : Le poète met en valeur l'harmonie de ces sensations.
Elle se traduit au niveau sonore dans la 2 nd strophe par des allitérations et assonances en [R] [l] et [eu] et [ ã].
2.
Le sens du refrain.
Le refrain définit les caractéristiques du lieu évoqué.
Il définit aussi le bonheur tel que le conçoit Baudelaire grâce à5 termes mélioratifs :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'oeuvre d'art est-elle l'oeuvre d'un génie? (plan)
- ART POÉTIQUE de Peletier du Mans - résumé de l'oeuvre
- L'oeuvre d'art la perception
- Philosophie : Faut il être cultivé pour apprécier une oeuvre d'art?
- Une oeuvre d’art peut-elle être périssable ?