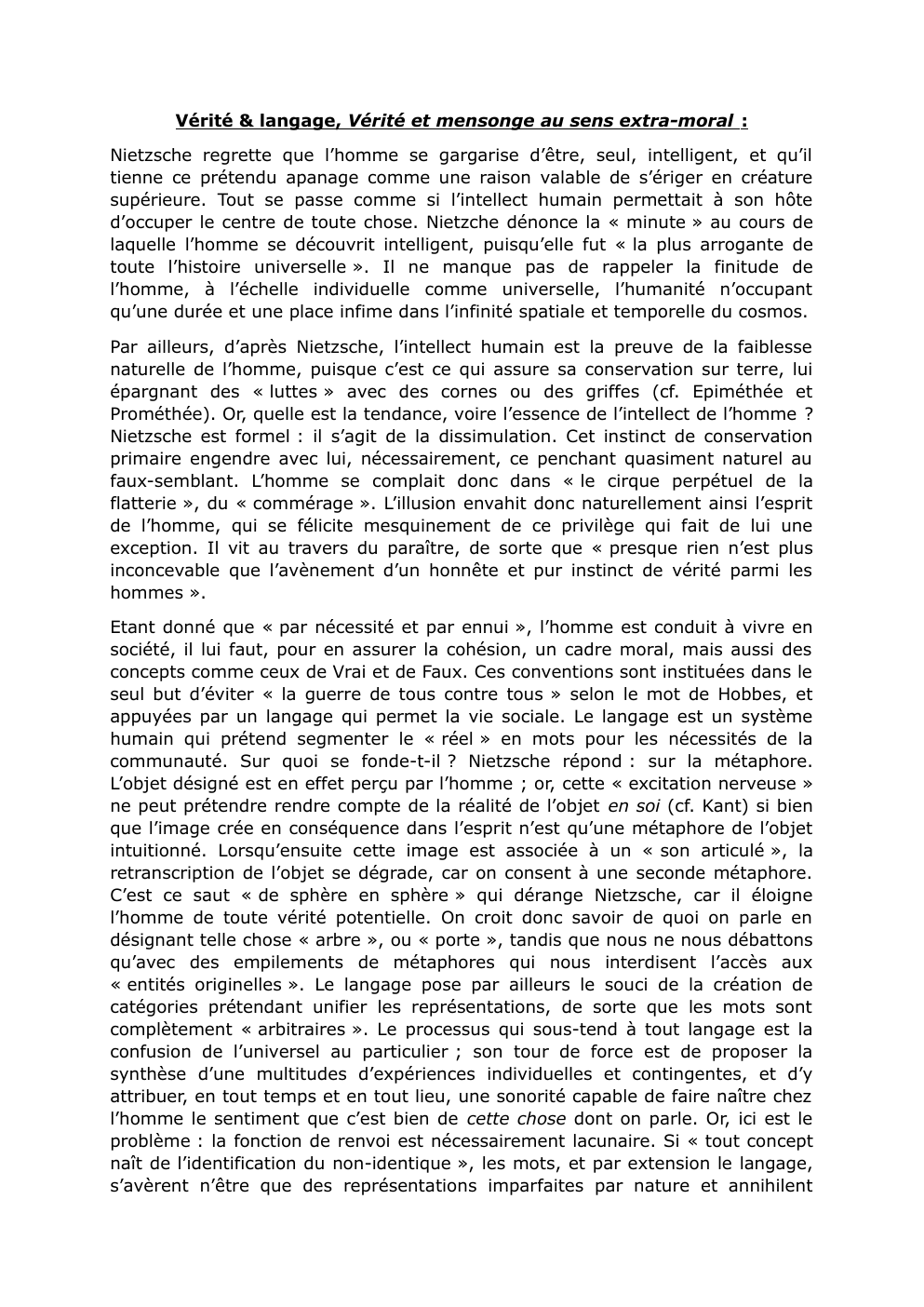Commentaire Vérité et mensonges au sens extra-moral -- Nietzsche
Publié le 21/09/2025
Extrait du document
«
Vérité & langage, Vérité et mensonge au sens extra-moral :
Nietzsche regrette que l’homme se gargarise d’être, seul, intelligent, et qu’il
tienne ce prétendu apanage comme une raison valable de s’ériger en créature
supérieure.
Tout se passe comme si l’intellect humain permettait à son hôte
d’occuper le centre de toute chose.
Nietzche dénonce la « minute » au cours de
laquelle l’homme se découvrit intelligent, puisqu’elle fut « la plus arrogante de
toute l’histoire universelle ».
Il ne manque pas de rappeler la finitude de
l’homme, à l’échelle individuelle comme universelle, l’humanité n’occupant
qu’une durée et une place infime dans l’infinité spatiale et temporelle du cosmos.
Par ailleurs, d’après Nietzsche, l’intellect humain est la preuve de la faiblesse
naturelle de l’homme, puisque c’est ce qui assure sa conservation sur terre, lui
épargnant des « luttes » avec des cornes ou des griffes (cf.
Epiméthée et
Prométhée).
Or, quelle est la tendance, voire l’essence de l’intellect de l’homme ?
Nietzsche est formel : il s’agit de la dissimulation.
Cet instinct de conservation
primaire engendre avec lui, nécessairement, ce penchant quasiment naturel au
faux-semblant.
L’homme se complait donc dans « le cirque perpétuel de la
flatterie », du « commérage ».
L’illusion envahit donc naturellement ainsi l’esprit
de l’homme, qui se félicite mesquinement de ce privilège qui fait de lui une
exception.
Il vit au travers du paraître, de sorte que « presque rien n’est plus
inconcevable que l’avènement d’un honnête et pur instinct de vérité parmi les
hommes ».
Etant donné que « par nécessité et par ennui », l’homme est conduit à vivre en
société, il lui faut, pour en assurer la cohésion, un cadre moral, mais aussi des
concepts comme ceux de Vrai et de Faux.
Ces conventions sont instituées dans le
seul but d’éviter « la guerre de tous contre tous » selon le mot de Hobbes, et
appuyées par un langage qui permet la vie sociale.
Le langage est un système
humain qui prétend segmenter le « réel » en mots pour les nécessités de la
communauté.
Sur quoi se fonde-t-il ? Nietzsche répond : sur la métaphore.
L’objet désigné est en effet perçu par l’homme ; or, cette « excitation nerveuse »
ne peut prétendre rendre compte de la réalité de l’objet en soi (cf.
Kant) si bien
que l’image crée en conséquence dans l’esprit n’est qu’une métaphore de l’objet
intuitionné.
Lorsqu’ensuite cette image est associée à un « son articulé », la
retranscription de l’objet se dégrade, car on consent à une seconde métaphore.
C’est ce saut « de sphère en sphère » qui dérange Nietzsche, car il éloigne
l’homme de toute vérité potentielle.
On croit donc savoir de quoi on parle en
désignant telle chose « arbre », ou « porte », tandis que nous ne nous débattons
qu’avec des empilements de métaphores qui nous interdisent l’accès aux
« entités originelles ».
Le langage pose par ailleurs le souci de la création de
catégories prétendant unifier les représentations, de sorte que les mots sont
complètement « arbitraires ».
Le processus qui sous-tend à tout langage est la
confusion de l’universel au particulier ; son tour de force est de proposer la
synthèse d’une multitudes d’expériences individuelles et contingentes, et d’y
attribuer, en tout temps et en tout lieu, une sonorité capable de faire naître chez
l’homme le sentiment que c’est bien de cette chose dont on parle.
Or, ici est le
problème : la fonction de renvoi est nécessairement lacunaire.
Si « tout concept
naît de l’identification du non-identique », les mots, et par extension le langage,
s’avèrent n’être que des représentations imparfaites par nature et annihilent
l’espoir tant humain de parvenir à la vérité.
La preuve en est la pléthore de
langues qui sont utilisées autour du globe, chacune minée d’imperfections.
L’homme se flatte de créer le monde de l’abstraction, le monde des concepts, et
érige parmi ces derniers des hiérarchies, des relations, crée des valeurs morales
et des qualités désirables.
Or, ces catégories arbitraires sont humaines, trop
humaines.
Ainsi, affirme Nietzsche, lorsque l’on dit d’un homme qu’il est
honnête, on le justifie par la preuve qu’il a pu faire de son honnêteté.
Nous
sommes en présence d’une tautologie : pourquoi est-il est honnête ? Parce qu’il
est honnête ! Et qu’est-ce que l’honnêteté ? Un concept humain, une
superposition de métaphores qui prétend rendre compte d’une multitudes de
comportements, de manière d’agir… Que savons-nous alors de l’homme honnête
en soi ? Rien.
La grande prétention de l’homme est de se prendre comme mesure
de toute chose et d’oublier la nature....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche - Introduction théorique sur vérité et le mensonge au sens extra-moral - Nietzsche
- Nietzsche, Sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral.
- Nietzsche, Sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral.
- Nietzsche - Vérité et Mensonge au sens Extra-moral
- nietzche_verite et mensonge au sens extra moral