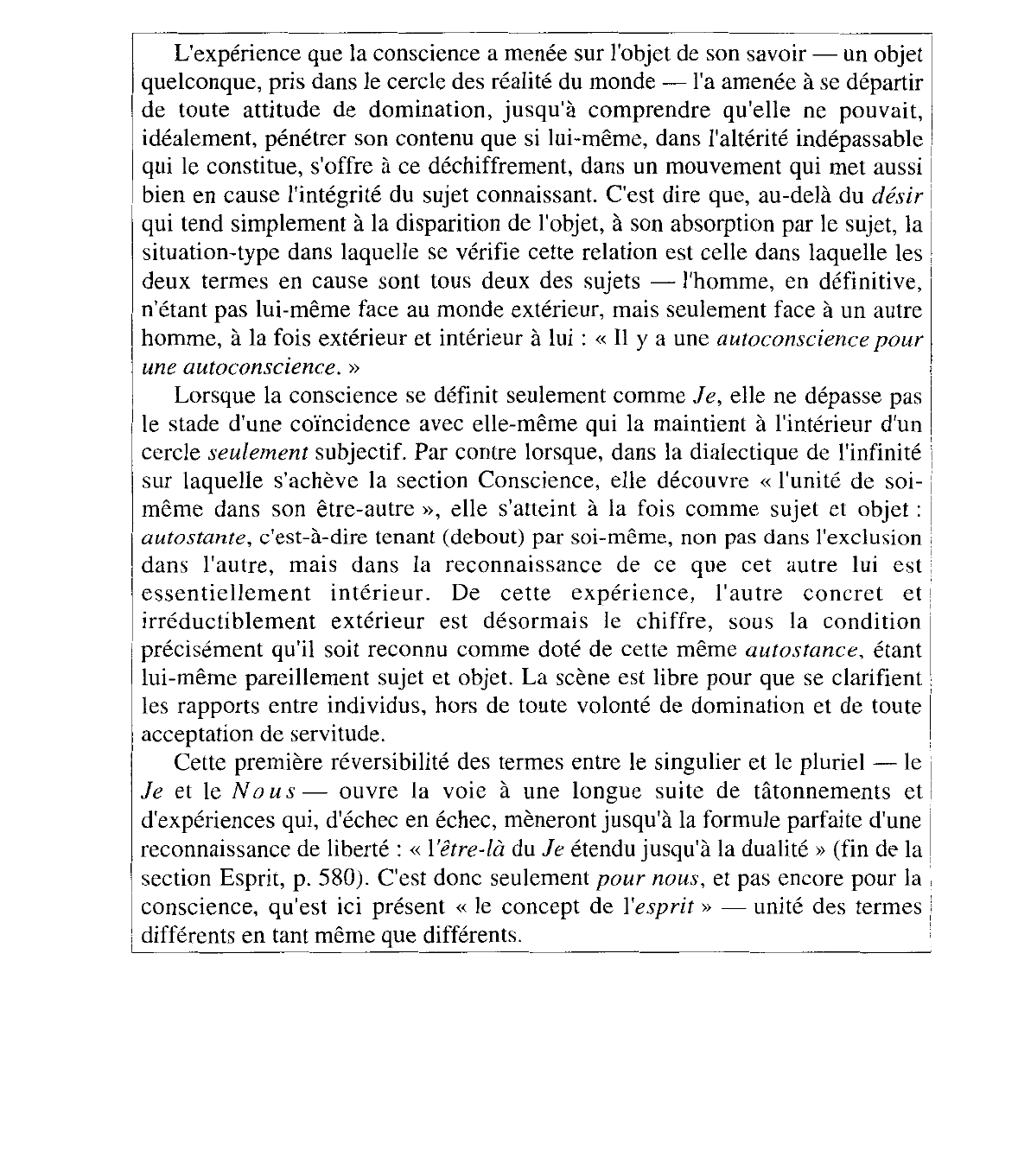Conscience et autoconscience
Publié le 22/03/2015
Extrait du document


«
Textes commentés 37
L'expérience que la conscience a menée sur l'objet de son savoir -un objet
quelconque, pris dans le cercle des réalité du monde - l'a amenée à se départir
de toute attitude de domination, jusqu'à comprendre qu'elle ne pouvait,
idéalement, pénétrer son contenu que si lui-même, dans l'altérité indépassable
qui le constitue, s'offre à ce déchiffrement, dans un mouvement qui met aussi
bien en cause l'intégrité du sujet connaissant.
C'est dire que, au-delà du
désir
qui tend simplement à la disparition de l'objet, à son absorption par le sujet, la
situation-type dans laquelle se vérifie cette relation est celle dans laquelle les
deux termes en cause sont tous deux des sujets -l'homme, en définitive,
n'étant pas lui-même face au monde extérieur, mais seulement face à un autre
homme, à la fois extérieur et intérieur à lui :
« Il y a une autoconscience pour
une autoconscience.
»
Lorsque la conscience se définit seulement comme Je, elle ne dépasse pas
le stade d'une coïncidence avec elle-même qui la maintient à l'intérieur d'un
cercle
seulement subjectif.
Par contre lorsque, dans la dialectique de l'infinité
sur laquelle s'achève la section Conscience, elle découvre
« l'unité de soi
même dans son être-autre
», elle s'atteint à la fois comme sujet et objet :
autostante, c'est-à-dire tenant (debout) par soi-même, non pas dans l'exclusion
dans l'autre, mais dans la reconnaissance de ce que cet autre lui est
essentiellement intérieur.
De cette expérience, l'autre concret et
irréductiblement extérieur est désormais le chiffre, sous la condition
précisément qu'il soit reconnu comme doté de cette même
autostance, étant
lui-même pareillement sujet et objet.
La scène est libre pour que se clarifient
les rapports entre individus, hors de toute volonté de domination et de toute
acceptation de servitude.
Cette première réversibilité des termes entre le singulier et le pluriel -le
1 Je et le Nous - ouvre la voie à une longue suite de tâtonnements et 1
d'expériences qui, d'échec en échec, mèneront jusqu'à la formule parfaite d'une 'I
reconnaissance de liberté: «l'être-là du Je étendu jusqu'à la dualité» (fin de la.
section Esprit, p.
580).
C'est donc seulement pour nous, et pas encore pour la ·
[
conscience, qu'est ici présent « le concept de l'esprit» - unité des termes,
1 différents en tant même que différents..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HEGEL, Liberté de l'autoconscience ; stoïcisme, scepticisme, et la conscience malheureuse
- La conscience de soi rend-elle libre ? (Corrigé) Problématisation
- Commentaire Texte Bergson L'évolution créatrice, l'élan vital et la conscience
- expose sur la conscience
- La conscience de soi suppose-t-elle autrui ?