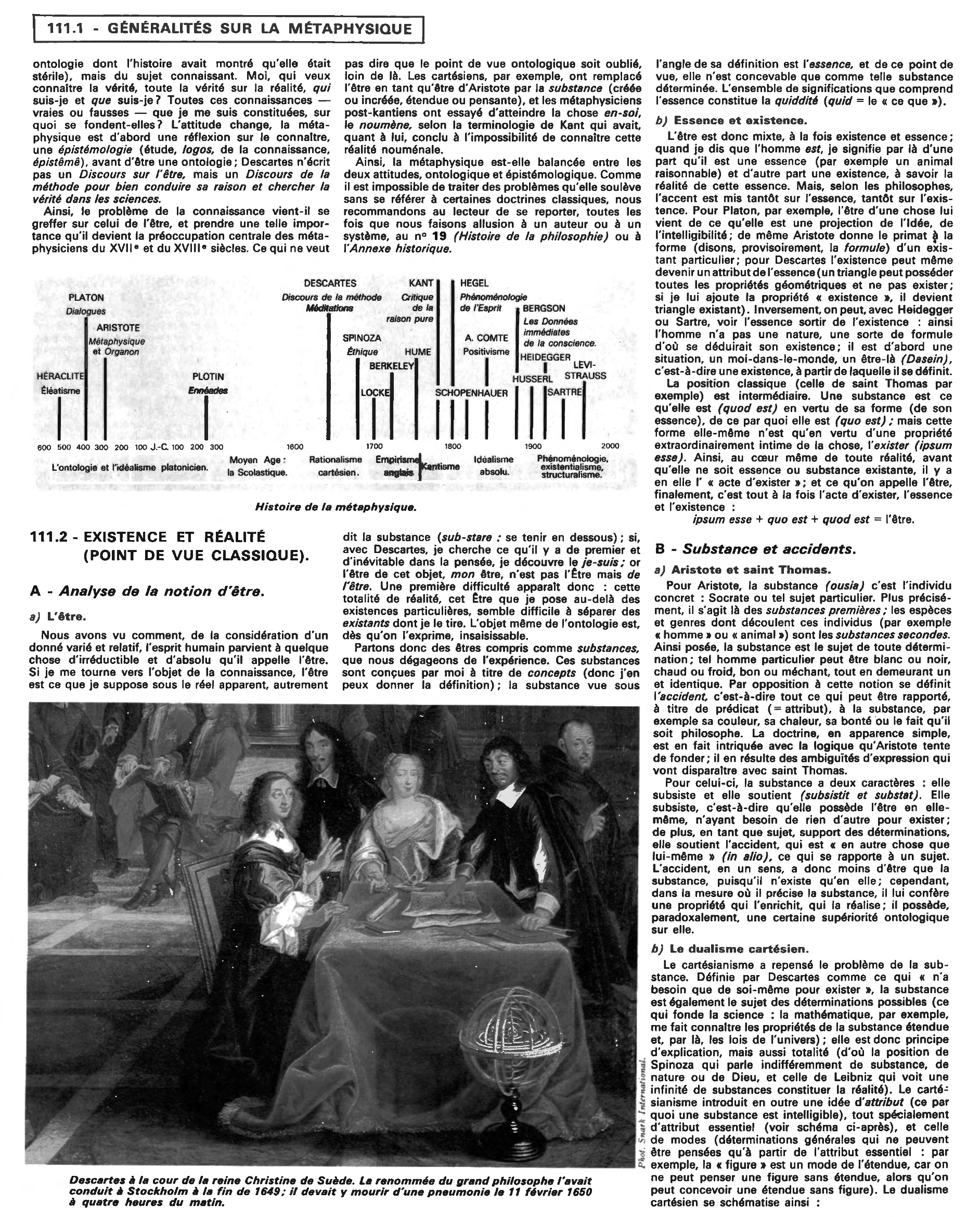COURS DE MÉTAPHYSIQUE GÉNÉRALE
Publié le 01/04/2012

Extrait du document
Face à l'être dans le temps, il y a donc un désir d'éternité (Alquié) qui peut prendre l'aspect affectif de la névrose et de la passion (combien de temps le temps suspendra-t -il son vol?). mais aussi les carac tères objectifs de la pensée; un état tel que « j'aime « est dans le temps, mais une pensée telle que « deux et deux font quatre « n'est plus dans le temps : elle est devenue éternelle parce que l'esprit qui la pense, la pense en dehors des changements. La science est rassurante parce qu'elle considère le passé comme l'égal du présent et du futur ; le changement matériel lui-même n'est pas une dégradation, mais une transformation; la quantité totale de matière et d'énergie contenue dans l'univers est constante, ce sont ses déterminations et ses formes particulières qui changent. La transposition dans le domaine de la vie de l'esprit de l'éternité scientifique met l'homme en présence de la valeur d'éternité, valeur qui, par essence, ne peut pas être présente, ce qui la temporaiisera it : l'éternité est la présence d'une absence.
«
111.1 - GÉNÉRALITÉS SUR LA MÉTAPHYSIQUE
ontologie dont l'histoire avait mon t ré qu'elle était
stérile), mais du sujet connaissant .
Moi , qui veux
connaître la vérité , toute la vérité sur la réalité, qui suis -je et que suis - je? Toutes ces conna issances -
vraies ou fausses -que je me suis const itué es, sur quoi se fond ent -elles? L'attitude change, la méta physique est d'abord une réflex ion sur le conna ître,
une ép istémologie (étude, logos .
de la connaissance, épistêmê), avant d'être une ontologie ; Descartes n'écrit
pas un Discours sur l'être, mais un Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vé rité dans les sciences .
Ainsi , le problème de la connaissance vient -il se gre ffer sur ce lu i de l'être , et prend re une telle i mpor tance qu 'il de vient la préoccupat ion central e des méta physiciens du XVII • et du XVIII • siècles.
Ce qui ne veut pas
dire que le
point de vue ontologique soit oublié,
loin de là.
Les cartésiens , par exemple, ont remplacé l'être en tant qu'être d' Aristote par la substance (créée
ou incréée , étendue ou pensante) , et les métaphysiciens
post
-kant iens ont essayé d'atte indre la chose en - soi , le noumène , selon la terminologie de Kant qui avait , quant à lu i, conclu à l'impossib ili té de conna ître cette réalité nouménale.
Ainsi, la métaphysique est-elle balancée entre les
deux attitudes , ontologique et épistémolog ique.
Comme
il est impossible de traiter des probl èm es qu 'ell e soulève
sans se
réfé rer à certa ines doctrines classiques , nous
recommandons au lecteu r de se report er, tou t es les fois que nous faisons allus ion à un auteu r ou à un
syst ème , au n° 19 (His toir e de la phil osophie) ou à l'Annexe historique .
PlATON Dialogues
DESCAR TES Discours de la méthode KANT
Critique de la HEGEL Phénoménologie
Méditations de l'Esprit BERGSON
HÉRACLITE
Élèatisme
1
ARISTOTE Mét aphysiq ue
e t Organon
PLOTIN
Ennéades
600 5oo 400 300 200 100 J.-C.
100 200 300 1600
raison pure
SPINOZA Éthique HUM E BERKELEY
LOCKE
1 1700
Les Données
immédiates
de la conscience.
A.
COMTE
Positivisme HEIDEGGER
1
1 LEVI-
H USSERL STRAUSS
SCHOPENHAUER
SARTRE
Ill 1 1 1800 1900 2000
L'ontologie et l'idèalisme platon1cien.
Moyen Age: la Scolastique .
Rationalisme cartésien
.
Empirism 1 1 • Kantisme
ang a1s ldèalisme
absolu.
Phènomènologie, existentialisme, structuralisme
.
Histoire de la métaphysique.
111.2- EXISTENCE ET RÉALITÉ
(POINT DE VUE CLASSIQUE).
A - Analyse de la notion d'être.
a) L'être.
Nous avons vu comment , de la considération d'un donné varié et re latif , l'esprit humain parvient à quelque chose d 'irréductible et d'absolu qu'il appelle l'être.
Si je me tourne vers l'objet de la connaissance , l'être est ce que je suppose sous le réel apparent , autrement
dit la substance (sub -stare : se tenir en dessous) ; si, avec Descartes , je che rche ce qu 'il y a de premier et d'inév itable dans la pensée , je découvre le je- suis; or l'êtr e de cet objet , mon être, n'est pas I'Ëtre mais de l'être .
Une premiè re difficulté appara ît donc : cette
totalité de réalité , cet Ëtre que je pose au-delà des
existences particulières, semble difficile à séparer des existants dont je le tir e.
L'objet même de l'ontologie est, dès qu'on l'exprime , insaisissable .
Partons donc des êtres compris comme substances , que nous dégageons de l'expér ience.
Ces substances sont con çues par moi à titre de concepts (donc j'en
peux donner la définition) ; la substance vue sous
l'angle de sa définition est l'essence, et de ce point de vue, elle n'est concevable que comme telle substance
déterminée .
L'ensemble de significations que comprend l'essence constitue la quiddité (quid =le «ce que» ).
b) Essence et existence.
L 'être est donc mix te , à la fois ex istence et essence ; quand je dis que l' homme est , je signifie par là d'une
part qu'il est une essence (par exemple un animal
raisonnable) et d'autre part une existence, à savoir la réalité de cette essence .
Mais , selon les philosophes, l'accent est mis tantôt sur l'ess e nce , tantôt sur l'ex is tence.
Pour Platon , par ex empl e, l'êt re d 'une chose lui
vient de ce qu'elle est une projection de l'Id ée, de l'intelligibil ité ; de même Aristote donne le primat à la forme (disons , provisoirement , la formule) d'un eÎ.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Première générale Cours Mathématiques Fonction exponentielle
- COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE Ferdinand de Saussure (résumé)
- COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE, 1916. Ferdinand de Saussure
- COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE Ferdinand de Saussure (résumé & analyse)
- MÉTAPHYSIQUE GÉNÉRALE SELON LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE PHILOSOPHIQUE DE LA NATURE