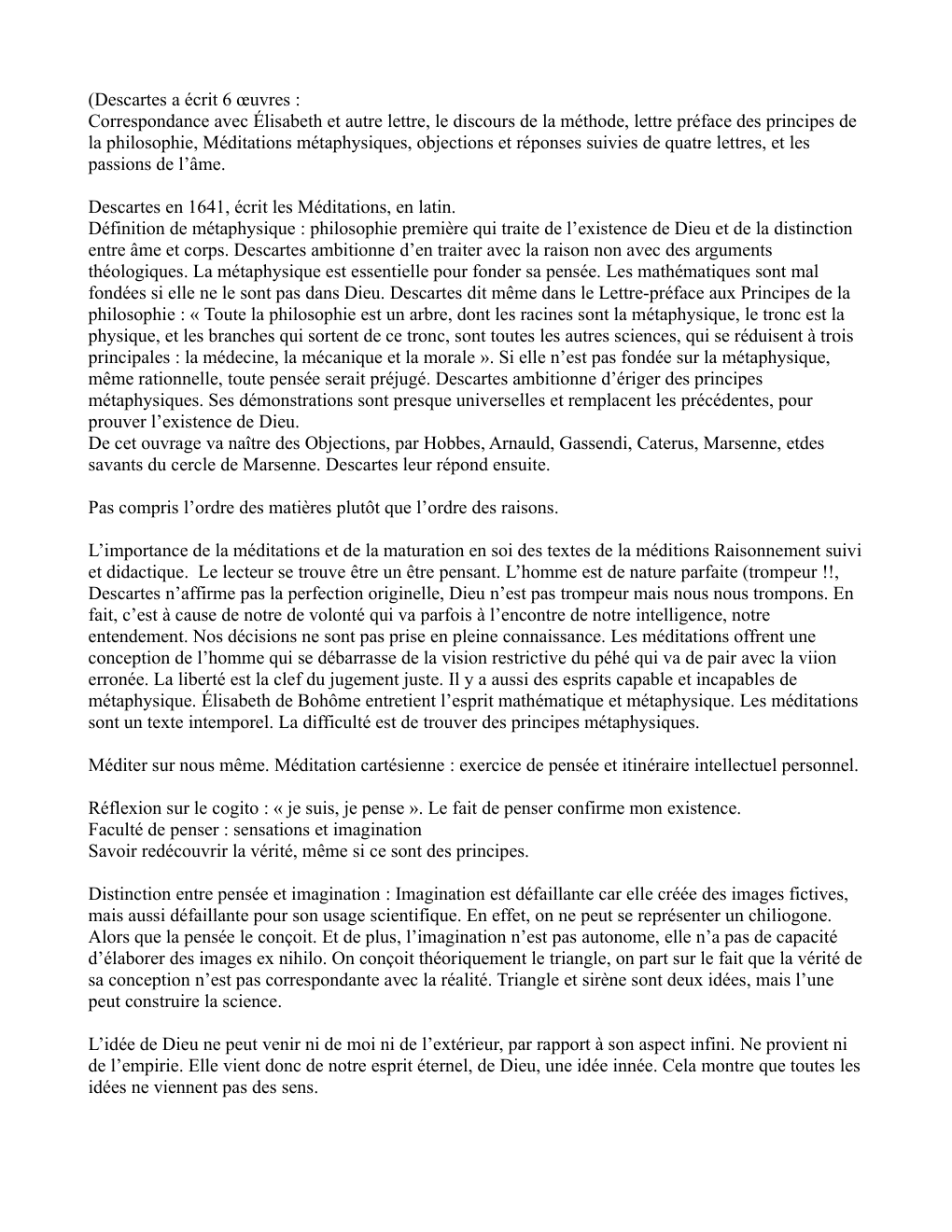Descartes a écrit 6 œuvres
Publié le 07/11/2025
Extrait du document
«
(Descartes a écrit 6 œuvres :
Correspondance avec Élisabeth et autre lettre, le discours de la méthode, lettre préface des principes de
la philosophie, Méditations métaphysiques, objections et réponses suivies de quatre lettres, et les
passions de l’âme.
Descartes en 1641, écrit les Méditations, en latin.
Définition de métaphysique : philosophie première qui traite de l’existence de Dieu et de la distinction
entre âme et corps.
Descartes ambitionne d’en traiter avec la raison non avec des arguments
théologiques.
La métaphysique est essentielle pour fonder sa pensée.
Les mathématiques sont mal
fondées si elle ne le sont pas dans Dieu.
Descartes dit même dans le Lettre-préface aux Principes de la
philosophie : « Toute la philosophie est un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la
physique, et les branches qui sortent de ce tronc, sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois
principales : la médecine, la mécanique et la morale ».
Si elle n’est pas fondée sur la métaphysique,
même rationnelle, toute pensée serait préjugé.
Descartes ambitionne d’ériger des principes
métaphysiques.
Ses démonstrations sont presque universelles et remplacent les précédentes, pour
prouver l’existence de Dieu.
De cet ouvrage va naître des Objections, par Hobbes, Arnauld, Gassendi, Caterus, Marsenne, etdes
savants du cercle de Marsenne.
Descartes leur répond ensuite.
Pas compris l’ordre des matières plutôt que l’ordre des raisons.
L’importance de la méditations et de la maturation en soi des textes de la méditions Raisonnement suivi
et didactique.
Le lecteur se trouve être un être pensant.
L’homme est de nature parfaite (trompeur !!,
Descartes n’affirme pas la perfection originelle, Dieu n’est pas trompeur mais nous nous trompons.
En
fait, c’est à cause de notre de volonté qui va parfois à l’encontre de notre intelligence, notre
entendement.
Nos décisions ne sont pas prise en pleine connaissance.
Les méditations offrent une
conception de l’homme qui se débarrasse de la vision restrictive du péhé qui va de pair avec la viion
erronée.
La liberté est la clef du jugement juste.
Il y a aussi des esprits capable et incapables de
métaphysique.
Élisabeth de Bohôme entretient l’esprit mathématique et métaphysique.
Les méditations
sont un texte intemporel.
La difficulté est de trouver des principes métaphysiques.
Méditer sur nous même.
Méditation cartésienne : exercice de pensée et itinéraire intellectuel personnel.
Réflexion sur le cogito : « je suis, je pense ».
Le fait de penser confirme mon existence.
Faculté de penser : sensations et imagination
Savoir redécouvrir la vérité, même si ce sont des principes.
Distinction entre pensée et imagination : Imagination est défaillante car elle créée des images fictives,
mais aussi défaillante pour son usage scientifique.
En effet, on ne peut se représenter un chiliogone.
Alors que la pensée le conçoit.
Et de plus, l’imagination n’est pas autonome, elle n’a pas de capacité
d’élaborer des images ex nihilo.
On conçoit théoriquement le triangle, on part sur le fait que la vérité de
sa conception n’est pas correspondante avec la réalité.
Triangle et sirène sont deux idées, mais l’une
peut construire la science.
L’idée de Dieu ne peut venir ni de moi ni de l’extérieur, par rapport à son aspect infini.
Ne provient ni
de l’empirie.
Elle vient donc de notre esprit éternel, de Dieu, une idée innée.
Cela montre que toutes les
idées ne viennent pas des sens.
Le méditant, va, grâce à sa lecture, faire passer de l’entendement (intelligence), à la volonté, pour que
le tout décide.
C’est donc un exercice de jugement.
Le jugement, est ce qui nous rend libre en nous
donnant la capacité de choisir.
Volonté = libre-arbitre.
Conscience : Solipsisme (sol-ipse) : Philosophie radicale qui affirme que le seul être dont on est certain
est soi même.
Personnages du texte :
Doyens et docteurs de la faculté de théologie de Paris :
Ils sont l’autorité de Paris, censeurs de leur temps.
Ils gardent précieusement, la philosophie de Thomas
D’Aquin, fondée sur l’aristotélisme christianisé.
Descartes en est partisan, il l’a apprise à l’école, d’où
le terme de scolastique.
Mais Descartes est plutôt partisan de la philosophie nouvelle, souvent en
désaccord avec le thomisme.
D’où la pomme de discorde.
Divergence entre Descartes et tradition scolastique :
-Pour lui la connaissance ne vient pas des sens, (précepte hérité d’Aristote), grâce à l’entendement
(facultés intellectuelles), l’imagination, et l’expérience sensible (mémoire).
-Il considère (comme Platon), que outre, l’empirie, il y a les idées innées comme les mathématiques ou
l’idée de Dieu.
Cela prouve aussi que l’âme est propre à l’Homme.
Elle se différentie du corps, pas
comme chez Aristote.
Il s’agit pour Descartes d’acquérir l’approbation des docteurs, qui traquent hérésies et respect des
dogmes.
Alors même que ce sont ses adversaires philosophiques.
Avec un intérêt commun : la lutte
contre le scepticisme et le libertinage.
1580, les Essais de Michel de Montaigne sont publiés, Pierre Charron et Bayle écrive aussi sur la même
période.
Il y a aussi les libertins érudits, qui rejettent les dogmes et autorités religieuses.
Ce sont les
« esprits forts », car ils considèrent qu’ils peuvent juger de leur seule raison de leur seul esprit.
Remise en cause des sens : Cire et rêve.
Le doute est là, mais il a une place essentiel dans le
raisonnement concessif.
Le rêve : difficile de faire la différence entre veille et sommeil.
Je peux rêver de choses qui sont
vraies : mathématique (2+3=5) en dormant.
Dans le cas contraire, le rêve reste réaliste est devient
crédible.
Le méditant ne pourrait être qu’un rêveur ou même un fou.
La chute dans les préjugé serait un
assoupissement.
Le but est d’atteindre la vérité et pas forcement atteindre la réalité.
Si je calcule en
dormant et que j’ai juste, c’est l’essentiel.
Si, la réalité et la vérité sont évanescentes, c’est qu’il y a un trompeur à l’origine : un malin génie, ou
un Dieu trompeur.
Mais même dans ce doute, permanent, il n’enlèvera point le fait, que je pense et
donc que j’existe.
Responsabilité de Dieu dans le fait que je me trompe.
Bonté et justice divine, alors
que nous sommes des êtres imparfaits ? Notre entendement est fini, et notre volonté infinie.
Un être sans défauts est dès lors un être bon.
Trois preuves de Dieu : Dieu comme cause nécessaire, Être contingent qui créé l’idée de Dieu,
l’existence est une perfection, elle appartient à l’essence de l’être parfait.
Un athée ne peut arborer une
science parfaite, car il n’aura jamais la certitude du Dieu bon.
En effet, l’athée ne peut être sûr que de
lui même : solipsisme.
Les autres sont ils des automates ? Si tout le monde est certain d’avoir un corps, il faut le démontrer
aux autres.
Amputés et hydropiques :
Le corps propre à soi n’est pas une réalité transparente, mais nous sommes des hommes, non des
esprits.
Membre fantôme, douleur de l’esprit : lien esprit corps ??.
Glande pinéale et fibre = courroie de
transmission du corps à l’esprit.
Marie-Frédérique Pellegrin : auteur de la préface
Méditation première :
En amont, processus de remise en question de tout savoir et toutes science.
Mise en liberté de l’esprit.
Il engrange un....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Descartes, Règles pour la direction de l'esprit, première règle, trad. J. Brunschwig modifiée, œuvres philosophiques, Classiques Garnier.
- Dans les Méditations métaphysiques Descartes écrit : je pense donc je suis. De son côté Rousseau écrit dans Les Rêveries du Promeneur solitaire: je sens donc je suis. En vous appuyant sur chacune de ces affirmation, vous vous demanderez quel sens il faut donner à la conscience d'exister.
- L'intérieur du globe s'organise, une chaleur féconde part du centre de la terre, et se distribue dans toutes ses parties. René Descartes, ?uvres de Descartes
- ► « Les rives s’éloignent. Ma mort approche », écrit Albert Cohen. Selon vous, l’écriture autobiographique est-elle une manière de se préparer à la mort ou de conserver la saveur de la vie ? Vous répondrez en vous appuyant sur les textes du corpus et sur d’autres œuvres que vous avez lues ou étudiées.
- « Les rives s’éloignent. Ma mort approche » (l. 22), écrit Albert Cohen. Selon vous, l’écriture autobiographique est-elle une manière de se préparer à la mort ou de conserver la saveur de la vie ? Vous répondrez en vous appuyant sur les textes du corpus et sur d’autres œuvres que vous avez lues ou étudiées.