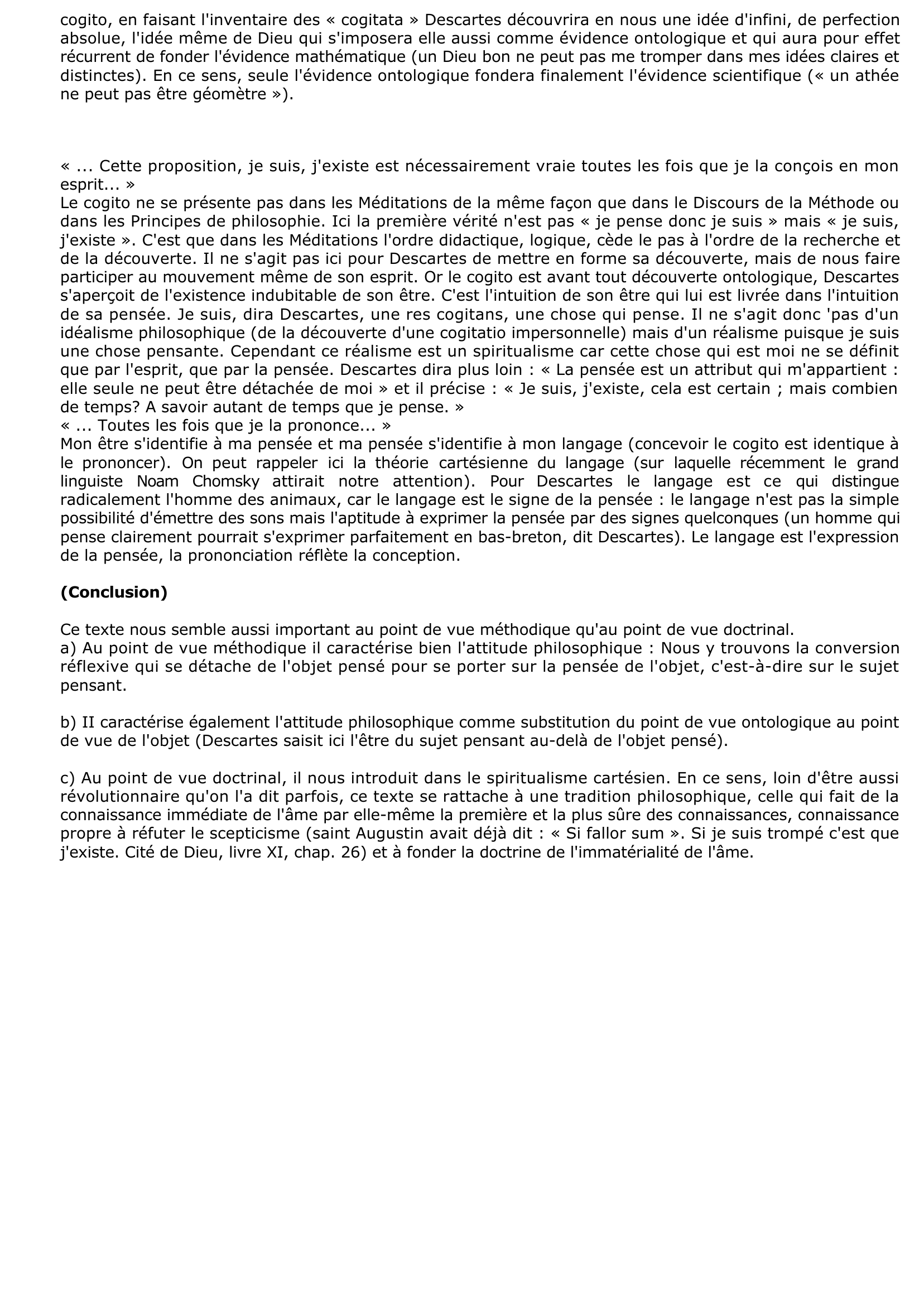DESCARTES: Doute hyperbolique
Publié le 17/04/2005

Extrait du document
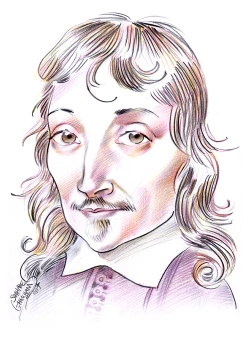
La réflexion de Descartes se fait en trois moments essentiels :
Dans un premier temps, du début du texte jusqu’à « ce que je n’étais point ? « Descartes expose le bilan de sa méthode qui consiste à douter de tout jusqu’à trouver « quelque chose « dont il ne pourra douter et qui constituera sa première vérité certaine. Ainsi en refusant de faire confiance à ses sens et à sa raison il en arrive à la conclusion qu’il n’y a ni ciel, ni terre, ni esprit, ni corps. Il se pose alors le problème de sa propre existence et s’il lui faut oui ou non tomber dans le scepticisme.
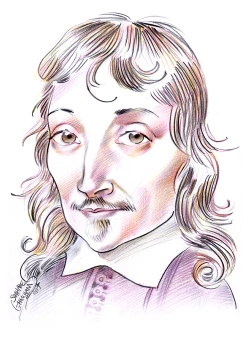
«
cogito, en faisant l'inventaire des « cogitata » Descartes découvrira en nous une idée d'infini, de perfectionabsolue, l'idée même de Dieu qui s'imposera elle aussi comme évidence ontologique et qui aura pour effetrécurrent de fonder l'évidence mathématique (un Dieu bon ne peut pas me tromper dans mes idées claires etdistinctes).
En ce sens, seule l'évidence ontologique fondera finalement l'évidence scientifique (« un athéene peut pas être géomètre »).
« ...
Cette proposition, je suis, j'existe est nécessairement vraie toutes les fois que je la conçois en monesprit...
»Le cogito ne se présente pas dans les Méditations de la même façon que dans le Discours de la Méthode oudans les Principes de philosophie.
Ici la première vérité n'est pas « je pense donc je suis » mais « je suis,j'existe ».
C'est que dans les Méditations l'ordre didactique, logique, cède le pas à l'ordre de la recherche etde la découverte.
Il ne s'agit pas ici pour Descartes de mettre en forme sa découverte, mais de nous faireparticiper au mouvement même de son esprit.
Or le cogito est avant tout découverte ontologique, Descartess'aperçoit de l'existence indubitable de son être.
C'est l'intuition de son être qui lui est livrée dans l'intuitionde sa pensée.
Je suis, dira Descartes, une res cogitans, une chose qui pense.
Il ne s'agit donc 'pas d'unidéalisme philosophique (de la découverte d'une cogitatio impersonnelle) mais d'un réalisme puisque je suisune chose pensante.
Cependant ce réalisme est un spiritualisme car cette chose qui est moi ne se définitque par l'esprit, que par la pensée.
Descartes dira plus loin : « La pensée est un attribut qui m'appartient :elle seule ne peut être détachée de moi » et il précise : « Je suis, j'existe, cela est certain ; mais combiende temps? A savoir autant de temps que je pense.
»« ...
Toutes les fois que je la prononce...
»Mon être s'identifie à ma pensée et ma pensée s'identifie à mon langage (concevoir le cogito est identique àle prononcer).
On peut rappeler ici la théorie cartésienne du langage (sur laquelle récemment le grandlinguiste Noam Chomsky attirait notre attention).
Pour Descartes le langage est ce qui distingueradicalement l'homme des animaux, car le langage est le signe de la pensée : le langage n'est pas la simplepossibilité d'émettre des sons mais l'aptitude à exprimer la pensée par des signes quelconques (un homme quipense clairement pourrait s'exprimer parfaitement en bas-breton, dit Descartes).
Le langage est l'expressionde la pensée, la prononciation réflète la conception.
(Conclusion)
Ce texte nous semble aussi important au point de vue méthodique qu'au point de vue doctrinal.a) Au point de vue méthodique il caractérise bien l'attitude philosophique : Nous y trouvons la conversionréflexive qui se détache de l'objet pensé pour se porter sur la pensée de l'objet, c'est-à-dire sur le sujetpensant.
b) II caractérise également l'attitude philosophique comme substitution du point de vue ontologique au pointde vue de l'objet (Descartes saisit ici l'être du sujet pensant au-delà de l'objet pensé).
c) Au point de vue doctrinal, il nous introduit dans le spiritualisme cartésien.
En ce sens, loin d'être aussirévolutionnaire qu'on l'a dit parfois, ce texte se rattache à une tradition philosophique, celle qui fait de laconnaissance immédiate de l'âme par elle-même la première et la plus sûre des connaissances, connaissancepropre à réfuter le scepticisme (saint Augustin avait déjà dit : « Si fallor sum ».
Si je suis trompé c'est quej'existe.
Cité de Dieu, livre XI, chap.
26) et à fonder la doctrine de l'immatérialité de l'âme..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Doute, certitude et vérité- une approche de Descartes
- Faut-il que le doute soit hyperbolique ?
- René Descartes (1596-1650): La méthode cartésienne Une métaphysique du doute Dieu, garant du monde physique
- Un doute hyperbolique est-il possible et souhaitable ?
- « Par intuition, j'entends non pas la confiance flottante que donnent les sens, ni le jugement trompeur de l'imagination aux constructions mauvaises, mais le concept que l'intelligence pure et attentive forme avec tant de facilité et de distinction qu'il ne reste absolument aucun doute sur ce que nous comprenons. » Descartes, Règles pour la direction de l'esprit, 1701 (posthume). Commentez.