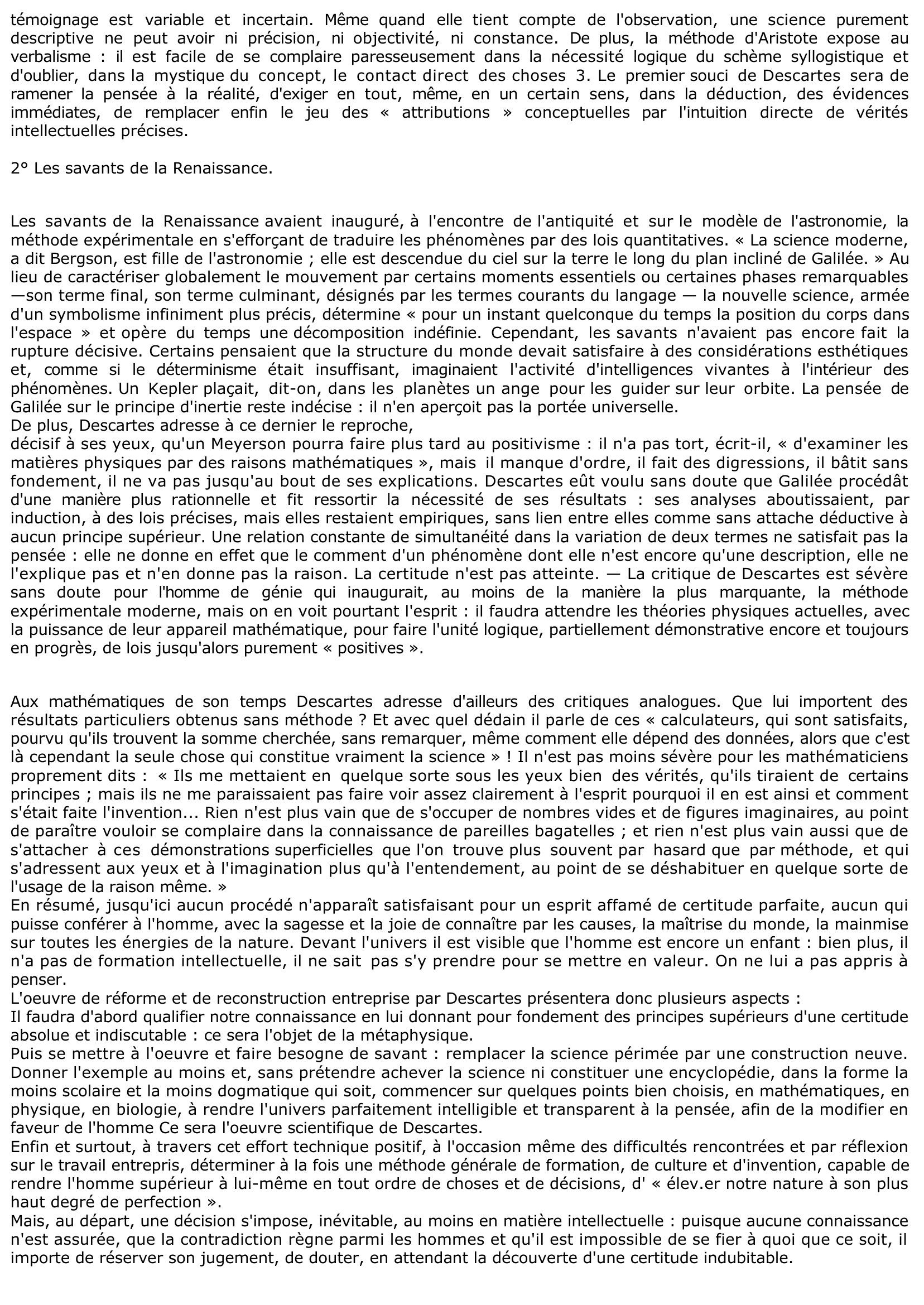DESCARTES EN FACE DU PASSÉ: Aristote. Les savants de la Renaissance
Publié le 23/06/2011
Extrait du document
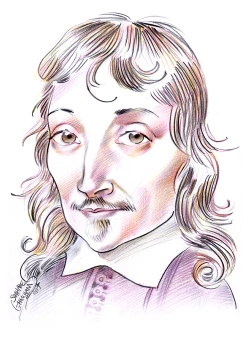
Pourquoi recherche-t-il la vérité ? Parce qu'il l'aime sans doute, et plus que tout autre, mais aussi par le sentiment douloureux qu'il ne la possède pas immédiatement dans sa plénitude, qu'elle est toujours menacée en lui par des influences irrationnelles, les impressions sensibles, l'imagination, les préjugés sociaux, et qu'il doit la conquérir par un effort personnel, dont il est seul responsable. Historiquement, d'où part-il ? De l'erreur, ou du moins d'une vérité incomplète et mêlée qui lui a été transmise à La Flèche. D'où l'importance des pages du Discours où il raconte, en forme de journal, son éducation. Si, comme Pascal, il reste conservateur en politique et en religion, si, au début de la recherche, par probité intellectuelle autant que par amour de la paix intérieure, et en attendant des lumières meilleures, il se conforme aux opinions courantes pourvu qu'elles soient modérées, son premier acte est de reconnaître l'insuffisance de la science officielle de son époque et de critiquer la méthode alors habituelle de penser. Il commence par s'inscrire en faux, par protester : il doute, il nie. Tout inventeur ne débute-t-il pas par rejeter les routines du passé et les idées régnantes ?
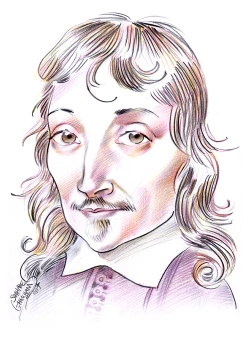
«
témoignage est variable et incertain.
Même quand elle tient compte de l'observation, une science purementdescriptive ne peut avoir ni précision, ni objectivité, ni constance.
De plus, la méthode d'Aristote expose auverbalisme : il est facile de se complaire paresseusement dans la nécessité logique du schème syllogistique etd'oublier, dans la mystique du concept, le contact direct des choses 3.
Le premier souci de Descartes sera deramener la pensée à la réalité, d'exiger en tout, même, en un certain sens, dans la déduction, des évidencesimmédiates, de remplacer enfin le jeu des « attributions » conceptuelles par l'intuition directe de véritésintellectuelles précises.
2° Les savants de la Renaissance.
Les savants de la Renaissance avaient inauguré, à l'encontre de l'antiquité et sur le modèle de l'astronomie, laméthode expérimentale en s'efforçant de traduire les phénomènes par des lois quantitatives.
« La science moderne,a dit Bergson, est fille de l'astronomie ; elle est descendue du ciel sur la terre le long du plan incliné de Galilée.
» Aulieu de caractériser globalement le mouvement par certains moments essentiels ou certaines phases remarquables—son terme final, son terme culminant, désignés par les termes courants du langage — la nouvelle science, arméed'un symbolisme infiniment plus précis, détermine « pour un instant quelconque du temps la position du corps dansl'espace » et opère du temps une décomposition indéfinie.
Cependant, les savants n'avaient pas encore fait larupture décisive.
Certains pensaient que la structure du monde devait satisfaire à des considérations esthétiqueset, comme si le déterminisme était insuffisant, imaginaient l'activité d'intelligences vivantes à l'intérieur desphénomènes.
Un Kepler plaçait, dit-on, dans les planètes un ange pour les guider sur leur orbite.
La pensée deGalilée sur le principe d'inertie reste indécise : il n'en aperçoit pas la portée universelle.De plus, Descartes adresse à ce dernier le reproche,décisif à ses yeux, qu'un Meyerson pourra faire plus tard au positivisme : il n'a pas tort, écrit-il, « d'examiner lesmatières physiques par des raisons mathématiques », mais il manque d'ordre, il fait des digressions, il bâtit sansfondement, il ne va pas jusqu'au bout de ses explications.
Descartes eût voulu sans doute que Galilée procédâtd'une manière plus rationnelle et fit ressortir la nécessité de ses résultats : ses analyses aboutissaient, parinduction, à des lois précises, mais elles restaient empiriques, sans lien entre elles comme sans attache déductive àaucun principe supérieur.
Une relation constante de simultanéité dans la variation de deux termes ne satisfait pas lapensée : elle ne donne en effet que le comment d'un phénomène dont elle n'est encore qu'une description, elle nel'explique pas et n'en donne pas la raison.
La certitude n'est pas atteinte.
— La critique de Descartes est sévèresans doute pour l'homme de génie qui inaugurait, au moins de la manière la plus marquante, la méthodeexpérimentale moderne, mais on en voit pourtant l'esprit : il faudra attendre les théories physiques actuelles, avecla puissance de leur appareil mathématique, pour faire l'unité logique, partiellement démonstrative encore et toujoursen progrès, de lois jusqu'alors purement « positives ».
Aux mathématiques de son temps Descartes adresse d'ailleurs des critiques analogues.
Que lui importent desrésultats particuliers obtenus sans méthode ? Et avec quel dédain il parle de ces « calculateurs, qui sont satisfaits,pourvu qu'ils trouvent la somme cherchée, sans remarquer, même comment elle dépend des données, alors que c'estlà cependant la seule chose qui constitue vraiment la science » ! Il n'est pas moins sévère pour les mathématiciensproprement dits : « Ils me mettaient en quelque sorte sous les yeux bien des vérités, qu'ils tiraient de certainsprincipes ; mais ils ne me paraissaient pas faire voir assez clairement à l'esprit pourquoi il en est ainsi et comments'était faite l'invention...
Rien n'est plus vain que de s'occuper de nombres vides et de figures imaginaires, au pointde paraître vouloir se complaire dans la connaissance de pareilles bagatelles ; et rien n'est plus vain aussi que des'attacher à ces démonstrations superficielles que l'on trouve plus souvent par hasard que par méthode, et quis'adressent aux yeux et à l'imagination plus qu'à l'entendement, au point de se déshabituer en quelque sorte del'usage de la raison même.
»En résumé, jusqu'ici aucun procédé n'apparaît satisfaisant pour un esprit affamé de certitude parfaite, aucun quipuisse conférer à l'homme, avec la sagesse et la joie de connaître par les causes, la maîtrise du monde, la mainmisesur toutes les énergies de la nature.
Devant l'univers il est visible que l'homme est encore un enfant : bien plus, iln'a pas de formation intellectuelle, il ne sait pas s'y prendre pour se mettre en valeur.
On ne lui a pas appris àpenser.L'oeuvre de réforme et de reconstruction entreprise par Descartes présentera donc plusieurs aspects :Il faudra d'abord qualifier notre connaissance en lui donnant pour fondement des principes supérieurs d'une certitudeabsolue et indiscutable : ce sera l'objet de la métaphysique.Puis se mettre à l'oeuvre et faire besogne de savant : remplacer la science périmée par une construction neuve.Donner l'exemple au moins et, sans prétendre achever la science ni constituer une encyclopédie, dans la forme lamoins scolaire et la moins dogmatique qui soit, commencer sur quelques points bien choisis, en mathématiques, enphysique, en biologie, à rendre l'univers parfaitement intelligible et transparent à la pensée, afin de la modifier enfaveur de l'homme Ce sera l'oeuvre scientifique de Descartes.Enfin et surtout, à travers cet effort technique positif, à l'occasion même des difficultés rencontrées et par réflexionsur le travail entrepris, déterminer à la fois une méthode générale de formation, de culture et d'invention, capable derendre l'homme supérieur à lui-même en tout ordre de choses et de décisions, d' « élev.er notre nature à son plushaut degré de perfection ».Mais, au départ, une décision s'impose, inévitable, au moins en matière intellectuelle : puisque aucune connaissancen'est assurée, que la contradiction règne parmi les hommes et qu'il est impossible de se fier à quoi que ce soit, ilimporte de réserver son jugement, de douter, en attendant la découverte d'une certitude indubitable..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Si pour Descartes aucune preuve n'est nécessaire, si l'expérience suffit c'est parce que l'évidence du libre-arbitre est liée à notre conscience. Être conscient c'est en effet se savoir être, se savoir exister, et donc être face à la réalité qui nous entoure : j'ai le choix de faire ou non des études, j'ai le choix de pratiquer ou non un sport etc. On voit ainsi qu'être un être conscient c'est se sentir libre. La conscience nous donne l'intuition de notre existence, de notre présence a
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655) Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.
- GASSENDI, abbé Pierre Gassend dit (1592-1655) Philosophe et mathématicien, adversaire de la philosophie d'Aristote et de Descartes, il est partisan d'une morale épicurienne, fondée sur le plaisir de la sérénité.
- La Renaissance et René Descartes
- BLAISE PASCAL: LA SOLUTION DES PHILOSOPHES FACE A LA MISERE DE L'HOMME: Epictète, Montaigne et Descartes