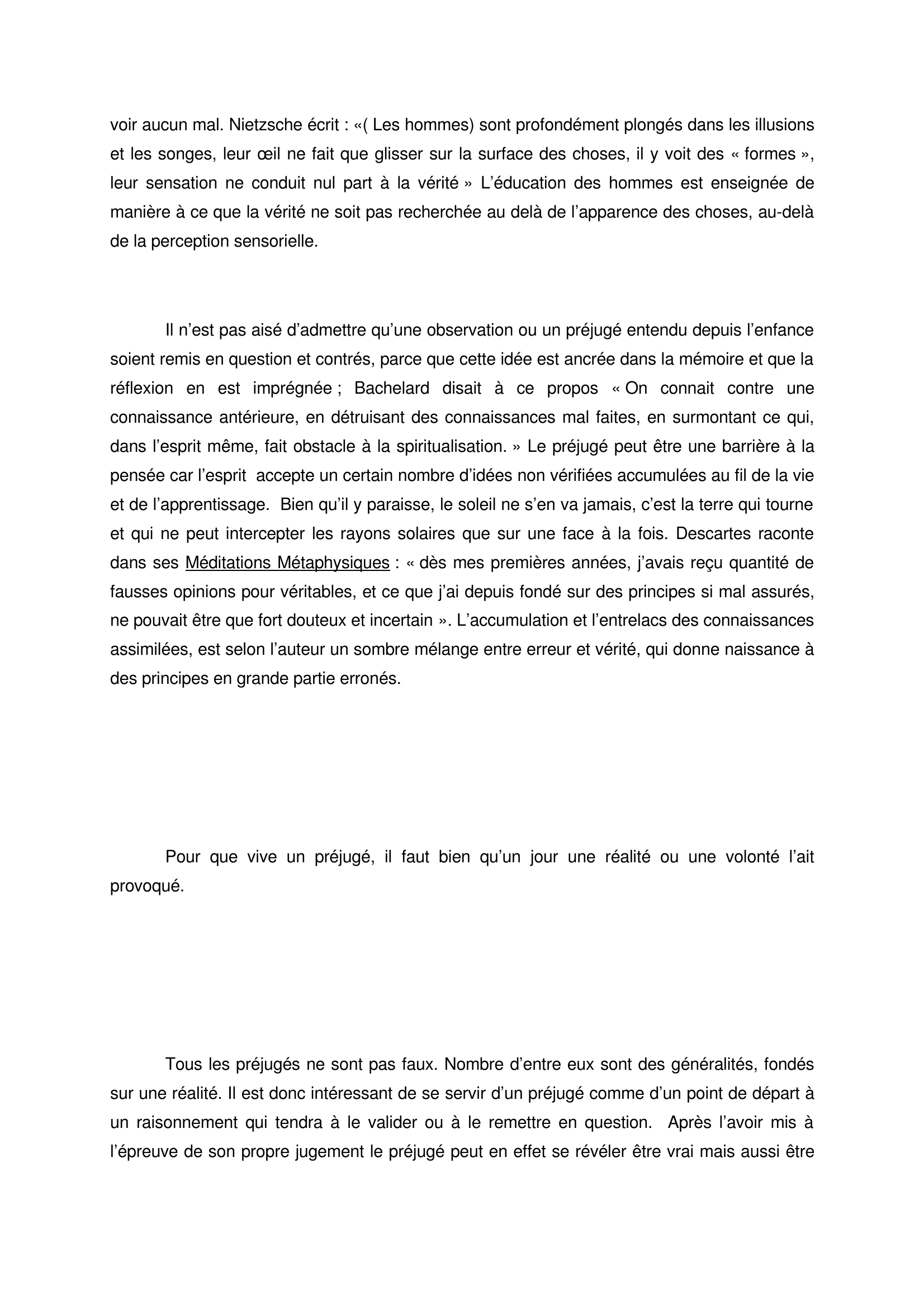dissert
Publié le 09/11/2012

Extrait du document
«
voir aucun mal. Nietzsche écrit : «( Les hommes) sont profond ément plong és dans les illusions
et les songes, leur œil ne fait que glisser sur la surface des choses, il y voit des « formes »,
leur sensation ne conduit nul part
à la v érité » L’ éducation des hommes est enseign ée de
mani
ère à ce que la v érité ne soit pas recherch ée au del à de l’apparence des choses, audel à
de la perception sensorielle.
Il n’est pas ais
é d’admettre qu’une observation ou un pr éjug é entendu depuis l’enfance
soient remis en question et contr
és, parce que cette id ée est ancr ée dans la m émoire et que la
r
éflexion en est impr égn ée ; Bachelard disait à ce propos « On connait contre une
connaissance ant
érieure, en d étruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui,
dans l’esprit m
ême, fait obstacle à la spiritualisation.
» Le pr éjug é peut être une barri ère à la
pens
ée car l’esprit accepte un certain nombre d’id ées non v érifi ées accumul ées au fil de la vie
et de l’apprentissage. Bien qu’il y paraisse, le soleil ne s’en va jamais, c’est la terre qui tourne
et qui ne peut intercepter les rayons solaires que sur une face
à la fois.
Descartes raconte
dans ses M
éditations M étaphysiques : « d ès mes premi ères ann ées, j’avais re çu quantit é de
fausses opinions pour v
éritables, et ce que j’ai depuis fond é sur des principes si mal assur és,
ne pouvait
être que fort douteux et incertain ». L’accumulation et l’entrelacs des connaissances
assimil
ées, est selon l’auteur un sombre m élange entre erreur et v érité, qui donne naissance à
des principes en grande partie erron
és.
Pour que vive un pr
éjug é, il faut bien qu’un jour une r éalit é ou une volont é l’ait
provoqu
é.
Tous les pr
éjug és ne sont pas faux. Nombre d’entre eux sont des g énéralit és, fond és
sur une r
éalit é. Il est donc int éressant de se servir d’un pr éjug é comme d’un point de d épart à
un raisonnement qui tendra
à le valider ou à le remettre en question.
Apr ès l’avoir mis à
l’
épreuve de son propre jugement le pr éjug é peut en effet se r évéler être vrai mais aussi être .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissert juste la fin du monde et la crise familiale
- Dissert-La Malade Imaginaire-Molière: en quoi Le Malade Imaginaire de Molière est conçu comme un spectacle complet ?
- Faut-il avoir peur de la technique ? (dissert)
- dissert
- Dissert