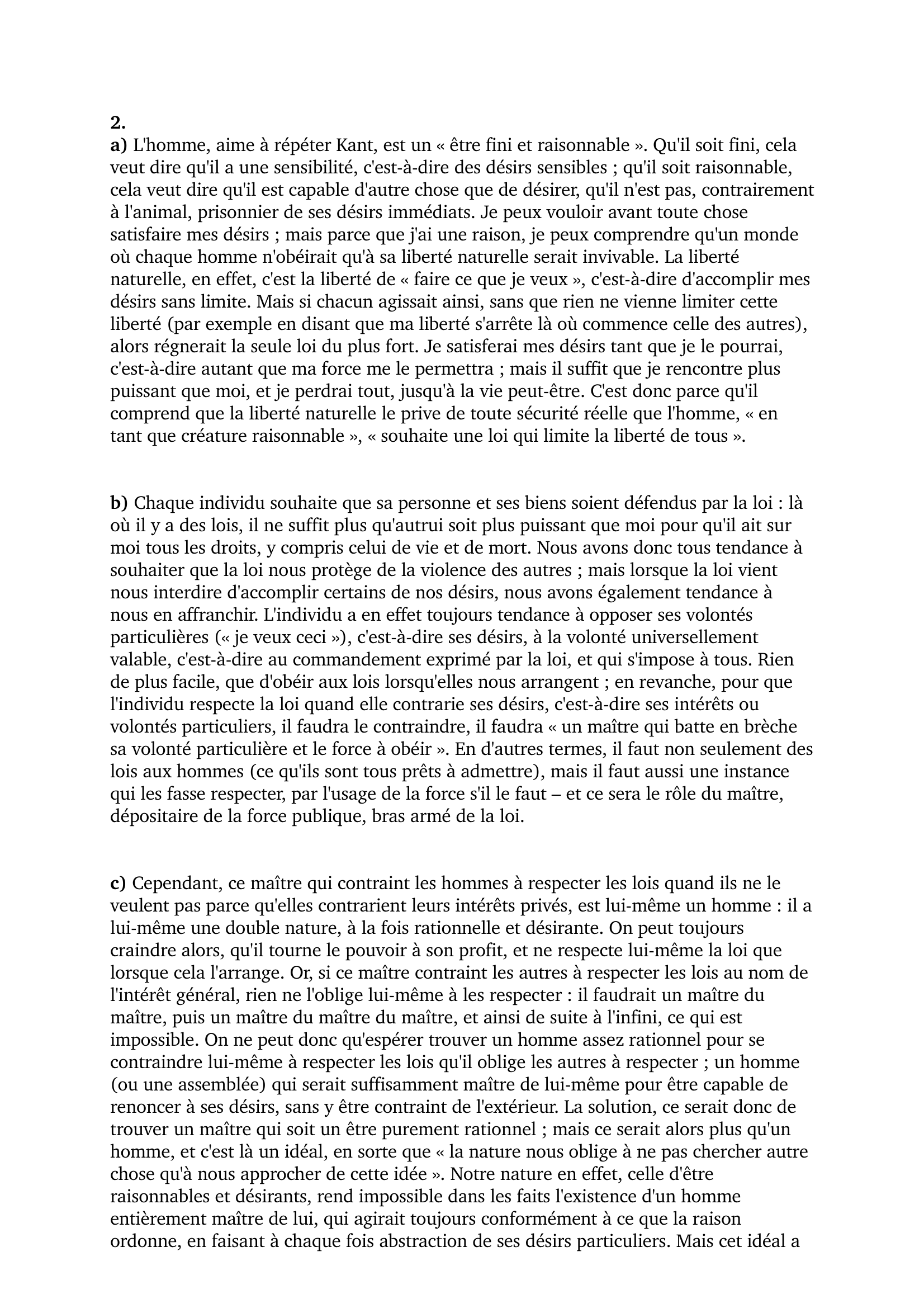etude de texte Kant
Publié le 03/02/2015

Extrait du document


«
2.
a) L'homme, aime à répéter Kant, est un « ê tre fini et raisonnable ». Qu'il soit fini, cela
veut dire qu'il a une sensibilit
é, c'est àdire des d ésirs sensibles ; qu'il soit raisonnable,
cela veut dire qu'il est capable d'autre chose que de d
ésirer, qu'il n'est pas, contrairement
à
l'animal, prisonnier de ses d ésirs imm édiats. Je peux vouloir avant toute chose
satisfaire mes d
ésirs ; mais parce que j'ai une raison, je peux comprendre qu'un monde
o
ù chaque homme n'ob éirait qu' à sa libert é naturelle serait invivable. La libert é
naturelle, en effet, c'est la libert
é de « faire ce que je veux », c'est àdire d'accomplir mes
d
ésirs sans limite. Mais si chacun agissait ainsi, sans que rien ne vienne limiter cette
libert
é (par exemple en disant que ma libert é s'arr ête l à où commence celle des autres),
alors r
égnerait la seule loi du plus fort. Je satisferai mes d ésirs tant que je le pourrai,
c'est
àdire autant que ma force me le permettra ; mais il suffit que je rencontre plus
puissant que moi, et je perdrai tout, jusqu'
à la vie peut être. C'est donc parce qu'il
comprend que la libert
é naturelle le prive de toute s écurit é réelle que l'homme, « en
tant que cr
éature raisonnable », « souhaite une loi qui limite la libert é de tous ».
b) Chaque individu souhaite que sa personne et ses biens soient d
éfendus par la loi : l à
o
ù il y a des lois, il ne suffit plus qu'autrui soit plus puissant que moi pour qu'il ait sur
moi tous les droits, y compris celui de vie et de mort. Nous avons donc tous tendance
à
souhaiter que la loi nous prot
ège de la violence des autres ; mais lorsque la loi vient
nous interdire d'accomplir certains de nos d
ésirs, nous avons également tendance à
nous en affranchir. L'individu a en effet toujours tendance
à opposer ses volont és
particuli
ères (« je veux ceci »), c'est àdire ses d ésirs, à la volont é universellement
valable, c'est
àdire au commandement exprim é par la loi, et qui s'impose à tous. Rien
de plus facile, que d'ob
éir aux lois lorsqu'elles nous arrangent ; en revanche, pour que
l'individu respecte la loi quand elle contrarie ses d
ésirs, c'est àdire ses int érêts ou
volont
és particuliers, il faudra le contraindre, il faudra « un ma ître qui batte en br èche
sa volont
é particuli ère et le force à ob éir ». En d'autres termes, il faut non seulement des
lois aux hommes (ce qu'ils sont tous pr
êts à admettre), mais il faut aussi une instance
qui les fasse respecter, par l'usage de la force s'il le faut – et ce sera le r
ôle du ma ître,
d
épositaire de la force publique, bras arm é de la loi.
c) Cependant, ce ma
ître qui contraint les hommes à respecter les lois quand ils ne le
veulent pas parce qu'elles contrarient leurs int
érêts priv és, est luim ême un homme : il a
luim
ême une double nature, à la fois rationnelle et d ésirante. On peut toujours
craindre alors, qu'il tourne le pouvoir
à son profit, et ne respecte luim ême la loi que
lorsque cela l'arrange. Or, si ce ma
ître contraint les autres à respecter les lois au nom de
l'int
érêt g énéral, rien ne l'oblige luim ême à les respecter : il faudrait un ma ître du
ma
ître, puis un ma ître du ma ître du ma ître, et ainsi de suite à l'infini, ce qui est
impossible. On ne peut donc qu'esp
érer trouver un homme assez rationnel pour se
contraindre luim
ême à respecter les lois qu'il oblige les autres à respecter ; un homme
(ou une assembl
ée) qui serait suffisamment ma ître de luim ême pour être capable de
renoncer
à ses d ésirs, sans y être contraint de l'ext érieur. La solution, ce serait donc de
trouver un ma
ître qui soit un être purement rationnel ; mais ce serait alors plus qu'un
homme, et c'est l
à un id éal, en sorte que « la nature nous oblige à ne pas chercher autre
chose qu'
à nous approcher de cette id ée ». Notre nature en effet, celle d' être
raisonnables et d
ésirants, rend impossible dans les faits l'existence d'un homme
enti
èrement ma ître de lui, qui agirait toujours conform ément à ce que la raison
ordonne, en faisant
à chaque fois abstraction de ses d ésirs particuliers. Mais cet id éal a .
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- Bel-Ami, Etude de texte n°2, chapitre 2
- Kant, REFLEXION SUR L'EDUCATION - Explication de texte
- Explication de texte, Réflexions sur l'éducation de Kant