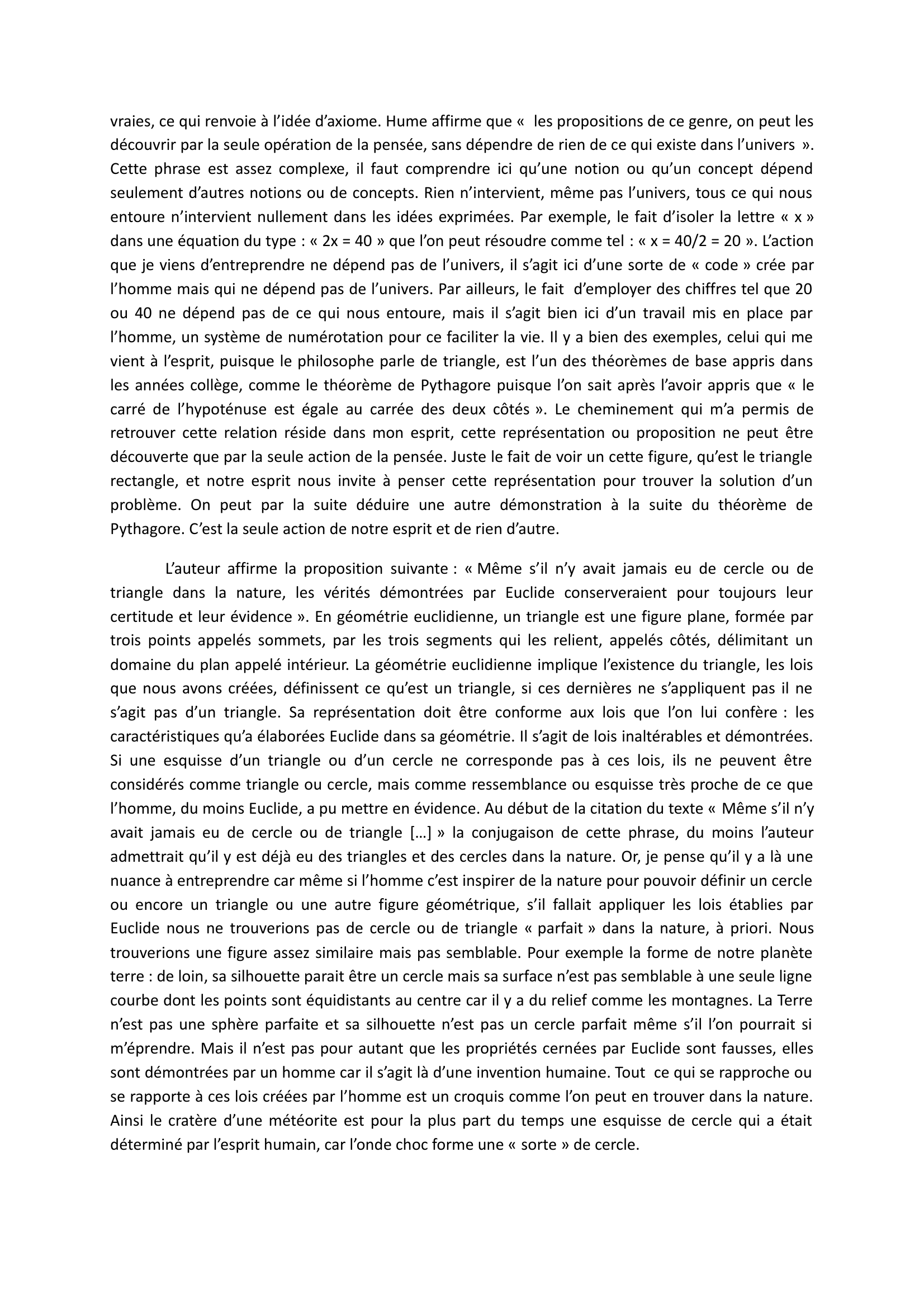Explication de texte: David Hume - Traité de la nature Humain
Publié le 10/09/2013

Extrait du document
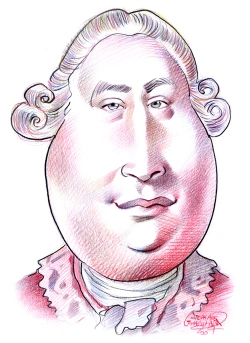
Ce document est un extrait d’un texte philosophique de David Hume, philosophe écossais du
XVIIe qui s’intitule Traité de la nature Humain qui est un essai en trois volumes qui fut publié en 1739-
1740. Ici, l’auteur traite les objets de la raison humaine. Il émet l’affirmation suivante : que tous ces
objets de la raison humaine peuvent être divisés en deux genres ou catégories, les relations d’idées et
les faits. Le philosophe commence par préciser et définir ce que sont les relations d’idées, il prétend
que ce sont des affirmations établies de manière démonstrative et qui ne relève de rien de ce qui
existe dans notre univers. Dans la seconde partie de l’extrait du texte l’auteur distingue de ce premier
genre, que sont les relations d’idées, les faits dont la réalité n’est pas analogue à ces dernières. Ainsi
nous allons mettre en évidence ce que l’auteur cherche à nous expliquer au travers de ce texte et
exposer ainsi l’opposition entre ces deux genres que le philosophe cherche à nous démontrer.
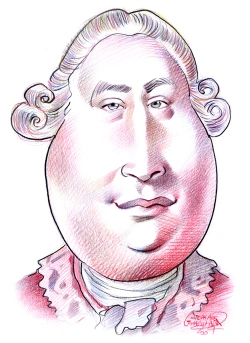
«
vraies, ce qui renvoie à l’idée d’axiome.
Hume affirme que « les propositions de ce genre, on peut les
découvrir par la seule opération de la pensée, sans dépendre de rien de ce qui existe dans l’univers ».
Cette phrase est assez complexe, il faut comprendre ici qu’une notion ou qu’un concept dépend
seulement d’autres notions ou de concepts.
Rien n’intervient, même pas l’univers, tous ce qui nous
entoure n’intervient nullement dans les idées exprimées.
Par exemple, le fait d’isoler la lettre « x »
dans une équation du type : « 2x = 40 » que l’on peut résoudre comme tel : « x = 40/2 = 20 ».
L’action
que je viens d’entreprendre ne dépend pas de l’univers, il s’agit ici d’une sorte de « code » crée par
l’homme mais qui ne dépend pas de l’univers.
Par ailleurs, le fait d’employer des chiffres tel que 20
ou 40 ne dépend pas de ce qui nous entoure, mais il s’agit bien ici d’un travail mis en place par
l’homme, un système de numérotation pour ce faciliter la vie.
Il y a bien des exemples, celui qui me
vient à l’esprit, puisque le philosophe parle de triangle, est l’un des théorèmes de base appris dans
les années collège, comme le théorème de Pythagore puisque l’on sait après l’avoir appris que « le
carré de l’hypoténuse est égale au carrée des deux côtés ».
Le cheminement qui m’a permis de
retrouver cette relation réside dans mon esprit, cette représentation ou proposition ne peut être
découverte que par la seule action de la pensée.
Juste le fait de voir un cette figure, qu’est le triangle
rectangle, et notre esprit nous invite à penser cette représentation pour trouver la solution d’un
problème.
On peut par la suite déduire une autre démonstration à la suite du théorème de
Pythagore.
C’est la seule action de notre esprit et de rien d’autre.
L’auteur affirme la proposition suivante : « Même s’il n’y avait jamais eu de cercle ou de
triangle dans la nature, les vérités démontrées par Euclide conserveraient pour toujours leur
certitude et leur évidence ».
En géométrie euclidienne, un triangle est une figure plane, formée par
trois points appelés sommets, par les trois segments qui les relient, appelés côtés, délimitant un
domaine du plan appelé intérieur.
La géométrie euclidienne implique l’existence du triangle, les lois
que nous avons créées, définissent ce qu’est un triangle, si ces dernières ne s’appliquent pas il ne
s’agit pas d’un triangle.
Sa représentation doit être conforme aux lois que l’on lui confère : les
caractéristiques qu’a élaborées Euclide dans sa géométrie.
Il s’agit de lois inaltérables et démontrées.
Si une esquisse d’un triangle ou d’un cercle ne corresponde pas à ces lois, ils ne peuvent être
considérés comme triangle ou cercle, mais comme ressemblance ou esquisse très proche de ce que
l’homme, du moins Euclide, a pu mettre en évidence.
Au début de la citation du texte « Même s’il n’y
avait jamais eu de cercle ou de triangle […] » la conjugaison de cette phrase, du moins l’auteur
admettrait qu’il y est déjà eu des triangles et des cercles dans la nature.
Or, je pense qu’il y a là une
nuance à entreprendre car même si l’homme c’est inspirer de la nature pour pouvoir définir un cercle
ou encore un triangle ou une autre figure géométrique, s’il fallait appliquer les lois établies par
Euclide nous ne trouverions pas de cercle ou de triangle « parfait » dans la nature, à priori.
Nous
trouverions une figure assez similaire mais pas semblable.
Pour exemple la forme de notre planète
terre : de loin, sa silhouette parait être un cercle mais sa surface n’est pas semblable à une seule ligne
courbe dont les points sont équidistants au centre car il y a du relief comme les montagnes.
La Terre
n’est pas une sphère parfaite et sa silhouette n’est pas un cercle parfait même s’il l’on pourrait si
m’éprendre.
Mais il n’est pas pour autant que les propriétés cernées par Euclide sont fausses, elles
sont démontrées par un homme car il s’agit là d’une invention humaine.
Tout ce qui se rapproche ou
se rapporte à ces lois créées par l’homme est un croquis comme l’on peut en trouver dans la nature.
Ainsi le cratère d’une météorite est pour la plus part du temps une esquisse de cercle qui a était
déterminé par l’esprit humain, car l’onde choc forme une « sorte » de cercle..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication de texte : Traité de la nature Humain de David HUME
- explication texte David Hume traité de la nature humaine
- DAVID HUME : Enquête sur l'entendement humain - Traité de la nature humaine. Essai pour introduire la méthode expérimentale dans les sujets moraux
- David Hume - Sur la diversité des goûts - méthode de l'explication de texte
- TRAITÉ DE LA NATURE HUMAINE, A Treatise of Human Nature de David Hume (résumé & analyse)