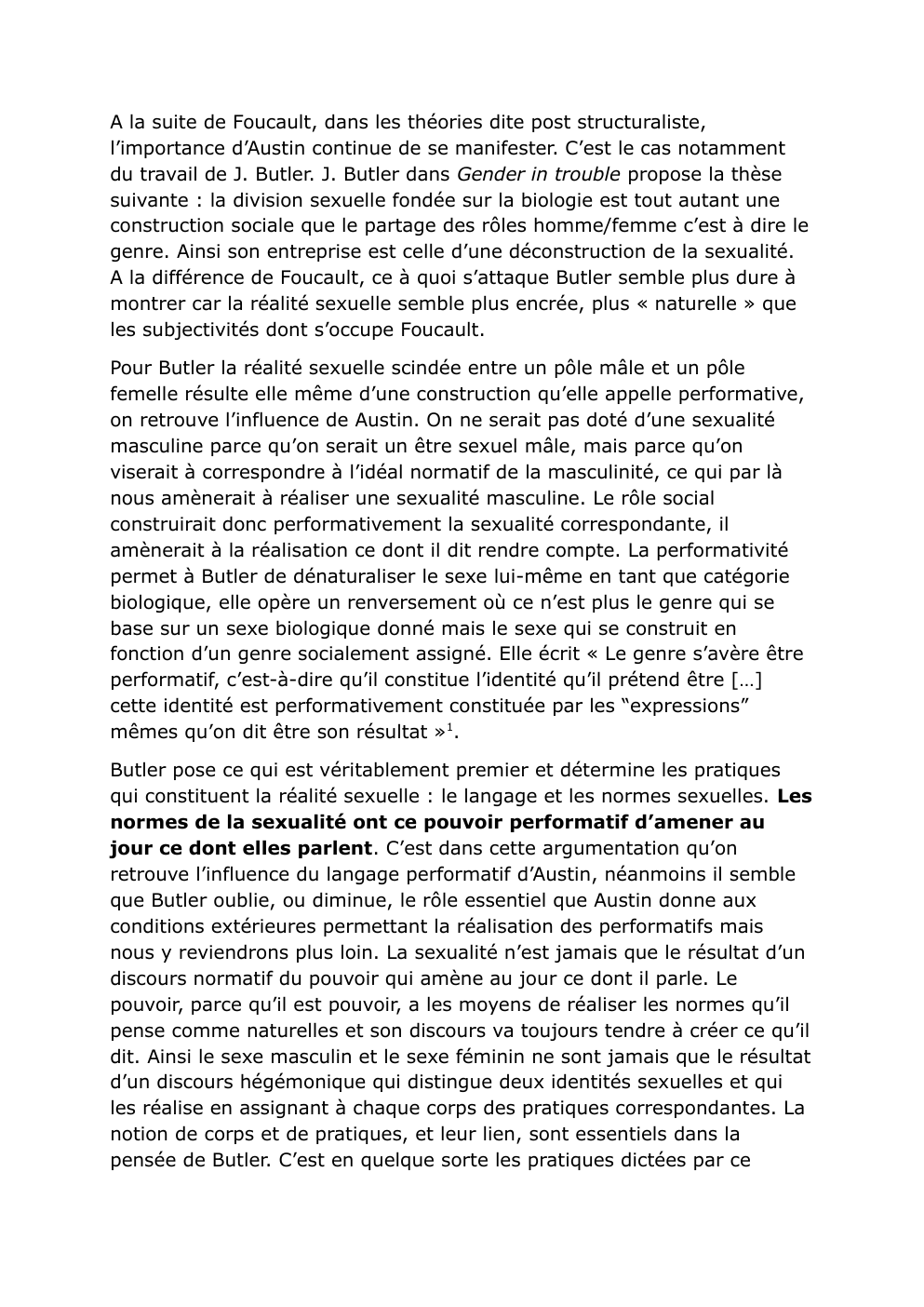Explication de texte sur Judith Butler
Publié le 07/04/2025
Extrait du document
«
A la suite de Foucault, dans les théories dite post structuraliste,
l’importance d’Austin continue de se manifester.
C’est le cas notamment
du travail de J.
Butler.
J.
Butler dans Gender in trouble propose la thèse
suivante : la division sexuelle fondée sur la biologie est tout autant une
construction sociale que le partage des rôles homme/femme c’est à dire le
genre.
Ainsi son entreprise est celle d’une déconstruction de la sexualité.
A la différence de Foucault, ce à quoi s’attaque Butler semble plus dure à
montrer car la réalité sexuelle semble plus encrée, plus « naturelle » que
les subjectivités dont s’occupe Foucault.
Pour Butler la réalité sexuelle scindée entre un pôle mâle et un pôle
femelle résulte elle même d’une construction qu’elle appelle performative,
on retrouve l’influence de Austin.
On ne serait pas doté d’une sexualité
masculine parce qu’on serait un être sexuel mâle, mais parce qu’on
viserait à correspondre à l’idéal normatif de la masculinité, ce qui par là
nous amènerait à réaliser une sexualité masculine.
Le rôle social
construirait donc performativement la sexualité correspondante, il
amènerait à la réalisation ce dont il dit rendre compte.
La performativité
permet à Butler de dénaturaliser le sexe lui-même en tant que catégorie
biologique, elle opère un renversement où ce n’est plus le genre qui se
base sur un sexe biologique donné mais le sexe qui se construit en
fonction d’un genre socialement assigné.
Elle écrit « Le genre s’avère être
performatif, c’est-à-dire qu’il constitue l’identité qu’il prétend être […]
cette identité est performativement constituée par les “expressions”
mêmes qu’on dit être son résultat »1.
Butler pose ce qui est véritablement premier et détermine les pratiques
qui constituent la réalité sexuelle : le langage et les normes sexuelles.
Les
normes de la sexualité ont ce pouvoir performatif d’amener au
jour ce dont elles parlent.
C’est dans cette argumentation qu’on
retrouve l’influence du langage performatif d’Austin, néanmoins il semble
que Butler oublie, ou diminue, le rôle essentiel que Austin donne aux
conditions extérieures permettant la réalisation des performatifs mais
nous y reviendrons plus loin.
La sexualité n’est jamais que le résultat d’un
discours normatif du pouvoir qui amène au jour ce dont il parle.
Le
pouvoir, parce qu’il est pouvoir, a les moyens de réaliser les normes qu’il
pense comme naturelles et son discours va toujours tendre à créer ce qu’il
dit.
Ainsi le sexe masculin et le sexe féminin ne sont jamais que le résultat
d’un discours hégémonique qui distingue deux identités sexuelles et qui
les réalise en assignant à chaque corps des pratiques correspondantes.
La
notion de corps et de pratiques, et leur lien, sont essentiels dans la
pensée de Butler.
C’est en quelque sorte les pratiques dictées par ce
pouvoir, via des discours, qui fonde le corps masculin ou féminin.
Néanmoins, comment peut-on expliquer le pouvoir du discours normatif ?
Il faut expliquer cette autorité, cette efficacité du discours qui créer des
corps.
Le discours tire son pouvoir du voilement de son absence d’origine
par sa réitération constante d’un appel à l’autorité : le pouvoir n’est fondé
sur rien d’autre qu’un appel à lui-même, par rien d’autre que par une
autoréférence.
D’une certaine façon, le pouvoir s’autofonde
performativement en ne cessant de se faire valoir comme pouvoir.
Le
pouvoir ne cesse de se construire, de se légitimer, se relégitimer, de se
donner vie (et par là il est conscient de sa faiblesse).
Les pratiques
sexuelles sont dès lors pensées comme pratiques réalisant
performativement l’identité sexuelle en ce qu’elles citent les normes
qu’elles réalisent ou auxquelles elles se conforment, c’est l’autoréférence
dont on parlait.
Elle reprend ici une idée de Derrida selon laquelle le
discours performatif n’est jamais que répétition citationnelle de lui
même et tire de là son pouvoir.
En somme, accomplissant une
quelconque pratique sexuelle particulière, j’opérerais une sexuation
particulière de mon corps parce que, ce faisant, je citerais la norme qui
gouverne et institue cette pratique, et la re-fonderais à nouveau en m’y
soumettant.
La pratique sexuelle n’est donc que répétition d’une norme
qui se donne comme fondée en autorité.
Par là, la pratique s’autofonde et
fonde l’identité qu’elle réalise.
Cependant cela laisse une brèche, la
répétition est toujours suspendue, doit être faite, refaite, cette itérabilité
n’est jamais fini, jamais stable et ainsi la performativité ne doit jamais
cesser de se réaliser.
Cela laisse de l’espace à ce que Butler appellent la
subversion de l’identité, le fait de réaliser des pratiques sortant de
ce que les normes nous impose, qui brouille les pistes, vont à contre
courant.
En ce sens elle prend l’exemple du drag.
De plus il faut que la
performativité du genre soit prise au sérieux.
Il y a quelque chose
d’intéressant, quand elle marque cette importante de la prise au sérieux
de l’acte qu’on réalise.
C’est évidement en rapport à Austin et aux
conventions nécessaires au succès du performatif.
Cependant ce rappel de
la nécessité des conventions semble en décalage à l’importance qu’elle
donne à l’autoréférencement du performatif.
D’un côté elle dit l’importance
de l’autoréférence, donc que le succès du performatif se joue dans un
rapport intérieur, de l’autre elle explique le rôle de la prise au sérieux par
les autres et donc l’importance de l’extérieur.
Ce n’est pas forcement
contradictoire, on pourrait dire que le pouvoir a à la fois besoin
d’autoréférencement, d’une ré-légitimation permanente pour continuer à
exister et que cette ré-légitimation se joue dans les pratiques des
individus, qui formerait les corps, et en même temps dire qu’il y a une
importance à ce que les autres membres de la société reconnaissent ces
actes qui relégitiment le pouvoir afin....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- Explication de texte : « Qu’est-ce que le Moi » Pascal
- Explication de texte autour d'un extrait de l'ouvrage Le poète et l'activité de la fantaisie, de Sigmund Freud
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- platon georgias explication de texte 483B 484