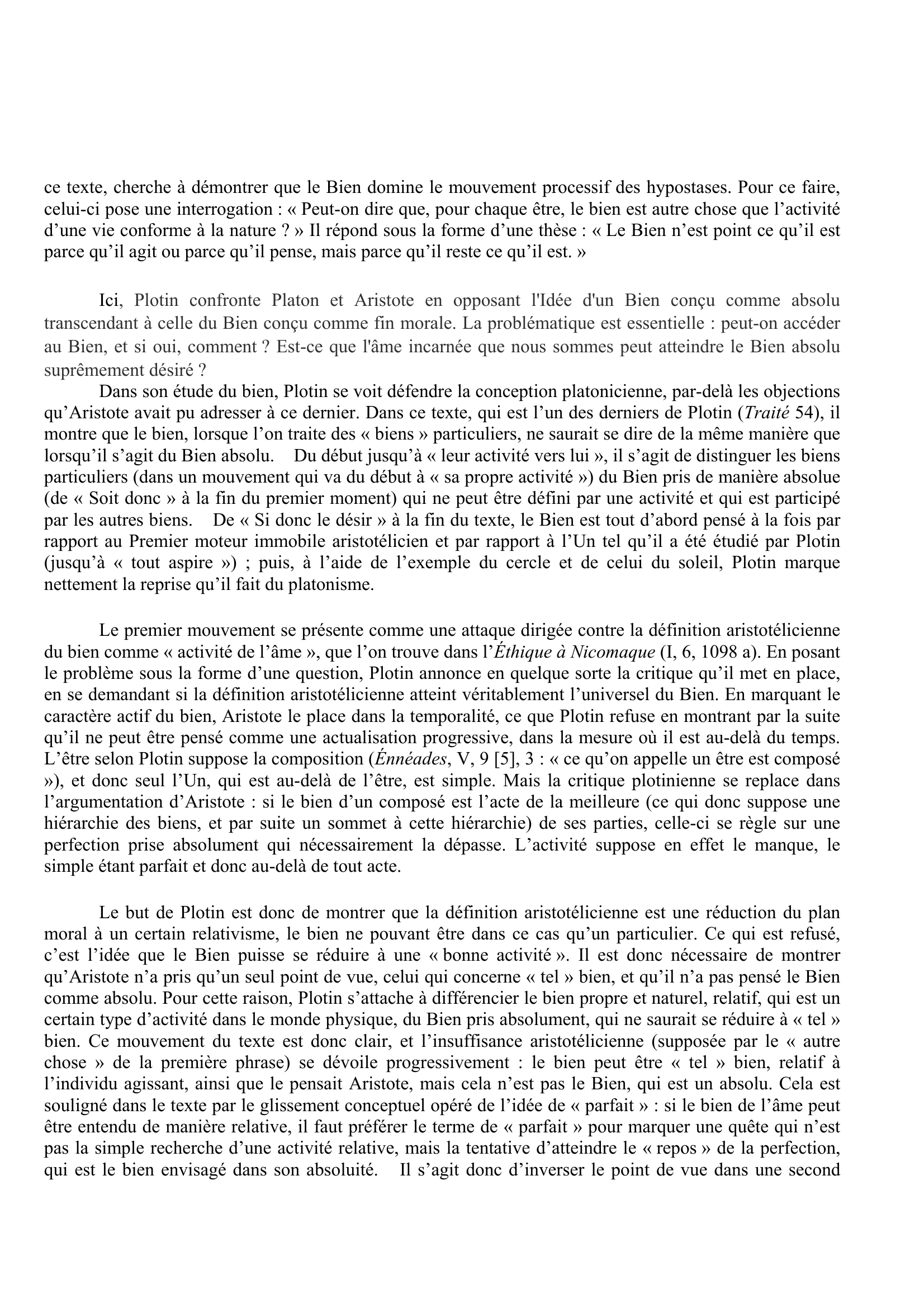Explication d'un texte de Plotin sur le Bien
Publié le 14/12/2012

Extrait du document
« Peut-on dire que, pour chaque être, le bien est autre chose que l’activité d’une vie conforme à la nature ? Si un être est composé de plusieurs parties, son bien est l’acte propre, naturel et non déficient de la meilleure de ses parties. Donc le bien naturel, pour l’âme, c’est sa propre activité. Mais voici une âme qui tend son activité vers le parfait, parce qu’elle est elle-même parfaite ; son bien n’est plus seulement relatif à elle, il est le Bien pris absolument. Soit donc une chose qui ne tende vers aucune autre parce qu’elle est elle-même le meilleur des êtres, parce qu’elle est même au-delà des êtres, mais vers qui tendent les autres ; c’est évidemment le Bien, grâce à qui les autres êtres ont leur part de bien. Et tous les êtres qui participent ainsi au Bien le font de deux manières différentes, ou bien en devenant semblables à lui, ou bien en dirigeant leur activité vers lui. Si donc le désir et l’activité se dirigent vers le Souverain Bien, le Bien lui-même ne doit viser à rien et ne rien désirer ; immobile, il est la source et le principe des actes conformes à la nature ; il donne aux choses la forme du bien, mais non pas en dirigeant son action vers elles ; ce sont elles qui tendent vers lui ; le Bien n’est point ce qu’il est parce qu’il agit ou parce qu’il pense, mais parce qu’il reste ce qu’il est. Puisqu’il est au-delà de l’être, il est au-delà de l’acte, de l’intelligence et de la pensée. Encore une fois, c’est la chose à laquelle tout est suspendu, mais qui n’est suspendue à rien ; il est ainsi la réalité à laquelle tout aspire. Il doit donc rester immobile, et tout se tourne vers lui comme les points d’un cercle se tournent vers le centre d’où partent tous les rayons. Le soleil en est une image ; il est comme un centre pour la lumière qui se rattache à lui ; aussi est-elle partout avec lui ; elle ne se coupe pas en tronçons ; voulez-vous couper en deux un rayon lumineux [par un écran], la lumière reste d’un seul côté, du côté du soleil. «
Plotin, Énnéades, I, 7 [54], 1, trad. É. Bréhier, Les Belles Lettres, Paris, 1997.
L’œuvre de Plotin (ses cours pris sous la dictée du Maître par son disciple Porphyre et publiés) comprend 54 traités qui seront réunis en six Énnéades, c’est-à-dire en groupes de neuf traités. Le texte ici présenté, extrait du septième traité de la première Énnéade, Du Bien, nous donne le thème essentiel de la morale métaphysique plotinienne. Il ne peut se comprendre pleinement qu’à partir de l’œuvre de Platon, d’Aristote, des Stoïciens dont Plotin opère une synthèse personnelle. (N’oublions pas que Plotin, 204-269, enseigne au troisième siècle après Jésus-Christ.)
Ce texte a un caractère démonstratif. En effet, tout au long du texte, Plotin, par un jeu de questions et de réponses, cherche à prouver l’exactitude d’une conclusion en s’appuyant préalablement sur des prémisses considérées comme certaines. Pour mener à bien sa démonstration, Plotin s’inspire dans ce texte, mais également dans l’ensemble des traités, de la dialectique platonicienne, c’est-à-dire du mouvement qui vise à l’ascension vers des vérités universelles. De ce fait, le procédé démonstratif de Plotin est un dialogue, où à chaque question il pose la thèse de ses adversaires, et où à chaque réponse il présente sa propre thèse en y ajoutant une argumentation qui sert de réfutation. Ainsi, de questions en questions ses arguments s’enrichissent, et la conclusion finale se fait presque d’elle-même.
«
ce texte, cherche à démontrer que le Bien domine le mouvement processif des hypostases.
Pour ce faire,
celui-ci pose une interrogation : « Peut -on dire que, pour chaque être, le bien est autre chose que l’activité
d’une vie conforme à la nature ? » Il répond sous la forme d’une thèse : « Le Bien n ’est point ce qu’il est
parce qu’il agit ou parce qu’il pense, mais parce qu’il reste ce qu’il est.
»
Ici, Plotin confronte Platon et Aristote en opposant l'Idée d'un Bien conçu comme absolu
transcendant à celle du Bien conçu comme fin morale.
La problém atique est essentielle : peut-on accéder
au Bien, et si oui, comment ? Est -ce que l'âme incarnée que nous sommes peut atteindre le Bien absolu
suprêmement désiré ?
Dans son étude du bien, Plotin se voit défendre la conception platonicienne, par -delà les objections
qu’Aristote avait pu adresser à ce dernier.
Dans ce texte, qui est l’un des derniers de Plotin ( Traité 54), il
montre que le bien, lorsque l’on traite des « biens » particuliers, ne saurait se dire de la même manière que
lorsqu’il s’agit du Bien absolu.
Du début jusqu’à « leur activité vers lui », il s’agit de distinguer les biens
particuliers (dans un mouvement qui va du début à « sa propre activité ») du Bien pris de manière absolue
(de « Soit donc » à la fin du premier moment) qui ne peut êtr e défini par une activité et qui est participé
par les autres biens.
De « Si donc le désir » à la fin du texte, le Bien est tout d’abord pensé à la fois par
rapport au Premier moteur immobile aristotélicien et par rapport à l’Un tel qu’il a été étudié par Plotin
(jusqu’à « tout aspire ») ; puis, à l’aide de l’exemple du cercle et de celui du soleil, Plotin marque
nettement la reprise qu’il fait du platonisme.
Le premier mouvement se présente comme une attaque dirigée contre la définition aristotélicienne
du bien comme « activité de l’âme », que l’on trouve dans l’ Éthique à Nicomaque (I, 6, 1098 a).
En posant
le problème sous la forme d’une question, Plotin annonce en quelque sorte la critique qu’il met en place,
en se demandant si la définition aristotéli cienne atteint véritablement l’universel du Bien.
En marquant le
caractère actif du bien, Aristote le place dans la temporalité, ce que Plotin refuse en montrant par la suite
qu’il ne peut être pensé comme une actualisation progressive, dans la mesure où i l est au-delà du temps.
L’être selon Plotin suppose la composition ( Énnéades, V, 9 [5], 3 : « ce qu’on appelle un être est composé
»), et donc seul l’Un, qui est au -delà de l’être, est simple.
Mais la critique plotinienne se replace dans
l’argumentation d’ Aristote : si le bien d’un composé est l’acte de la meilleure (ce qui donc suppose une
hiérarchie des biens, et par suite un sommet à cette hiérarchie) de ses parties, celle- ci se règle sur une
perfection prise absolument qui nécessairement la dépasse.
L’activité suppose en effet le manque, le
simple étant parfait et donc au -delà de tout acte.
Le but de Plotin est donc de montrer que la définition aristotélicienne est une réduction du plan
moral à un certain relativisme, le bien ne pouvant être dans ce ca s qu’un particulier.
Ce qui est refusé,
c’est l’idée que le Bien puisse se réduire à une « bonne activité ».
Il est donc nécessaire de montrer
qu’Aristote n’a pris qu’un seul point de vue, celui qui concerne « tel » bien, et qu’il n’a pas pensé le Bien
com me absolu.
Pour cette raison, Plotin s’attache à différencier le bien propre et naturel, relatif, qui est un
certain type d’activité dans le monde physique, du Bien pris absolument, qui ne saurait se réduire à « tel »
bien.
Ce mouvement du texte est donc c lair, et l’insuffisance aristotélicienne (supposée par le « autre
chose » de la première phrase) se dévoile progressivement : le bien peut être « tel » bien, relatif à
l’individu agissant, ainsi que le pensait Aristote, mais cela n’est pas le Bien, qui est un absolu.
Cela est
souligné dans le texte par le glissement conceptuel opéré de l’idée de « parfait » : si le bien de l’âme peut
être entendu de manière relative, il faut préférer le terme de « parfait » pour marquer une quête qui n’est
pas la simple recherche d’une activité relative, mais la tentative d’atteindre le « repos » de la perfection,
qui est le bien envisagé dans son absoluité.
Il s’agit donc d’inverser le point de vue dans une second.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- M Vergeade Philosophie : Explication du texte janv.21 Les idées et les âges (1927)P 102 -Manuel Delagrave -P 427-
- Explication de texte : « Qu’est-ce que le Moi » Pascal
- Explication de texte autour d'un extrait de l'ouvrage Le poète et l'activité de la fantaisie, de Sigmund Freud
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- platon georgias explication de texte 483B 484