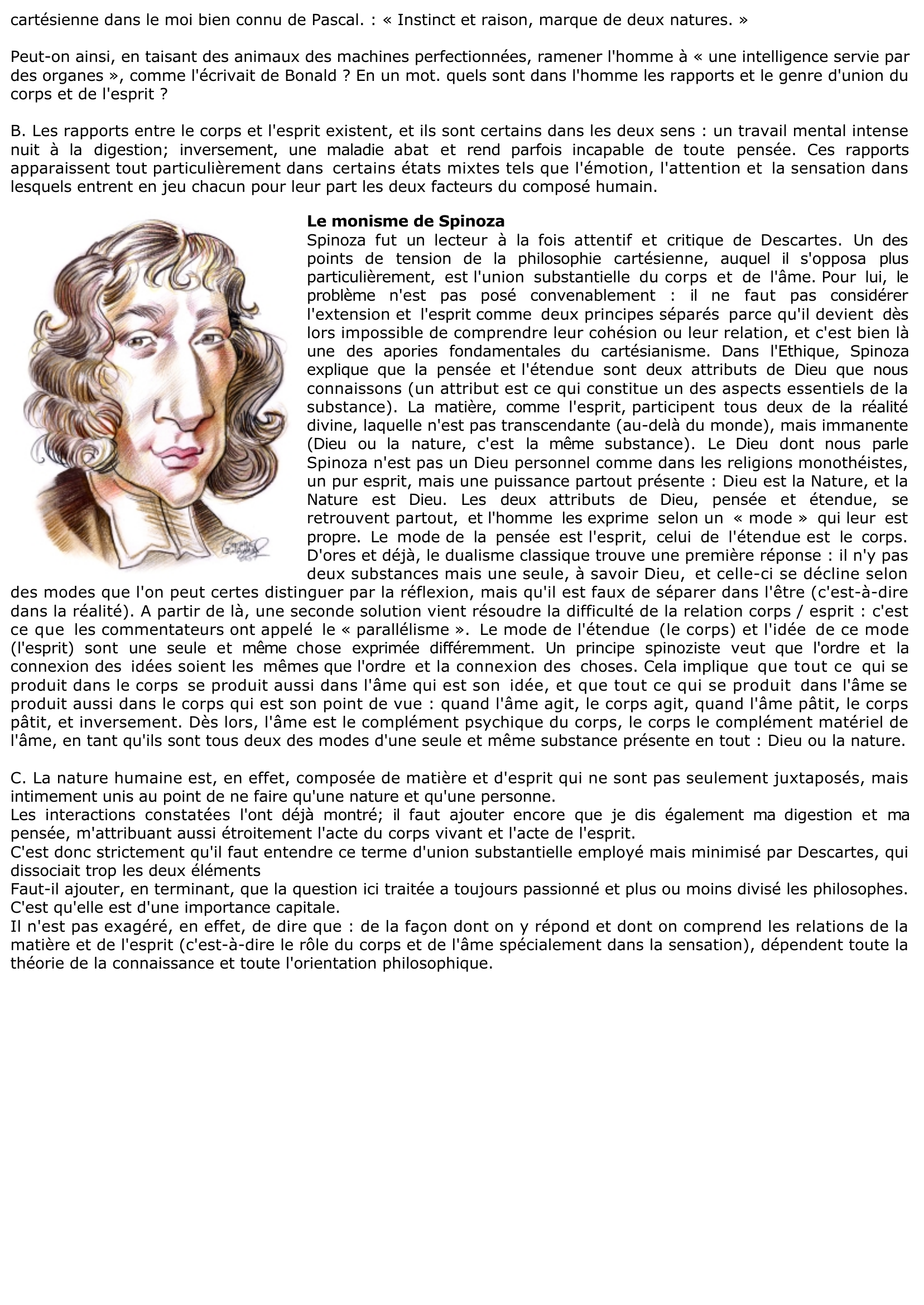Faut-il opposer l'esprit et la matière ?
Publié le 17/03/2004

Extrait du document


«
cartésienne dans le moi bien connu de Pascal.
: « Instinct et raison, marque de deux natures.
»
Peut-on ainsi, en taisant des animaux des machines perfectionnées, ramener l'homme à « une intelligence servie pardes organes », comme l'écrivait de Bonald ? En un mot.
quels sont dans l'homme les rapports et le genre d'union ducorps et de l'esprit ?
B.
Les rapports entre le corps et l'esprit existent, et ils sont certains dans les deux sens : un travail mental intensenuit à la digestion; inversement, une maladie abat et rend parfois incapable de toute pensée.
Ces rapportsapparaissent tout particulièrement dans certains états mixtes tels que l'émotion, l'attention et la sensation danslesquels entrent en jeu chacun pour leur part les deux facteurs du composé humain.
Le monisme de SpinozaSpinoza fut un lecteur à la fois attentif et critique de Descartes.
Un despoints de tension de la philosophie cartésienne, auquel il s'opposa plusparticulièrement, est l'union substantielle du corps et de l'âme.
Pour lui, leproblème n'est pas posé convenablement : il ne faut pas considérerl'extension et l'esprit comme deux principes séparés parce qu'il devient dèslors impossible de comprendre leur cohésion ou leur relation, et c'est bien làune des apories fondamentales du cartésianisme.
Dans l'Ethique, Spinozaexplique que la pensée et l'étendue sont deux attributs de Dieu que nousconnaissons (un attribut est ce qui constitue un des aspects essentiels de lasubstance).
La matière, comme l'esprit, participent tous deux de la réalitédivine, laquelle n'est pas transcendante (au-delà du monde), mais immanente(Dieu ou la nature, c'est la même substance).
Le Dieu dont nous parleSpinoza n'est pas un Dieu personnel comme dans les religions monothéistes,un pur esprit, mais une puissance partout présente : Dieu est la Nature, et laNature est Dieu.
Les deux attributs de Dieu, pensée et étendue, seretrouvent partout, et l'homme les exprime selon un « mode » qui leur estpropre.
Le mode de la pensée est l'esprit, celui de l'étendue est le corps.D'ores et déjà, le dualisme classique trouve une première réponse : il n'y pasdeux substances mais une seule, à savoir Dieu, et celle-ci se décline selon des modes que l'on peut certes distinguer par la réflexion, mais qu'il est faux de séparer dans l'être (c'est-à-diredans la réalité).
A partir de là, une seconde solution vient résoudre la difficulté de la relation corps / esprit : c'estce que les commentateurs ont appelé le « parallélisme ».
Le mode de l'étendue (le corps) et l'idée de ce mode(l'esprit) sont une seule et même chose exprimée différemment.
Un principe spinoziste veut que l'ordre et laconnexion des idées soient les mêmes que l'ordre et la connexion des choses.
Cela implique que tout ce qui seproduit dans le corps se produit aussi dans l'âme qui est son idée, et que tout ce qui se produit dans l'âme seproduit aussi dans le corps qui est son point de vue : quand l'âme agit, le corps agit, quand l'âme pâtit, le corpspâtit, et inversement.
Dès lors, l'âme est le complément psychique du corps, le corps le complément matériel del'âme, en tant qu'ils sont tous deux des modes d'une seule et même substance présente en tout : Dieu ou la nature.
C.
La nature humaine est, en effet, composée de matière et d'esprit qui ne sont pas seulement juxtaposés, maisintimement unis au point de ne faire qu'une nature et qu'une personne.Les interactions constatées l'ont déjà montré; il faut ajouter encore que je dis également ma digestion et mapensée, m'attribuant aussi étroitement l'acte du corps vivant et l'acte de l'esprit.C'est donc strictement qu'il faut entendre ce terme d'union substantielle employé mais minimisé par Descartes, quidissociait trop les deux élémentsFaut-il ajouter, en terminant, que la question ici traitée a toujours passionné et plus ou moins divisé les philosophes.C'est qu'elle est d'une importance capitale.Il n'est pas exagéré, en effet, de dire que : de la façon dont on y répond et dont on comprend les relations de lamatière et de l'esprit (c'est-à-dire le rôle du corps et de l'âme spécialement dans la sensation), dépendent toute lathéorie de la connaissance et toute l'orientation philosophique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il opposer l'esprit à la matière
- Faut il opposer matière et esprit ?
- Au terme de l'Avant-propos placé en tête de son livre Matière et Lumière, Louis de Broglie écrit : « On peut légitimement aimer la science pour ses applications, pour les soulagements et les commodités qu'elle a apportés à la vie humaine, sans oublier toutefois que la vie humaine restera toujours, de par sa nature même, précaire et misérable. Mais on peut, pensons-nous, trouver une autre raison d'aimer l'effort scientifique, en appréciant la valeur de ce qu'il représente. En effet, com
- Y a-t-il lieu d'opposer absolument la matière à l'esprit ?
- Victor Hugo écrit : «La nature procède par contrastes. C'est par les oppositions qu'elle fait saillir les objets. C'est par leurs contraires qu'elle fait sentir les choses, le jour par la nuit, le chaud par le froid, etc.; toute clarté fait ombre. De là le relief, le contour, la proportion, le rapport, la réalité. La création, la vie, le destin, ne sont pour l'homme qu'un immense clair-obscur. Le poète, ce philosophe du concret et ce peintre de l'abstrait, le poète, ce penseur suprême,