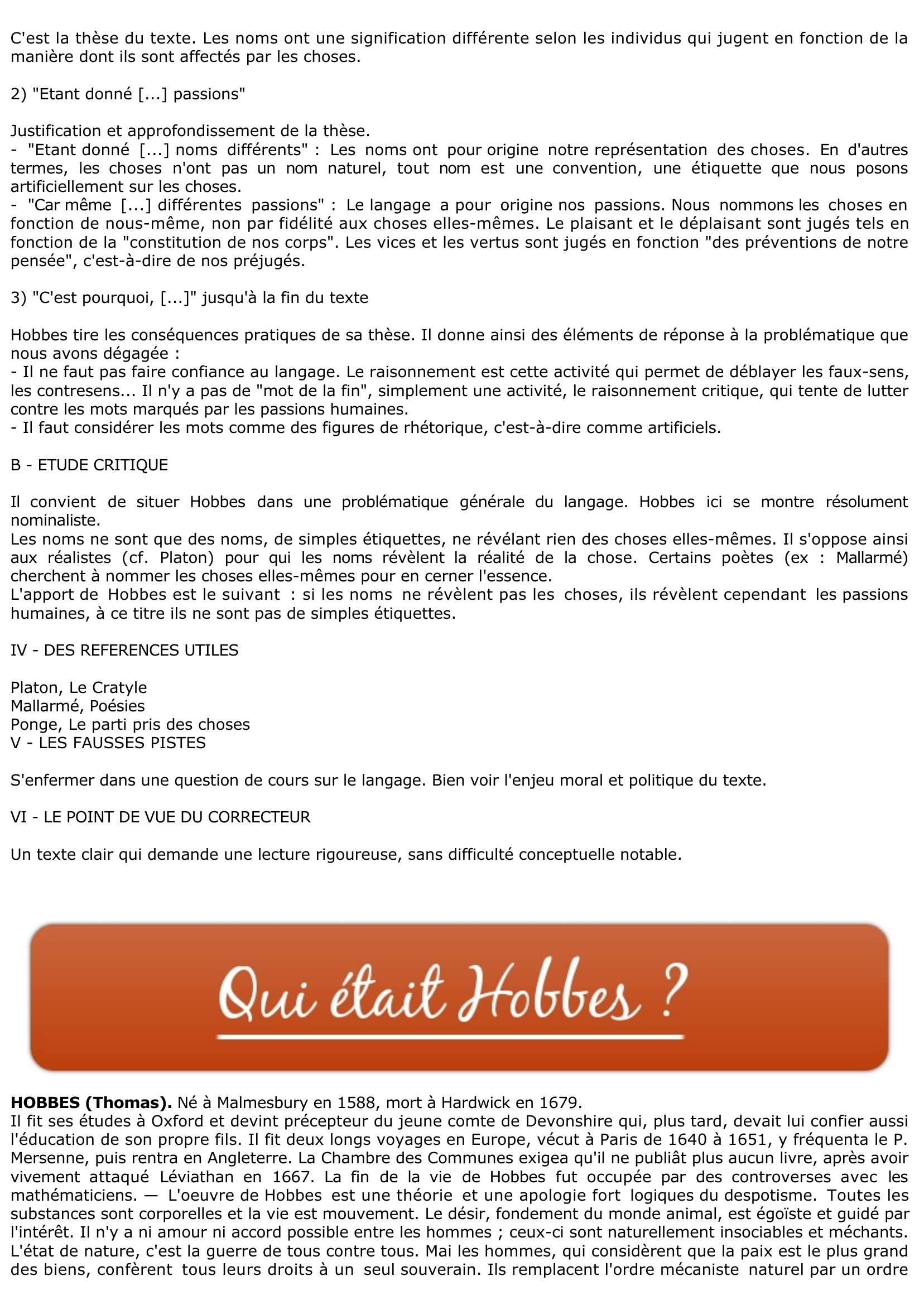Hobbes: Langage et passions
Publié le 10/01/2004

Extrait du document
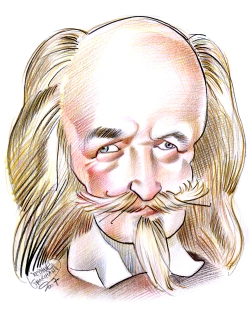
Nous jugeons des vices et des vertus, du bien et du mal, en fonction de nos passions. Or, ces passions diffèrent d'un homme à un autre. Ce que l'un nomme vice, l'autre peut l'appeler vertu. Les noms ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Il est donc dans le domaine moral impossible de se mettre vraiment d'accord sur le sens des mots, chacun y projette ses propres passions. Le langage, dont le but est de communiquer, de dialoguer, de "s'entendre" au sens fort du terme, est donc le lieu d'un perpétuel malentendu. Et cela, là où il serait urgent de s'entendre : la vie commune entre les hommes, la morale et la politique. Comment donc l'Homme peut-il surmonter ce handicap originel du langage pour parvenir à dialoguer vraiment avec les autres hommes ?
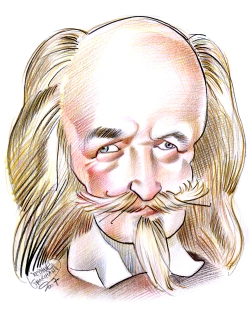
«
C'est la thèse du texte.
Les noms ont une signification différente selon les individus qui jugent en fonction de lamanière dont ils sont affectés par les choses.
2) "Etant donné [...] passions"
Justification et approfondissement de la thèse.- "Etant donné [...] noms différents" : Les noms ont pour origine notre représentation des choses.
En d'autrestermes, les choses n'ont pas un nom naturel, tout nom est une convention, une étiquette que nous posonsartificiellement sur les choses.- "Car même [...] différentes passions" : Le langage a pour origine nos passions.
Nous nommons les choses enfonction de nous-même, non par fidélité aux choses elles-mêmes.
Le plaisant et le déplaisant sont jugés tels enfonction de la "constitution de nos corps".
Les vices et les vertus sont jugés en fonction "des préventions de notrepensée", c'est-à-dire de nos préjugés.
3) "C'est pourquoi, [...]" jusqu'à la fin du texte
Hobbes tire les conséquences pratiques de sa thèse.
Il donne ainsi des éléments de réponse à la problématique quenous avons dégagée :- Il ne faut pas faire confiance au langage.
Le raisonnement est cette activité qui permet de déblayer les faux-sens,les contresens...
Il n'y a pas de "mot de la fin", simplement une activité, le raisonnement critique, qui tente de luttercontre les mots marqués par les passions humaines.- Il faut considérer les mots comme des figures de rhétorique, c'est-à-dire comme artificiels.
B - ETUDE CRITIQUE
Il convient de situer Hobbes dans une problématique générale du langage.
Hobbes ici se montre résolumentnominaliste.Les noms ne sont que des noms, de simples étiquettes, ne révélant rien des choses elles-mêmes.
Il s'oppose ainsiaux réalistes (cf.
Platon) pour qui les noms révèlent la réalité de la chose.
Certains poètes (ex : Mallarmé)cherchent à nommer les choses elles-mêmes pour en cerner l'essence.L'apport de Hobbes est le suivant : si les noms ne révèlent pas les choses, ils révèlent cependant les passionshumaines, à ce titre ils ne sont pas de simples étiquettes.
IV - DES REFERENCES UTILES
Platon, Le CratyleMallarmé, PoésiesPonge, Le parti pris des chosesV - LES FAUSSES PISTES
S'enfermer dans une question de cours sur le langage.
Bien voir l'enjeu moral et politique du texte.
VI - LE POINT DE VUE DU CORRECTEUR
Un texte clair qui demande une lecture rigoureuse, sans difficulté conceptuelle notable.
HOBBES (Thomas).
Né à Malmesbury en 1588, mort à Hardwick en 1679. Il fit ses études à Oxford et devint précepteur du jeune comte de Devonshire qui, plus tard, devait lui confier aussil'éducation de son propre fils.
Il fit deux longs voyages en Europe, vécut à Paris de 1640 à 1651, y fréquenta le P.Mersenne, puis rentra en Angleterre.
La Chambre des Communes exigea qu'il ne publiât plus aucun livre, après avoirvivement attaqué Léviathan en 1667.
La fin de la vie de Hobbes fut occupée par des controverses avec lesmathématiciens.
— L'oeuvre de Hobbes est une théorie et une apologie fort logiques du despotisme.
Toutes lessubstances sont corporelles et la vie est mouvement.
Le désir, fondement du monde animal, est égoïste et guidé parl'intérêt.
Il n'y a ni amour ni accord possible entre les hommes ; ceux-ci sont naturellement insociables et méchants.L'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous.
Mai les hommes, qui considèrent que la paix est le plus granddes biens, confèrent tous leurs droits à un seul souverain.
Ils remplacent l'ordre mécaniste naturel par un ordre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Hobbes: les passions; le bonheur; le pouvoir; le temps.
- Hobbes, Léviathan: Le langage; la perception; l'interprétation.
- Thomas HOBBES, Léviathan. LE LANGAGE
- Hobbes et le langage
- Hobbes, Léviathan, 1651, Chapitre 4: Le langage