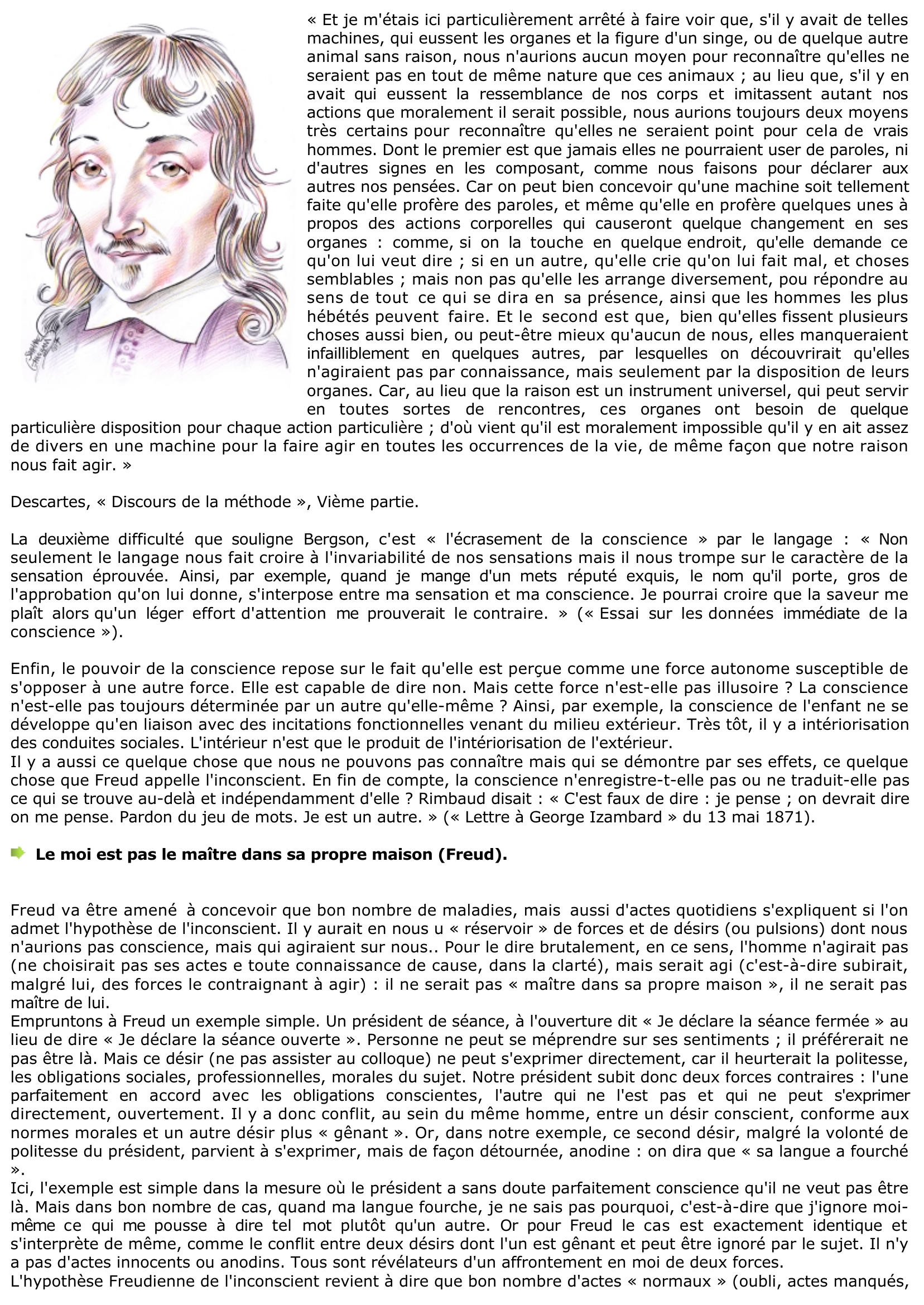La conscience est-elle source d'illusions ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document


«
« Et je m'étais ici particulièrement arrêté à faire voir que, s'il y avait de tellesmachines, qui eussent les organes et la figure d'un singe, ou de quelque autreanimal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elles neseraient pas en tout de même nature que ces animaux ; au lieu que, s'il y enavait qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nosactions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyenstrès certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vraishommes.
Dont le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles, nid'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer auxautres nos pensées.
Car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellementfaite qu'elle profère des paroles, et même qu'elle en profère quelques unes àpropos des actions corporelles qui causeront quelque changement en sesorganes : comme, si on la touche en quelque endroit, qu'elle demande cequ'on lui veut dire ; si en un autre, qu'elle crie qu'on lui fait mal, et chosessemblables ; mais non pas qu'elle les arrange diversement, pou répondre ausens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plushébétés peuvent faire.
Et le second est que, bien qu'elles fissent plusieurschoses aussi bien, ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles manqueraientinfailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'ellesn'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leursorganes.
Car, au lieu que la raison est un instrument universel, qui peut serviren toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelque particulière disposition pour chaque action particulière ; d'où vient qu'il est moralement impossible qu'il y en ait assezde divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie, de même façon que notre raisonnous fait agir.
»
Descartes, « Discours de la méthode », Vième partie.
La deuxième difficulté que souligne Bergson, c'est « l'écrasement de la conscience » par le langage : « Nonseulement le langage nous fait croire à l'invariabilité de nos sensations mais il nous trompe sur le caractère de lasensation éprouvée.
Ainsi, par exemple, quand je mange d'un mets réputé exquis, le nom qu'il porte, gros del'approbation qu'on lui donne, s'interpose entre ma sensation et ma conscience.
Je pourrai croire que la saveur meplaît alors qu'un léger effort d'attention me prouverait le contraire.
» (« Essai sur les données immédiate de laconscience »).
Enfin, le pouvoir de la conscience repose sur le fait qu'elle est perçue comme une force autonome susceptible des'opposer à une autre force.
Elle est capable de dire non.
Mais cette force n'est-elle pas illusoire ? La consciencen'est-elle pas toujours déterminée par un autre qu'elle-même ? Ainsi, par exemple, la conscience de l'enfant ne sedéveloppe qu'en liaison avec des incitations fonctionnelles venant du milieu extérieur.
Très tôt, il y a intériorisationdes conduites sociales.
L'intérieur n'est que le produit de l'intériorisation de l'extérieur.Il y a aussi ce quelque chose que nous ne pouvons pas connaître mais qui se démontre par ses effets, ce quelquechose que Freud appelle l'inconscient.
En fin de compte, la conscience n'enregistre-t-elle pas ou ne traduit-elle pasce qui se trouve au-delà et indépendamment d'elle ? Rimbaud disait : « C'est faux de dire : je pense ; on devrait direon me pense.
Pardon du jeu de mots.
Je est un autre.
» (« Lettre à George Izambard » du 13 mai 1871).
Le moi est pas le maître dans sa propre maison (Freud).
Freud va être amené à concevoir que bon nombre de maladies, mais aussi d'actes quotidiens s'expliquent si l'onadmet l'hypothèse de l'inconscient.
Il y aurait en nous u « réservoir » de forces et de désirs (ou pulsions) dont nousn'aurions pas conscience, mais qui agiraient sur nous..
Pour le dire brutalement, en ce sens, l'homme n'agirait pas(ne choisirait pas ses actes e toute connaissance de cause, dans la clarté), mais serait agi (c'est-à-dire subirait,malgré lui, des forces le contraignant à agir) : il ne serait pas « maître dans sa propre maison », il ne serait pasmaître de lui.Empruntons à Freud un exemple simple.
Un président de séance, à l'ouverture dit « Je déclare la séance fermée » aulieu de dire « Je déclare la séance ouverte ».
Personne ne peut se méprendre sur ses sentiments ; il préférerait nepas être là.
Mais ce désir (ne pas assister au colloque) ne peut s'exprimer directement, car il heurterait la politesse,les obligations sociales, professionnelles, morales du sujet.
Notre président subit donc deux forces contraires : l'uneparfaitement en accord avec les obligations conscientes, l'autre qui ne l'est pas et qui ne peut s'exprimerdirectement, ouvertement.
Il y a donc conflit, au sein du même homme, entre un désir conscient, conforme auxnormes morales et un autre désir plus « gênant ».
Or, dans notre exemple, ce second désir, malgré la volonté depolitesse du président, parvient à s'exprimer, mais de façon détournée, anodine : on dira que « sa langue a fourché».Ici, l'exemple est simple dans la mesure où le président a sans doute parfaitement conscience qu'il ne veut pas êtrelà.
Mais dans bon nombre de cas, quand ma langue fourche, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire que j'ignore moi-même ce qui me pousse à dire tel mot plutôt qu'un autre.
Or pour Freud le cas est exactement identique ets'interprète de même, comme le conflit entre deux désirs dont l'un est gênant et peut être ignoré par le sujet.
Il n'ya pas d'actes innocents ou anodins.
Tous sont révélateurs d'un affrontement en moi de deux forces.L'hypothèse Freudienne de l'inconscient revient à dire que bon nombre d'actes « normaux » (oubli, actes manqués,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation: La conscience est elle source d'illusions?
- La conscience est-elle source d'illusions ?
- La conscience est-elle source d'illusions ?
- La conscience est source d'illusions?
- La conscience est-elle source d'illusions ?