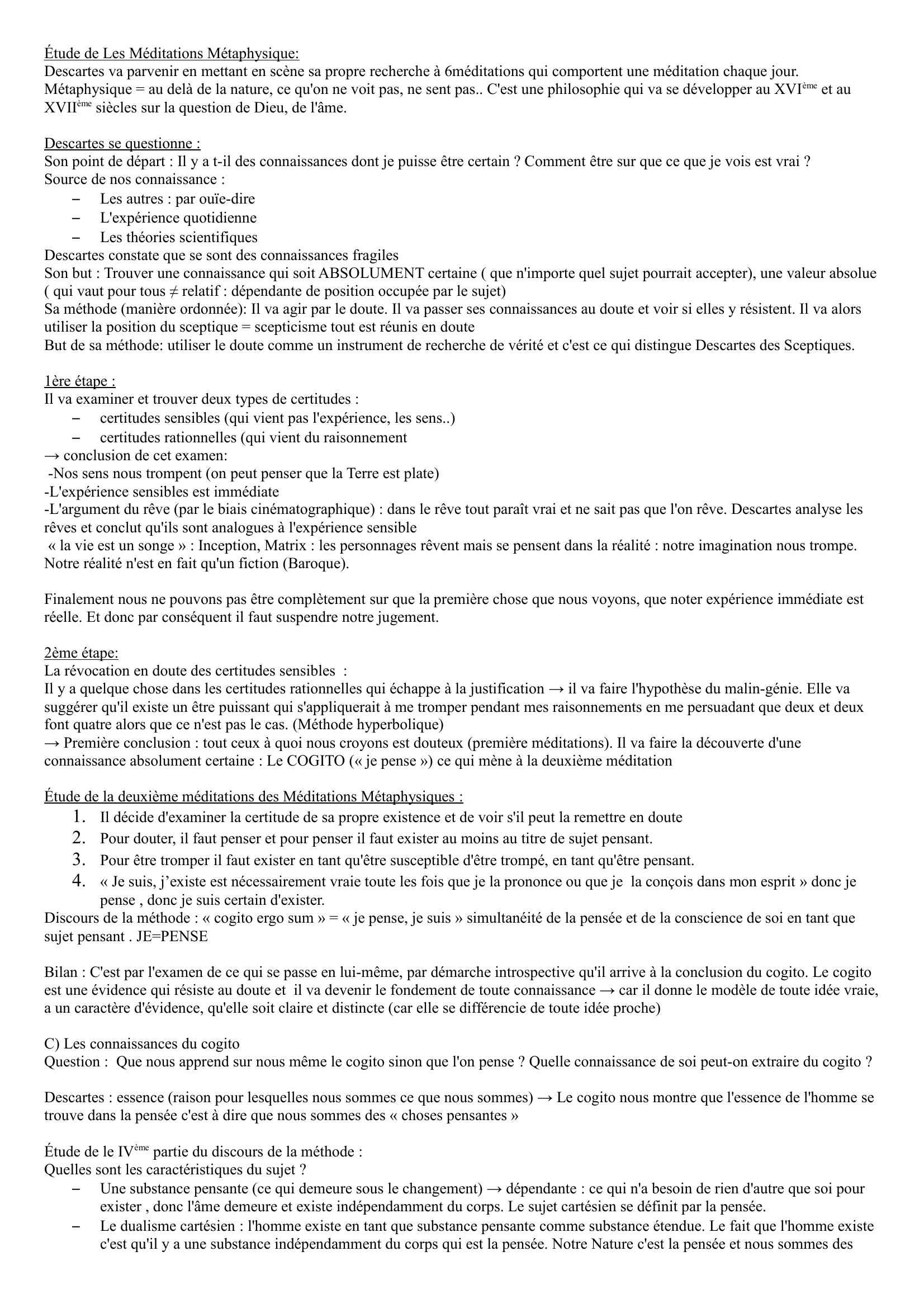LA CONSCIENCE ET L'INCONSCIENT
Publié le 14/03/2012
Extrait du document

Introduction :
1/ Amorce
Hegel, Esthétique,1835
L'homme : double existence : naturelle et esprit ce qui lui permet de penser mais
aussi de se penser lui-même, de réfléchir, se représenter soi-même =
dédoublement. L'homme est à la fois objet (car il s'analyse, il se prend lui-même
comme objet de réflexion) et sujet (car il analyse).
Ainsi le « pour soi « (esprit) est différent du « soi « (corps)
Choses de la nature : sans
pensée, aveugle
2/ Définitions
– Conscience = capacité à être présent à ce qui nous entoure = « dévoilante « Jean Paul Sartre (fondateur de l'Existentialisme)
→ « les détecteurs de l'être « : la conscience est un principe de distinction entre sujet et objet
- Dans la philosophie Antique le sujet à un sens logique l(e sujet de la phrase) et un sens ontologique (science de l'être) car
c'est une substance (=ce qui demeure sous le changement)
- Dans la philosophie moderne le sujet a aussi un sens psychologique car c'est un être doté de conscience dans un état
permanent.
– Conscience de soi = rapport à soi/ capacité à être présent à ce qui se passe en nous (souvenirs, sentiments..)
→ sentiment de soi (quand on a mal on sait que c'est nous qui avons mal)
→ Conscience réflexive : fonction de connaissance et fonction pratique.
– Conscience morale (petite voix intérieure) = capacité qu'a le sujet à juger/ évaluer ses actes.
La conscience met en rapport objet et sujet :
Étude du texte p346-347 Pensées, fragments :
« L'univers comprend (=inclure) l'homme mais que seul l'homme comprend (penser) l'univers «. Il y a une disproportion entre
l'homme qui est infiniment petit et l'univers qui est infiniment grand.
→ La première tâche de l'homme pour bien vivre est de chercher à se connaître soi-même.
3/ Problèmes
La conscience de soi est-elle effectivement celle qui nous donne accès au monde? Est-elle celle qui nous permet de nous connaître de
manière sûre ou ne vaut-il mieux pas penser que plus modestement la conscience est ce qui nous permet de nous rendre compte de nos
limites et de réaliser qu'il n'est pas possible de nous connaître entièrement soi-même ?
Conscience de soi :
– Condition de la connaissance de soi/ du monde
– Insuffisante à mener ce projet à bien.
1. Le monde est-il tel que ma conscience me le donne à voir ?
2. Sommes-nous tels que nous pensons être? = problème de subjectivité (Cf cours sur la vérité)
4/ Intermittence :
-problème du degrés : le sommeil, l'attention flottante.
-problème de la permanence du sujet : l'oubli, le changement,
-problème du changement d'état du sujet : la passion, la colère.

«
Étude de Les Méditations Métaphysique:
Descartes va parvenir en mettant en scène sa propre recherche à 6méditations qui comportent une méditation chaque jour.
Métaphysique = au delà de la nature, ce qu'on ne voit pas, ne sent pas..
C'est une philosophie qui va se développer au XVI ème
et au
XVII ème
siècles sur la question de Dieu, de l'âme.
Descartes se questionne :
Son point de départ : Il y a t-il des connaissances dont je puisse être certain ? Comment être sur que ce que je vois est vrai ?
Source de nos connaissance :
– Les autres : par ouïe-dire
– L'expérience quotidienne
– Les théories scientifiques
Descartes constate que se sont des connaissances fragiles
Son but : Trouver une connaissance qui soit ABSOLUMENT certaine ( que n'importe quel sujet pourrait accepter), une valeur absolue
( qui vaut pour tous ≠ relatif : dépendante de position occupée par le sujet)
Sa méthode (manière ordonnée): Il va agir par le doute.
Il va passer ses connaissances au doute et voir si elles y résistent.
Il va alors
utiliser la position du sceptique = scepticisme tout est réunis en doute
But de sa méthode: utiliser le doute comme un instrument de recherche de vérité et c'est ce qui distingue Descartes des Sceptiques.
1ère étape :
Il va examiner et trouver deux types de certitudes :
– certitudes sensibles (qui vient pas l'expérience, les sens..)
– certitudes rationnelles (qui vient du raisonnement
→ conclusion de cet examen:
-Nos sens nous trompent (on peut penser que la Terre est plate)
-L'expérience sensibles est immédiate
-L'argument du rêve (par le biais cinématographique) : dans le rêve tout paraît vrai et ne sait pas que l'on rêve.
Descartes analyse les
rêves et conclut qu'ils sont analogues à l'expérience sensible
« la vie est un songe » : Inception, Matrix : les personnages rêvent mais se pensent dans la réalité : notre imagination nous trompe.
Notre réalité n'est en fait qu'un fiction (Baroque).
Finalement nous ne pouvons pas être complètement sur que la première chose que nous voyons, que noter expérience immédiate est
réelle.
Et donc par conséquent il faut suspendre notre jugement.
2ème étape:
La révocation en doute des certitudes sensibles :
Il y a quelque chose dans les certitudes rationnelles qui échappe à la justification → il va faire l'hypothèse du malin-génie.
Elle va
suggérer qu'il existe un être puissant qui s'appliquerait à me tromper pendant mes raisonnements en me persuadant que deux et deux
font quatre alors que ce n'est pas le cas.
(Méthode hyperbolique)
→ Première conclusion : tout ceux à quoi nous croyons est douteux (première méditations).
Il va faire la découverte d'une
connaissance absolument certaine : Le COGITO (« je pense ») ce qui mène à la deuxième méditation
Étude de la deuxième méditations des Méditations Métaphysiques :
1.
Il décide d'examiner la certitude de sa propre existence et de voir s'il peut la remettre en doute
2.
Pour douter, il faut penser et pour penser il faut exister au moins au titre de sujet pensant.
3.
Pour être tromper il faut exister en tant qu'être susceptible d'être trompé, en tant qu'être pensant.
4.
« Je suis, j’existe est nécessairement vraie toute les fois que je la prononce ou que je la conçois dans mon esprit » donc je
pense , donc je suis certain d'exister.
Discours de la méthode : « cogito ergo sum » = « je pense, je suis » simultanéité de la pensée et de la conscience de soi en tant que
sujet pensant .
JE=PENSE
Bilan : C'est par l'examen de ce qui se passe en lui-même, par démarche introspective qu'il arrive à la conclusion du cogito.
Le cogito
est une évidence qui résiste au doute et il va devenir le fondement de toute connaissance → car il donne le modèle de toute idée vraie,
a un caractère d'évidence, qu'elle soit claire et distincte (car elle se différencie de toute idée proche)
C) Les connaissances du cogito
Question : Que nous apprend sur nous même le cogito sinon que l'on pense ? Quelle connaissance de soi peut-on extraire du cogito ?
Descartes : essence (raison pour lesquelles nous sommes ce que nous sommes) → Le cogito nous montre que l'essence de l'homme se
trouve dans la pensée c'est à dire que nous sommes des « choses pensantes »
Étude de le IV ème
partie du discours de la méthode :
Quelles sont les caractéristiques du sujet ?
– Une substance pensante (ce qui demeure sous le changement) → dépendante : ce qui n'a besoin de rien d'autre que soi pour
exister , donc l'âme demeure et existe indépendamment du corps.
Le sujet cartésien se définit par la pensée.
– Le dualisme cartésien : l'homme existe en tant que substance pensante comme substance étendue.
Le fait que l'homme existe
c'est qu'il y a une substance indépendamment du corps qui est la pensée.
Notre Nature c'est la pensée et nous sommes des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De la conscience souveraine à l’inconscient Freudien
- « L'Inconscient et la Conscience. La Réalité » Dans L'interprétation du rêve. 1900 S.Freud.
- La conscience et l'inconscient
- L’inconscient permet-il autant que la conscience de définir l’homme ?
- CONSCIENCE ET INCONSCIENT