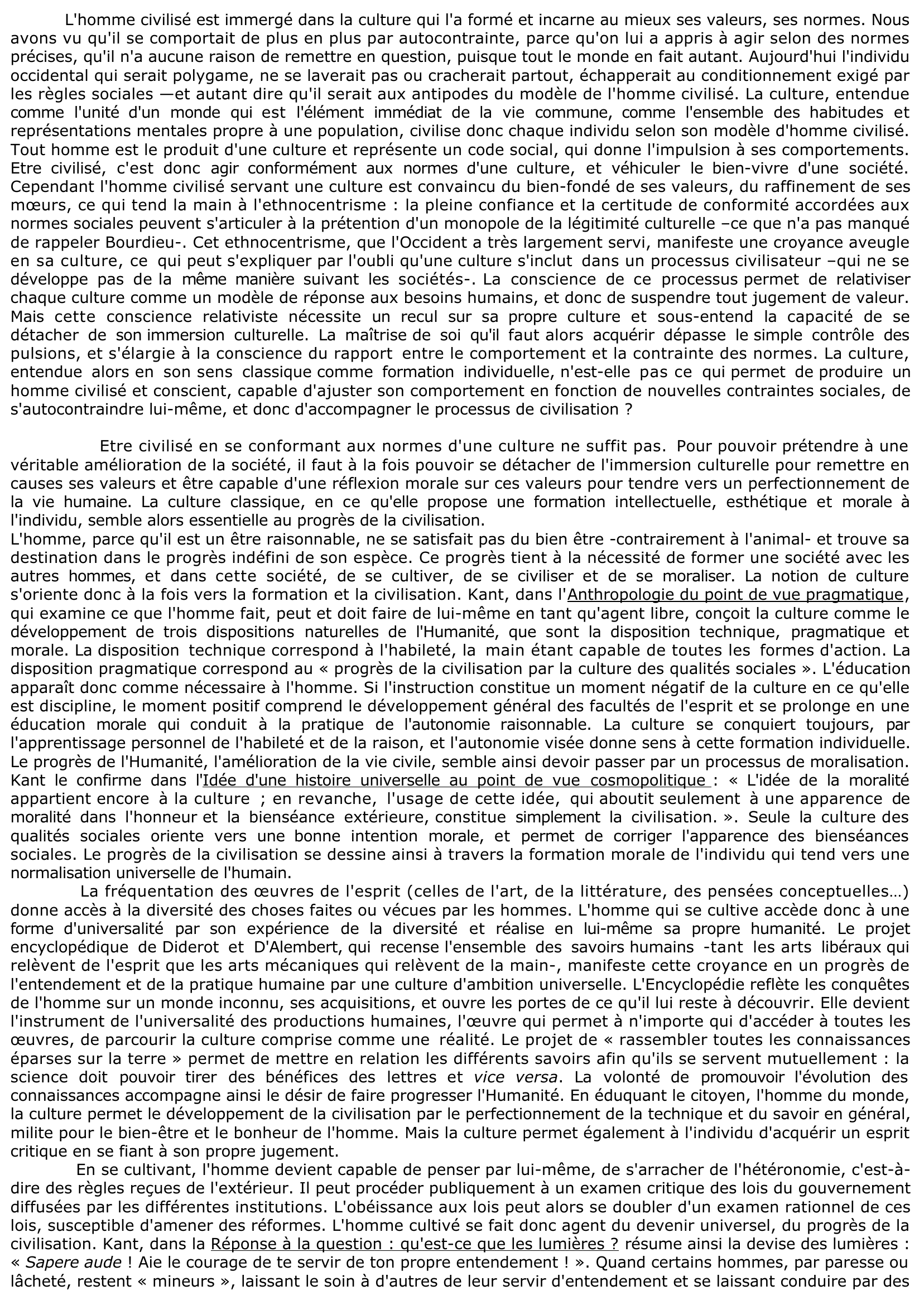La culture est-elle civilisatrice ?
Publié le 17/03/2009

Extrait du document

La culture peut-elle nous rendre meilleur ? Y a-t-il dans le phénomène culturel un principe de réalisation et de moralisation de soi ? En effet, les atrocités du nazisme nous ont montré que la culture la plus haute pouvait coïncider avec la plus grande barbarie.
Etre cultivé nous rend-il plus civil ?

«
L'homme civilisé est immergé dans la culture qui l'a formé et incarne au mieux ses valeurs, ses normes.
Nous avons vu qu'il se comportait de plus en plus par autocontrainte, parce qu'on lui a appris à agir selon des normesprécises, qu'il n'a aucune raison de remettre en question, puisque tout le monde en fait autant.
Aujourd'hui l'individuoccidental qui serait polygame, ne se laverait pas ou cracherait partout, échapperait au conditionnement exigé parles règles sociales —et autant dire qu'il serait aux antipodes du modèle de l'homme civilisé.
La culture, entenduecomme l'unité d'un monde qui est l'élément immédiat de la vie commune, comme l'ensemble des habitudes etreprésentations mentales propre à une population, civilise donc chaque individu selon son modèle d'homme civilisé.Tout homme est le produit d'une culture et représente un code social, qui donne l'impulsion à ses comportements.Etre civilisé, c'est donc agir conformément aux normes d'une culture, et véhiculer le bien-vivre d'une société.Cependant l'homme civilisé servant une culture est convaincu du bien-fondé de ses valeurs, du raffinement de sesmœurs, ce qui tend la main à l'ethnocentrisme : la pleine confiance et la certitude de conformité accordées auxnormes sociales peuvent s'articuler à la prétention d'un monopole de la légitimité culturelle –ce que n'a pas manquéde rappeler Bourdieu-.
Cet ethnocentrisme, que l'Occident a très largement servi, manifeste une croyance aveugleen sa culture, ce qui peut s'expliquer par l'oubli qu'une culture s'inclut dans un processus civilisateur –qui ne sedéveloppe pas de la même manière suivant les sociétés-.
La conscience de ce processus permet de relativiserchaque culture comme un modèle de réponse aux besoins humains, et donc de suspendre tout jugement de valeur.Mais cette conscience relativiste nécessite un recul sur sa propre culture et sous-entend la capacité de sedétacher de son immersion culturelle.
La maîtrise de soi qu'il faut alors acquérir dépasse le simple contrôle despulsions, et s'élargie à la conscience du rapport entre le comportement et la contrainte des normes.
La culture,entendue alors en son sens classique comme formation individuelle, n'est-elle pas ce qui permet de produire unhomme civilisé et conscient, capable d'ajuster son comportement en fonction de nouvelles contraintes sociales, des'autocontraindre lui-même, et donc d'accompagner le processus de civilisation ? Etre civilisé en se conformant aux normes d'une culture ne suffit pas.
Pour pouvoir prétendre à unevéritable amélioration de la société, il faut à la fois pouvoir se détacher de l'immersion culturelle pour remettre encauses ses valeurs et être capable d'une réflexion morale sur ces valeurs pour tendre vers un perfectionnement dela vie humaine.
La culture classique, en ce qu'elle propose une formation intellectuelle, esthétique et morale àl'individu, semble alors essentielle au progrès de la civilisation.L'homme, parce qu'il est un être raisonnable, ne se satisfait pas du bien être -contrairement à l'animal- et trouve sadestination dans le progrès indéfini de son espèce.
Ce progrès tient à la nécessité de former une société avec lesautres hommes, et dans cette société, de se cultiver, de se civiliser et de se moraliser.
La notion de cultures'oriente donc à la fois vers la formation et la civilisation.
Kant, dans l' Anthropologie du point de vue pragmatique , qui examine ce que l'homme fait, peut et doit faire de lui-même en tant qu'agent libre, conçoit la culture comme ledéveloppement de trois dispositions naturelles de l'Humanité, que sont la disposition technique, pragmatique etmorale.
La disposition technique correspond à l'habileté, la main étant capable de toutes les formes d'action.
Ladisposition pragmatique correspond au « progrès de la civilisation par la culture des qualités sociales ».
L'éducationapparaît donc comme nécessaire à l'homme.
Si l'instruction constitue un moment négatif de la culture en ce qu'elleest discipline, le moment positif comprend le développement général des facultés de l'esprit et se prolonge en uneéducation morale qui conduit à la pratique de l'autonomie raisonnable.
La culture se conquiert toujours, parl'apprentissage personnel de l'habileté et de la raison, et l'autonomie visée donne sens à cette formation individuelle.Le progrès de l'Humanité, l'amélioration de la vie civile, semble ainsi devoir passer par un processus de moralisation.Kant le confirme dans l' Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique : « L'idée de la moralité appartient encore à la culture ; en revanche, l'usage de cette idée, qui aboutit seulement à une apparence demoralité dans l'honneur et la bienséance extérieure, constitue simplement la civilisation.
».
Seule la culture desqualités sociales oriente vers une bonne intention morale, et permet de corriger l'apparence des bienséancessociales.
Le progrès de la civilisation se dessine ainsi à travers la formation morale de l'individu qui tend vers unenormalisation universelle de l'humain.
La fréquentation des œuvres de l'esprit (celles de l'art, de la littérature, des pensées conceptuelles…)donne accès à la diversité des choses faites ou vécues par les hommes.
L'homme qui se cultive accède donc à uneforme d'universalité par son expérience de la diversité et réalise en lui-même sa propre humanité.
Le projetencyclopédique de Diderot et D'Alembert, qui recense l'ensemble des savoirs humains -tant les arts libéraux quirelèvent de l'esprit que les arts mécaniques qui relèvent de la main-, manifeste cette croyance en un progrès del'entendement et de la pratique humaine par une culture d'ambition universelle.
L'Encyclopédie reflète les conquêtesde l'homme sur un monde inconnu, ses acquisitions, et ouvre les portes de ce qu'il lui reste à découvrir.
Elle devientl'instrument de l'universalité des productions humaines, l'œuvre qui permet à n'importe qui d'accéder à toutes lesœuvres, de parcourir la culture comprise comme une réalité.
Le projet de « rassembler toutes les connaissanceséparses sur la terre » permet de mettre en relation les différents savoirs afin qu'ils se servent mutuellement : lascience doit pouvoir tirer des bénéfices des lettres et vice versa .
La volonté de promouvoir l'évolution des connaissances accompagne ainsi le désir de faire progresser l'Humanité.
En éduquant le citoyen, l'homme du monde,la culture permet le développement de la civilisation par le perfectionnement de la technique et du savoir en général,milite pour le bien-être et le bonheur de l'homme.
Mais la culture permet également à l'individu d'acquérir un espritcritique en se fiant à son propre jugement.
En se cultivant, l'homme devient capable de penser par lui-même, de s'arracher de l'hétéronomie, c'est-à-dire des règles reçues de l'extérieur.
Il peut procéder publiquement à un examen critique des lois du gouvernementdiffusées par les différentes institutions.
L'obéissance aux lois peut alors se doubler d'un examen rationnel de ceslois, susceptible d'amener des réformes.
L'homme cultivé se fait donc agent du devenir universel, du progrès de lacivilisation.
Kant, dans la Réponse à la question : qu'est-ce que les lumières ? résume ainsi la devise des lumières : « Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! ».
Quand certains hommes, par paresse ou lâcheté, restent « mineurs », laissant le soin à d'autres de leur servir d'entendement et se laissant conduire par des.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation sur la culture - Sujet : « Dans quelle mesure peut-on dire que l’on est enfermé dans sa culture ? »
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme
- La culture éloigne-t-elle l’humain de la nature ?
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ADJOINT TECHNIQUE D'ACCUEIL, DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme ?