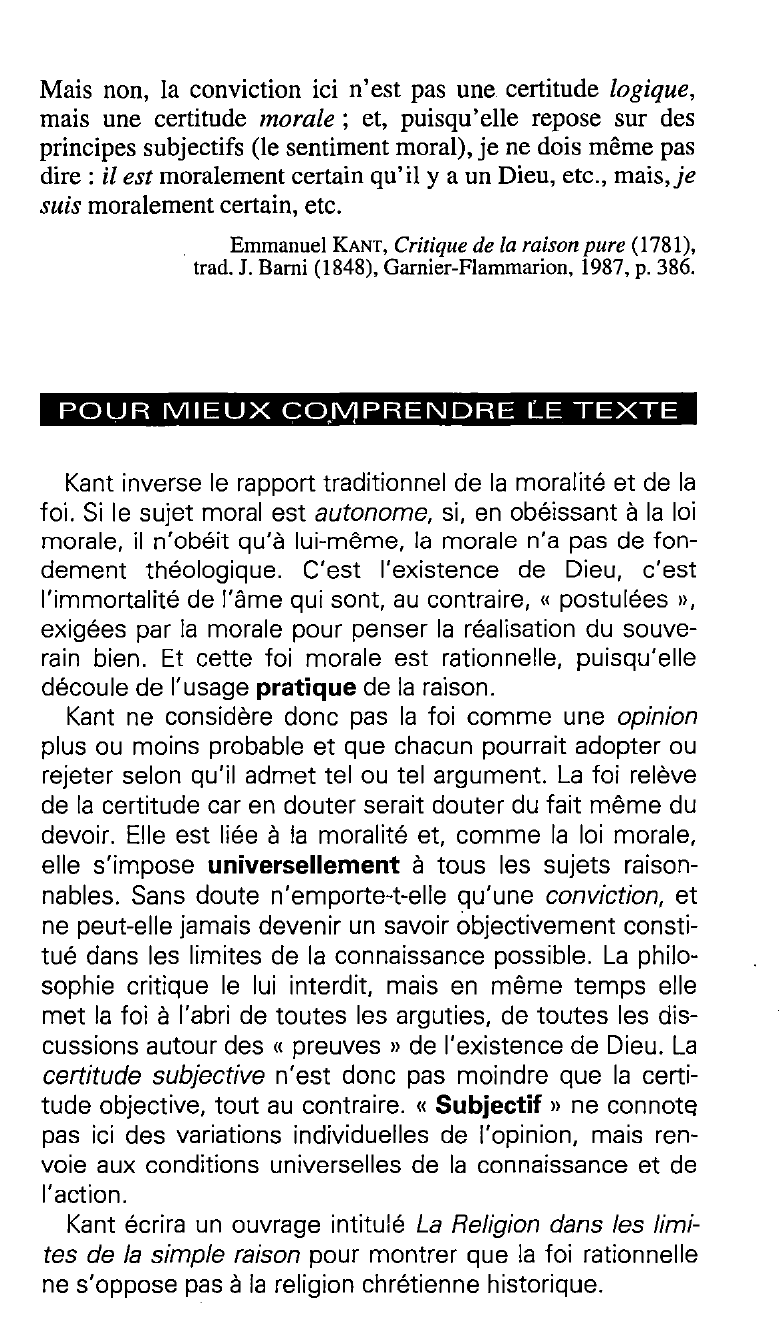La foi rationnelle d'E. KANT
Publié le 05/01/2020

Extrait du document

La foi rationnelle
E. KANT
La philosophie critique de Kant, en limitant la connaissance aux conditions de possibilité de l'expérience, aboutit-elle à un scepticisme ou même à un athéisme ? Un des derniers chapitres de la Critique de la raison pure s'intitule : « De l'opinion, du savoir et de la foi ».
Si donc le précepte moral est en même temps ma maxime (comme la raison ordonne qu’il le soit), je croirai inévitablement à l’existence de Dieu et à une vie future, et je suis certain que rien ne peut faire chanceler cette croyance, puisque cela renverserait mes principes moraux mêmes, auxquels je ne saurais renoncer sans me rendre méprisable à mes propres yeux.
De cette manière, malgré la ruine de toutes les ambitieuses prétentions d’une raison qui s’égare au-delà des limites de toute expérience, il nous reste encore assez pour avoir lieu d’être satisfaits au point de vue pratique. Sans doute personne ne peut se vanter de savoir qu’il y a un Dieu et une vie future ; car, s’il le sait, il est précisément l’homme que je cherche depuis longtemps. Tout savoir (quand il s’agit d’un objet de la raison pure) peut se communiquer, et je pourrais alors espérer de voir ma science étonnamment étendue par ses instructions.

«
Mais non, la conviction ici n'est pas une.
certitude logique,
mais une certitude morale ; et, puisqu'elle repose sur des
principes subjectifs (le sentiment moral), je ne dois même pas
dire: il est moralement certain qu'il y a un Dieu, etc., mais, je
suis moralement certain, etc.
Emmanuel KANT, Critique de la raison pure (1781), trad.
J.
Bami (1848), Garnier-Flammarion, 1987, p.
386.
POUR MIEUX COJVJPRENDRE lE TEXTE
Kant inverse le rapport traditionnel de la moralité et de la
foi.
Si le sujet moral est autonome, si, en obéissant à la loi morale, il n'obéit qu'à lui-même, la morale n'a pas de fon
dement théologique.
C'est l'existence de Dieu, c'est
l'immortalité de l'âme qui sont, au contraire, «postulées»,
exigées par la morale pour penser la réalisation du souve
rain bien.
Et cette foi morale est rationnelle, puisqu'elle
découle de l'usage pratique de la raison.
Kant ne considère donc pas la foi comme une opinion
plus ou moins probable et que chacun pourrait adopter ou
rejeter selon qu'il admet tel ou tel argument.
La foi relève
de la certitude car en douter serait douter du fait même du
devoir.
Elle est liée à la moralité et, comme la loi morale,
elle s'impose universellement à tous les sujets raison
nables.
Sans doute n'emporte-t-elle qu'une conviction, et
ne peut-elle jamais devenir un savoir objectivement consti
tué dans les limites de la connaissance possible.
La philo
sophie critique le lui interdit, mais en même temps elle
met la foi à l'abri de toutes les arguties, de toutes les dis
cussions autour des « preuves » de l'existence de Dieu.
La
certitude subjective n'est donc pas moindre que la certi
tude objective, tout au contraire.
« Subjectif » ne connot~
pas ici des variations individuelles de l'opinion, mais ren
voie aux conditions universelles de la connaissance et de
l'action.
Kant écrira un ouvrage intitulé La Religion dans les limi
tes de la simple raison pour montrer que la foi rationnelle
ne s'oppose pas à la religion chrétienne historique..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chercher une explication rationnelle aux miracles est-ce détruire la foi ?
- Dans ses Conjectures sur le début de l'histoire humaine, publiées en 1786, Kant s'efforce d'interpréter d'une manière rationnelle les textes sacrés pour montrer qu'en définitive l'homme est seul responsable de son destin et qu'il ne faut pas accuser la Providence.
- Aperçu du corrigé : Emmanuel Kant : LA RAISON PRATIQUE - LA FOI ET LA RELIGION
- Kant, critique de la théologie rationnelle
- Kant, critique de la psychologie rationnelle.