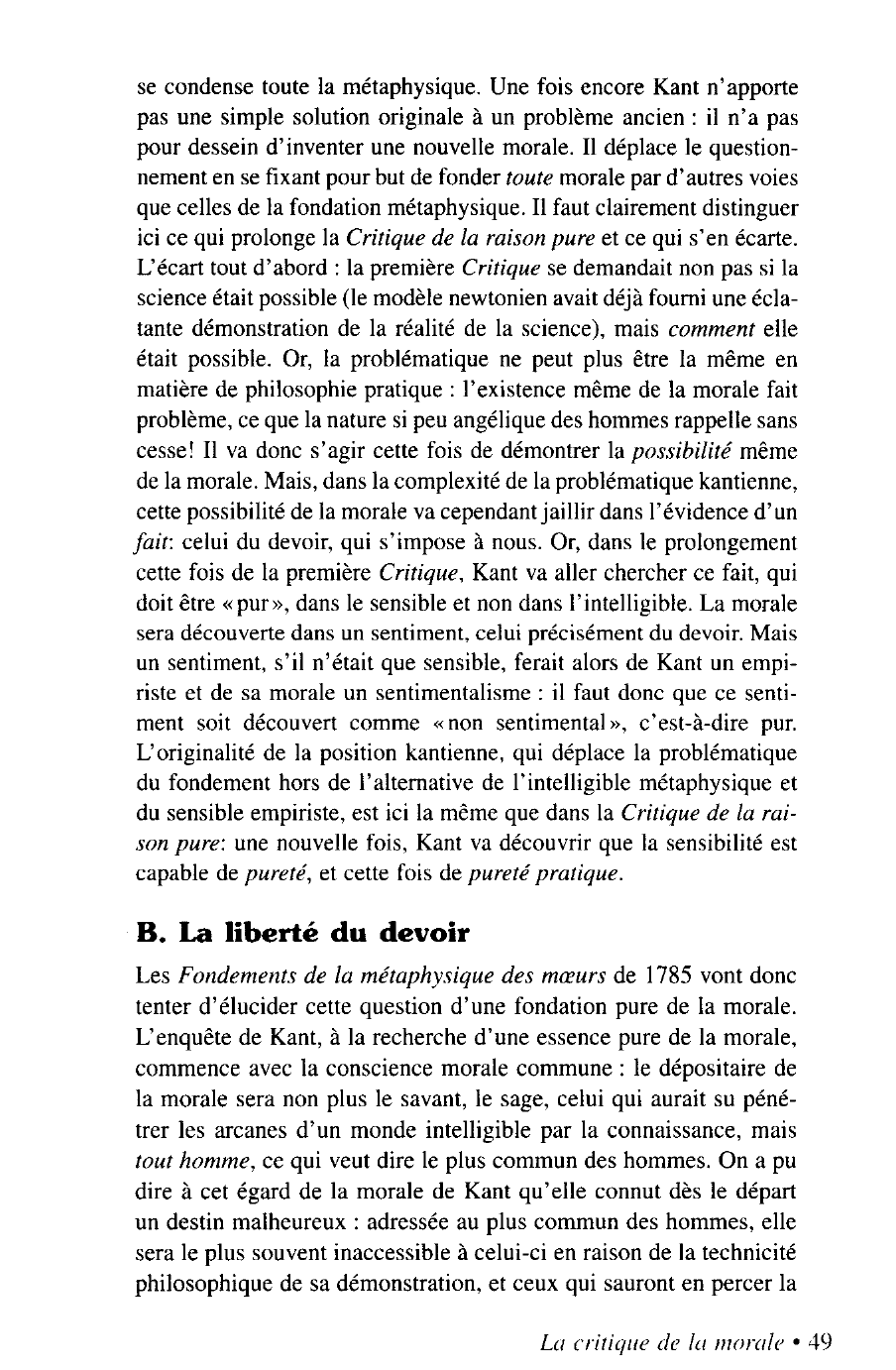LA FONDATION CRITIQUE DE LA MORALE CHEZ KANT
Publié le 25/03/2015

Extrait du document

La morale sera découverte dans un sentiment, celui précisément du devoir.
Mais un sentiment, s'il n'était que sensible, ferait alors de Kant un empiriste et de sa morale un sentimentalisme : il faut donc que ce sentiment soit découvert comme «non sentimental«, c'est-à-dire pur.
L'originalité de la position kantienne, qui déplace la problématique du fondement hors de l'alternative de l'intelligible métaphysique et du sensible empiriste, est ici la même que dans la Critique de la raison pure: une nouvelle fois, Kant va découvrir que la sensibilité est capable de pureté, et cette fois de pureté pratique.
Les Fondements de la métaphysique des moeurs de 1785 vont donc tenter d'élucider cette question d'une fondation pure de la morale.
L'enquête de Kant, à la recherche d'une essence pure de la morale, commence avec la conscience morale commune : le dépositaire de la morale sera non plus le savant, le sage, celui qui aurait su pénétrer les arcanes d'un monde intelligible par la connaissance, mais tout homme, ce qui veut dire le plus commun des hommes.
carapace conceptuelle, étant le plus souvent des «savants«, auront bien du mal à l'accepter, puisqu'elle ne leur est pas destinée et qu'elle destitue leur privilège en matière de morale.
La suprématie kantienne de la raison pratique sur la raison théorique en gênera donc plus d'un à la lecture de cette fondation de la morale dans la conscience commune.
La nécessité naturelle exclut la liberté requise pour l'acte moral : il n'y a aucun mérite à accomplir une détermination naturelle.
Mais le bien, de sujet est ici devenu prédicat : il est ce qui caractérise une volonté comme volonté morale.
Par là même, la morale se replie dans le sujet, non pour y devenir subjective, mais pour découvrir une universalité dans l'immanence, voire, à l'instar de l'ontologie de la première Critique, une transcendance dans l'immanence.
subjective : n'étant plus contrainte de l'extérieur (l'hétéronomie qui ruine la morale au lieu de la fonder), c'est intérieurement que la volonté découvre l'universalité.
Le devoir sera le principe objectif (parce que pur) de la moralité, alors que le respect en sera le principe subjectif (parce que sensible).
Le point de vue critique et transcendantal en morale se condense dans l'idée d'autonomie : la morale de Kant ne sera ni du Ciel, ni de la Terre.

«
se condense toute la métaphysique.
Une fois encore Kant n'apporte
pas une simple solution originale à un problème ancien:
il n'a pas
pour dessein d'inventer une nouvelle morale.
Il déplace le question
nement en
se fixant pour but de fonder toute morale par d'autres voies
que celles de la fondation métaphysique.
Il faut clairement distinguer
ici ce qui prolonge la Critique
de la raison pure et ce qui s'en écarte.
L'écart tout
d'abord: la première Critique se demandait non pas si la
science était possible (le modèle newtonien avait déjà fourni une écla
tante démonstration de la réalité de la science), mais comment elle
était possible.
Or, la problématique ne peut plus être la même en
matière de philosophie pratique : !'existence même de la morale fait
problème, ce que la nature
si peu angélique des hommes rappelle sans
cesse! Il
va donc s'agir cette fois de démontrer la possibilité même
de la morale.
Mais, dans la complexité de la problématique kantienne,
cette possibilité de la morale va cependant jaillir dans l'évidence
d'un
fait: celui du devoir, qui s'impose à nous.
Or, dans le prolongement
cette fois de la première Critique, Kant va aller chercher ce fait, qui
doit être
«pur», dans le sensible et non dans l'intelligible.
La morale
sera découverte dans
un sentiment, celui précisément du devoir.
Mais
un sentiment, s'il n'était que sensible, ferait alors de Kant un empi
riste et de sa morale un sentimentalisme : il faut donc que ce senti
ment soit découvert comme
«non sentimental», c'est-à-dire pur.
L'originalité de la position kantienne, qui déplace la problématique
du fondement hors de l'alternative de l'intelligible métaphysique et
du sensible empiriste, est ici
la même que dans la Critique de
la rai
son pure: une nouvelle fois, Kant
va découvrir que la sensibilité est
capable de pureté, et cette fois de pureté pratique.
B.
La liberté du devoir
Les Fondements de la métaphysique des mœurs de 1785 vont donc
tenter d'élucider cette question
d'une fondation pure de la morale.
L'enquête de Kant, à la recherche
d'une essence pure de la morale,
commence avec la conscience morale commune : le dépositaire de
la morale sera non plus le savant, le sage, celui qui aurait su péné
trer les arcanes
d'un monde intelligible par la connaissance, mais
tout homme, ce qui veut dire
le plus commun des hommes.
On a pu
dire à cet égard de la morale de Kant qu'elle connut dès le départ
un destin malheureux : adressée au plus commun des hommes, elle
sera
le plus souvent inaccessible à celui-ci en raison de la technicité
philosophique de sa démonstration, et ceux qui sauront en percer la
La critique
de la morale • 49.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La morale de Kant: La Critique de la raison pratique
- PODCAST: "Le ciel au-dessus de moi et la loi morale en moi". KANT, Critique de la raison pratique.
- « Deux choses remplissent te coeur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique
- « Il n'y a que deux choses immuables et éternelles : le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, et la loi morale au fond de nos coeurs. » Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique. Commentez cette citation.
- Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale au fond de mon coeur. Critique de la Raison pratique Kant, Emmanuel. Commentez cette citation.