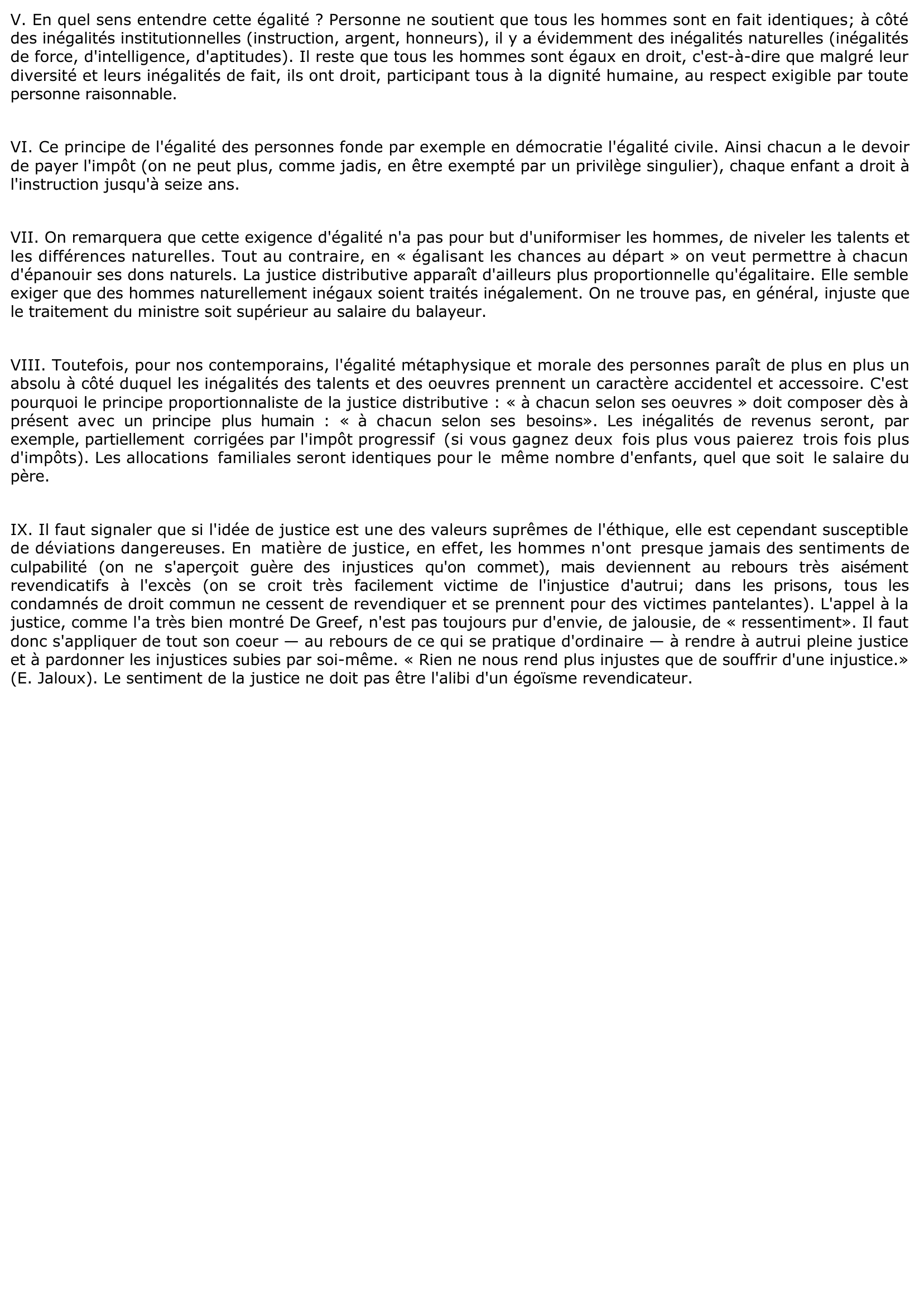La notion de justice
Publié le 16/01/2004

Extrait du document


«
V.
En quel sens entendre cette égalité ? Personne ne soutient que tous les hommes sont en fait identiques; à côtédes inégalités institutionnelles (instruction, argent, honneurs), il y a évidemment des inégalités naturelles (inégalitésde force, d'intelligence, d'aptitudes).
Il reste que tous les hommes sont égaux en droit, c'est-à-dire que malgré leurdiversité et leurs inégalités de fait, ils ont droit, participant tous à la dignité humaine, au respect exigible par toutepersonne raisonnable.
VI.
Ce principe de l'égalité des personnes fonde par exemple en démocratie l'égalité civile.
Ainsi chacun a le devoirde payer l'impôt (on ne peut plus, comme jadis, en être exempté par un privilège singulier), chaque enfant a droit àl'instruction jusqu'à seize ans.
VII.
On remarquera que cette exigence d'égalité n'a pas pour but d'uniformiser les hommes, de niveler les talents etles différences naturelles.
Tout au contraire, en « égalisant les chances au départ » on veut permettre à chacund'épanouir ses dons naturels.
La justice distributive apparaît d'ailleurs plus proportionnelle qu'égalitaire.
Elle sembleexiger que des hommes naturellement inégaux soient traités inégalement.
On ne trouve pas, en général, injuste quele traitement du ministre soit supérieur au salaire du balayeur.
VIII.
Toutefois, pour nos contemporains, l'égalité métaphysique et morale des personnes paraît de plus en plus unabsolu à côté duquel les inégalités des talents et des oeuvres prennent un caractère accidentel et accessoire.
C'estpourquoi le principe proportionnaliste de la justice distributive : « à chacun selon ses oeuvres » doit composer dès àprésent avec un principe plus humain : « à chacun selon ses besoins».
Les inégalités de revenus seront, parexemple, partiellement corrigées par l'impôt progressif (si vous gagnez deux fois plus vous paierez trois fois plusd'impôts).
Les allocations familiales seront identiques pour le même nombre d'enfants, quel que soit le salaire dupère.
IX.
Il faut signaler que si l'idée de justice est une des valeurs suprêmes de l'éthique, elle est cependant susceptiblede déviations dangereuses.
En matière de justice, en effet, les hommes n'ont presque jamais des sentiments deculpabilité (on ne s'aperçoit guère des injustices qu'on commet), mais deviennent au rebours très aisémentrevendicatifs à l'excès (on se croit très facilement victime de l'injustice d'autrui; dans les prisons, tous lescondamnés de droit commun ne cessent de revendiquer et se prennent pour des victimes pantelantes).
L'appel à lajustice, comme l'a très bien montré De Greef, n'est pas toujours pur d'envie, de jalousie, de « ressentiment».
Il fautdonc s'appliquer de tout son coeur — au rebours de ce qui se pratique d'ordinaire — à rendre à autrui pleine justiceet à pardonner les injustices subies par soi-même.
« Rien ne nous rend plus injustes que de souffrir d'une injustice.»(E.
Jaloux).
Le sentiment de la justice ne doit pas être l'alibi d'un égoïsme revendicateur..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- les inégalités sont elles compatibles avec la notion de justice sociale?
- La conception relativiste du droit est-elle incompatible avec la notion de justice universelle ?
- Le droit peut-il faire abstraction de la notion de justice ?
- Quel contenu faut-il donner à la notion d'égalité pour Qu'elle soit conforme aux exigences de la justice ?
- Alain et la notion de justice