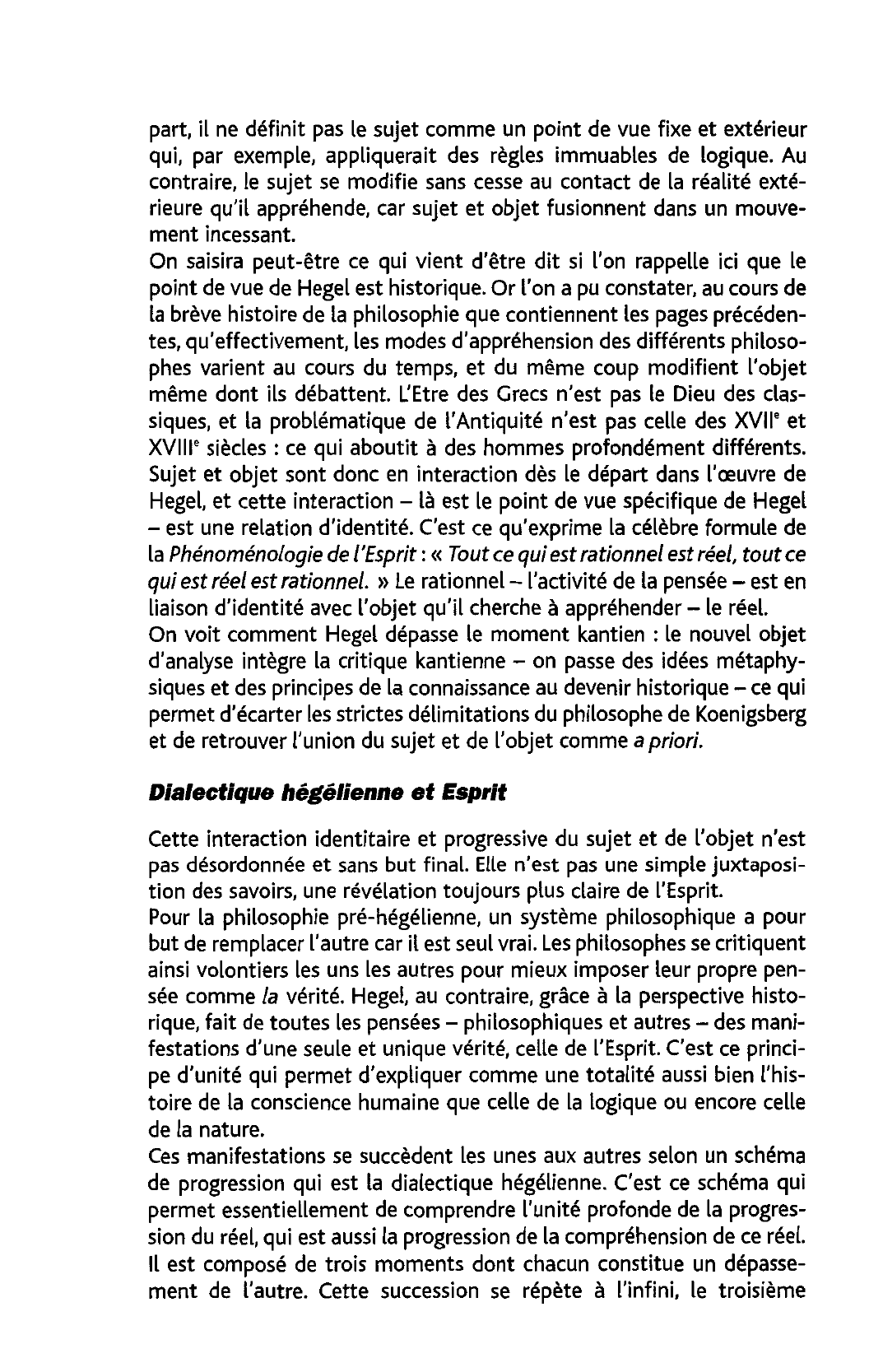La philosophie de Hegel
Publié le 22/03/2015

Extrait du document

Le cas chrétien constitue une forme très poussée de la conscience malheureuse.
Car dans le Christ, qui est à la fois homme et Dieu, la conscience pense se saisir comme universelle tout en restant particulière.
Mais la mort du Christ, comme sa résurrection font disparaître son individualité.
La conscience malheureuse est donc prise entre un mouvement constant de plénitude et de vide.
La Phénoménologie de l'esprit évoque ici le cas des moines et des mystiques qui se consacrent entièrement à Dieu mais ne parviennent pas à s'y fondre totalement : dans la crise mystique ils se confondent avec lui, mais dans la vie quotidienne ils tombent de très haut.
Il y a là un échec complet dans les tentatives de la conscience d'exister seule, en dehors du réel ou avec un réel inadéquat.
Dès lors la conscience, pour sortir de cette impasse d'éloignement radical du monde, doit retourner vers le réel.
La problématique va alors être celle des rapports successifs de la conscience avec un réel qu'elle tente de s'approprier.
Enfin, la troisième figure du romantisme est celte où la conscience cherche à surmonter l'égoïsme du monde en étant elle-même pourvue de toutes les qualités qui manquent à ce même monde, la loyauté et l'esprit de sacrifice.
La conscience en quête du monde va trouver son véritable domaine de réalisation dans l'organisation de la vie commune des êtres humains, la politique.
Hegel voit dans la Révolution française l'aboutissement de ce mouvement, elle qui a dégénéré en une sorte d'anarchie individualiste au lieu de créer une véritable cité de l'Esprit.
Il y avait bien dans ta conscience malheureuse du moine et du mystique une vérité profonde et finale mais elle doit, pour se réaliser pleinement, s'étendre aux dimensions de l'histoire humaine.
Dans te lent cheminement qui part de la certitude sensible et qui passe par toutes les étapes de la négation, il y a une fusion de la conscience et du réel, qui est l'Esprit lui-même apparaissant à ses propres yeux --- et à ceux de la conscience qui perçoit cet accomplissement.
On a pu la comparer à l'un des premiers «romans d'apprentissage«, tels que le romantisme allait en fournir à foison au XIX siècle : les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister, de Goethe.
La partie intitulée Science de la Logique se penche sur la réécriture hégélienne de l'histoire de la logique à partir de la théorie de l'Etre de Parménide.
La partie Philosophie de la Nature écrit l'histoire de la physique en une mythologie de la science et la partie Philosophie de l'Esprit reprend l'histoire de la conscience de la Phénoménologie de l'Esprit, y ajoute une histoire juridique, la Théorie de l'Esprit objectif : le Droit et une histoire de la moralité qui est une histoire de l'organisation politique, de la famille à l'Etat.
L'entreprise hégélienne y révèle sa visée totale en cherchant à ranger dans la progression dialectique l'entier du savoir sous forme historique, car c'est cette totalité même qui manifeste l'Esprit.

«
part, il ne définit pas le sujet comme un point de vue fixe et extérieur
qui, par exemple, appliquerait des règles immuables de logique.
Au
contraire, le sujet se modifie sans cesse au contact de la réalité exté
rieure qu'il appréhende, car sujet et objet fusionnent dans un mouve
ment incessant.
On saisira peut-être ce qui vient d'être dit si l'on rappelle ici que le
point de vue de Hegel est historique.
Or l'on a pu constater, au cours de
la brève histoire de la philosophie que contiennent les pages précéden
tes, qu'effectivement,
les modes d'appréhension des différents philoso
phes varient
au cours du temps, et du même coup modifient l'objet
même dont
ils débattent.
L'Etre des Grecs n'est pas le Dieu des clas
siques, et la problématique de !'Antiquité n'est pas celle des XVII' et
XVIII' siècles : ce qui aboutit à des hommes profondément différents.
Sujet et objet sont donc
en interaction dès le départ dans l'œuvre de
Hegel, et cette interaction - là est le point de vue spécifique de Hegel
-est une relation d'identité.
C'est ce qu'exprime la célèbre formule de
la Phénoménologie de /'Esprit:« Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce
qui est réel est rationnel.
» Le rationnel -l'activité de la pensée -est en
liaison d'identité avec l'objet qu'il cherche à appréhender- le réel.
On voit comment Hegel dépasse le moment kantien : le nouvel objet
d'analyse intègre
la critique kantienne - on passe des idées métaphy
siques et
des principes de la connaissance au devenir historique - ce qui
permet d'écarter les strictes délimitations du philosophe de Koenigsberg
et de retrouver l'union du sujet et de l'objet comme a priori.
Dialectique hégélienne et Esprit
Cette interaction identitaire et progressive du sujet et de l'objet n'est
pas désordonnée et sans but final.
Elle n'est pas une simple juxtaposi
tion
des savoirs, une révélation toujours plus claire de !'Esprit.
Pour la philosophie pré-hégélienne, un système philosophique a pour
but
de remplacer l'autre car il est seul vrai.
Les philosophes se critiquent
ainsi volontiers les uns les autres pour mieux imposer leur propre pen
sée comme
la vérité.
Hegel, au contraire, grâce à la perspective histo
rique, fait de toutes les pensées -philosophiques et autres -des mani
festations d'une seule et unique vérité, celle de !'Esprit.
C'est ce princi
pe d'unité qui permet d'expliquer comme une totalité aussi bien l'his
toire
de la conscience humaine que celle de la logique ou encore celle
de la nature.
Ces manifestations se succèdent les unes aux autres selon un schéma
de progression qui est la dialectique hégélienne.
C'est ce schéma qui
permet essentiellement de comprendre l'unité profonde de la progres
sion du réel, qui est aussi la progression de la compréhension de ce réel.
Il est composé de trois moments dont chacun constitue un dépasse
ment
de l'autre.
Cette succession se répète à l'infini, le troisième
-151-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Théorie de la reconnaissance dans la philosophie de Hegel
- PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE OU DROIT, ou Droit naturel et science de l’État en abrégé, Georg Wilhelm Friedrich Hegel
- CONTRIBUTION A LA CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT DE HEGEL (résumé & analyse)
- PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT - Hegel (résumé et analyse de l’oeuvre)
- LEÇONS SUR L’HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - résumé de l'oeuvre