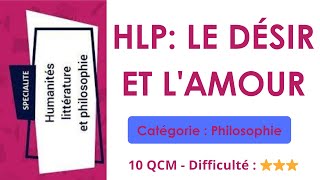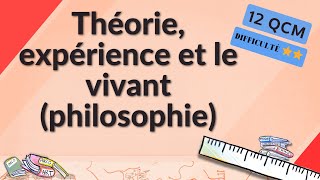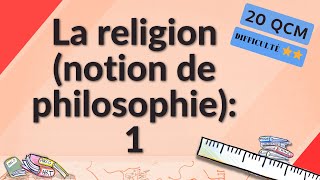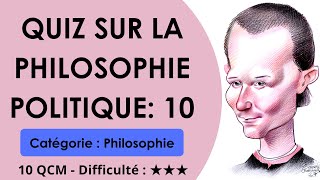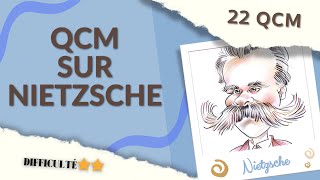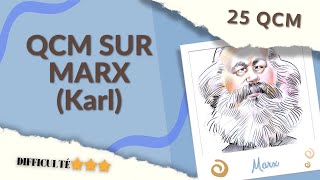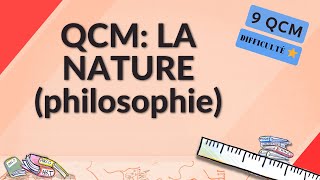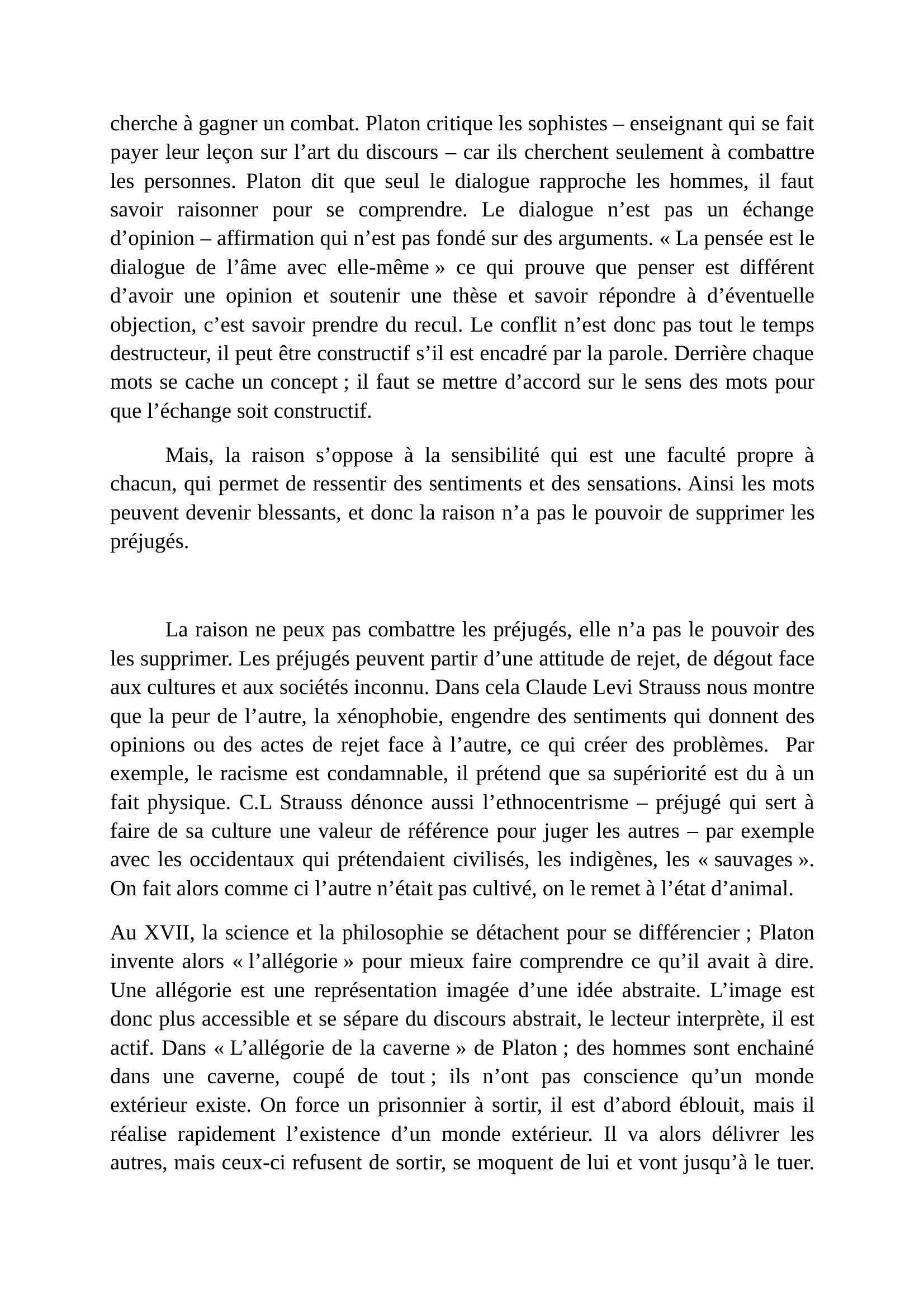La raison peut-elle combattre les préjugés ?
Publié le 16/12/2012
Extrait du document
«
cherche à gagner un combat.
Platon critique les sophistes – enseignant qui se fait
payer leur leçon sur l’art du discours – car ils cherchent seulement à combattre
les personnes.
Platon dit que seul le dialogue rapproche les hommes, il faut
savoir raisonner pour se comprendre.
Le dialogue n’est pas un échange
d’opinion – affirmation qui n’est pas fondé sur des arguments.
« La pensée est le
dialogue de l’âme avec elle-même » ce qui prouve que penser est différent
d’avoir une opinion et soutenir une thèse et savoir répondre à d’éventuelle
objection, c’est savoir prendre du recul.
Le conflit n’est donc pas tout le temps
destructeur, il peut être constructif s’il est encadré par la parole.
Derrière chaque
mots se cache un concept ; il faut se mettre d’accord sur le sens des mots pour
que l’échange soit constructif.
Mais, la raison s’oppose à la sensibilité qui est une faculté propre à
chacun, qui permet de ressentir des sentiments et des sensations.
Ainsi les mots
peuvent devenir blessants, et donc la raison n’a pas le pouvoir de supprimer les
préjugés.
La raison ne peux pas combattre les préjugés, elle n’a pas le pouvoir des
les supprimer.
Les préjugés peuvent partir d’une attitude de rejet, de dégout face
aux cultures et aux sociétés inconnu.
Dans cela Claude Levi Strauss nous montre
que la peur de l’autre, la xénophobie, engendre des sentiments qui donnent des
opinions ou des actes de rejet face à l’autre, ce qui créer des problèmes.
Par
exemple, le racisme est condamnable, il prétend que sa supériorité est du à un
fait physique.
C.L Strauss dénonce aussi l’ethnocentrisme – préjugé qui sert à
faire de sa culture une valeur de référence pour juger les autres – par exemple
avec les occidentaux qui prétendaient civilisés, les indigènes, les « sauvages ».
On fait alors comme ci l’autre n’était pas cultivé, on le remet à l’état d’animal.
Au XVII, la science et la philosophie se détachent pour se différencier ; Platon
invente alors « l’allégorie » pour mieux faire comprendre ce qu’il avait à dire.
Une allégorie est une représentation imagée d’une idée abstraite.
L’image est
donc plus accessible et se sépare du discours abstrait, le lecteur interprète, il est
actif.
Dans « L’allégorie de la caverne » de Platon ; des hommes sont enchainé
dans une caverne, coupé de tout ; ils n’ont pas conscience qu’un monde
extérieur existe.
On force un prisonnier à sortir, il est d’abord éblouit, mais il
réalise rapidement l’existence d’un monde extérieur.
Il va alors délivrer les
autres, mais ceux-ci refusent de sortir, se moquent de lui et vont jusqu’à le tuer..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Maine de Biran écrit dans son journal, en 1822 : « Une personne que je croyais spirituelle me niait aujourd'hui qu'il y ait énergie sans passion et elle paraît avoir lié étroitement ces deux idées. J'ai soutenu fortement que là où il y avait passion entraînante, il n'y avait point de véritable énergie, malgré tous les signes de la plus grande force déployée. La véritable énergie est employée à combattre, et non à suivre les passions. » A qui donnez-vous raison : à Maine de Biran ou à S
- Faut-il combattre les préjugés ?
- La raison exige-t-elle de renoncer à tous nos préjugés ?
- Peut-on combattre les préjugés ?
- "On la nomme (l'opinion) la reine du monde ; elle l'est si bien, que quand la raison veut la combattre, la raison est condamnée à mort." Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764. Commentez cette citation.