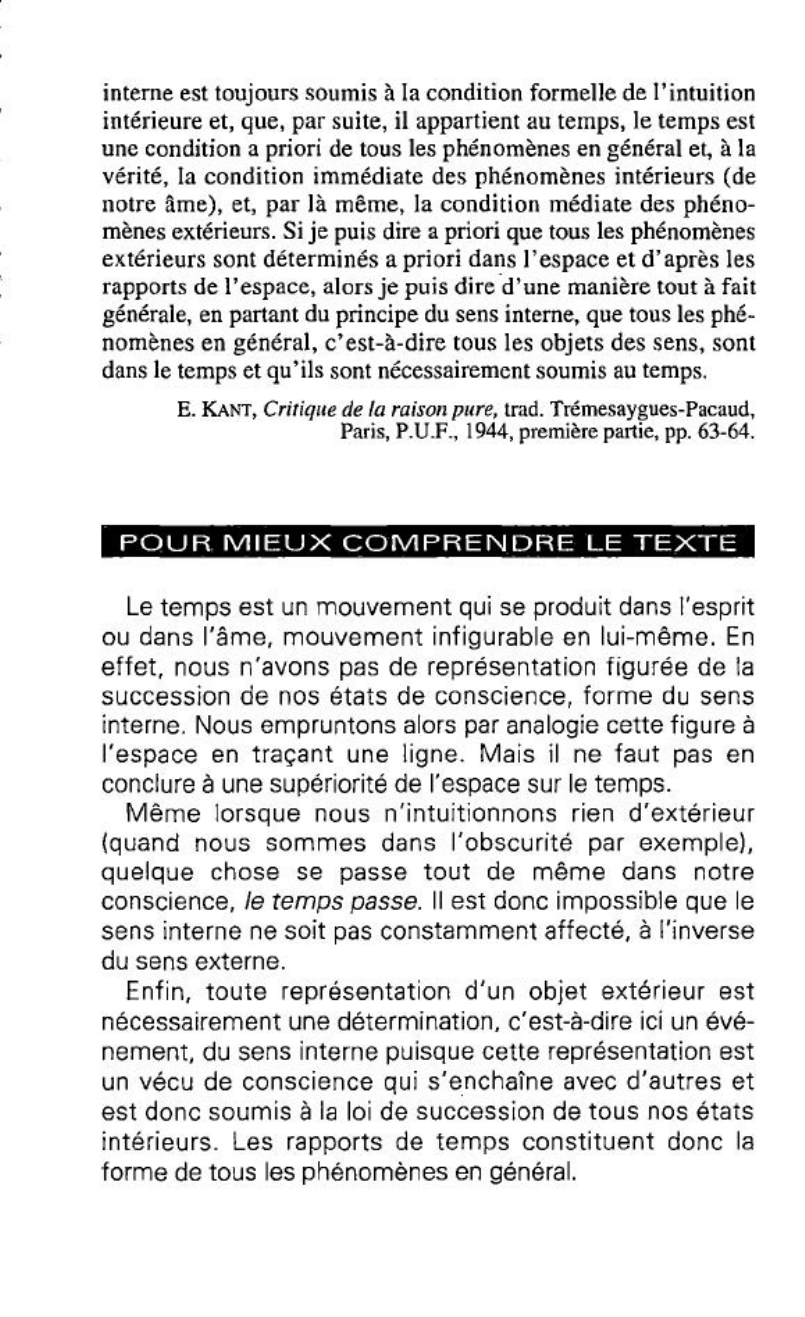Le temps est la forme du sens interne chez E. KANT
Publié le 09/01/2020

Extrait du document


«
interne est toujours soumis à la condi tion forme lle de l'intu ition inté rieure et, que, par suite, il appartient au tem ps, le temps est une condition a prio ri de tous les phénomènes en généra l et, à la vérité, la cond ition immédiate des phén omènes intérieurs (de notre âme), et, par là même, la cond ition médiate des phén o mènes extérieurs .
Si je puis dire a priori que tous les phéno mènes extérieurs sont déterm inés a prio ri dans l'espace et d'a près les rappo rts de l'espace, alor s je puis dire ·d'une manière tout à fait générale, en partan t du principe du sens interne, que tous les phé
nomènes en généra l, c'est-à-dire tous les objets des sens, sont dans le temps et qu'ils sont néces sairement soumis au temps .
E.
KA NT, Critique de la raison pure, trad .
Trémesaygues-Pacaud, Paris, P.U.F., 1944, première part ie, pp.
63-64 .
POUR MIEUX COMPRENDRE LE TEXTE
Le temps est un mouvement qu i se produ it dans l'esprit
ou dans l'âme, mouv ement infigurab le en lui-même.
En
effe t, nous n'avons pas de représentation figurée de la
succession de nos états de conscience, forme du sens
int erne.
Nous empruntons alors par analogie cette figure à l'espace en traçant une lign e.
Mais il ne faut pas en
conclure à une supér iorité de l'espace sur le temps.
Mê me lorsque nous n'intu itionnons rien d'ex térieur
(quand nous sommes dans l'obscurité par exemp le),
quelque chose se passe tout de même dans notre
conscience, le remps passe.
Il est donc impossible que le
sens interne ne soit pas constamment affecté, à l'inverse
du sens externe.
Enf in, toute représentat ion d'un objet extérieur est
nécessairement une détermination.
c'est-à-dire ici un évé
nemen t, du sens interne puisque cette représentation est
un vécu de conscience qu i s'e .nchaîne avec d'autres et
est donc soumis à la loi de succession de tous nos états
intéri eurs.
Les rapports de temps constituent donc la
forme de tous les phénomènes en généra l..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- «Le temps n'est autre chose quela forme du sens interne» Kant. Commentez cette citation.
- KANT : le temps, forme a priori de la sensibilité
- Dans Ce bel aujourd'hui, Jacques Lacarrière écrit: «J'aime ce siècle où je suis né. Je m'y sens bien et je n 'ai jamais feint, comme tant d'autres, de m'y croire inadapté ou exilé. [...]Je n'ai ni regrets ni remords d'être un homme de ce temps. » Partagez-vous la satisfaction de cet auteur contemporain d'être un homme de ce temps ? Vous présenterez les réflexions que vous inspire ce point de vue sous une forme organisée en vous appuyant sur des exemples précis et diversifiés.
- On pouvait lire dans Les Lettres françaises du 25 février 1954 (Gallimard) ces lignes de Thomas Mann : «Le classicisme, ce n'est pas quelque chose d'exemplaire ; en général, et hors du temps, même s'il a beaucoup et tout à faire avec les deux idées implicites ici, celle d'une forme, et celle de la précellence de cette forme. Bien loin de là, le classicisme est plutôt cet exemple tel qu'il a été réalisé, la première création d'une forme de vie spirituelle se manifestant dans la vie indi
- « L'homme a un penchant à s'associer, car dans un tel état, il se sent plus qu'homme par le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension à se détacher (s'isoler), car il trouve en même temps en lui le caractère d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens. » Kant, Idée d'une histoire universelle, 1784. Commentez cette citation.