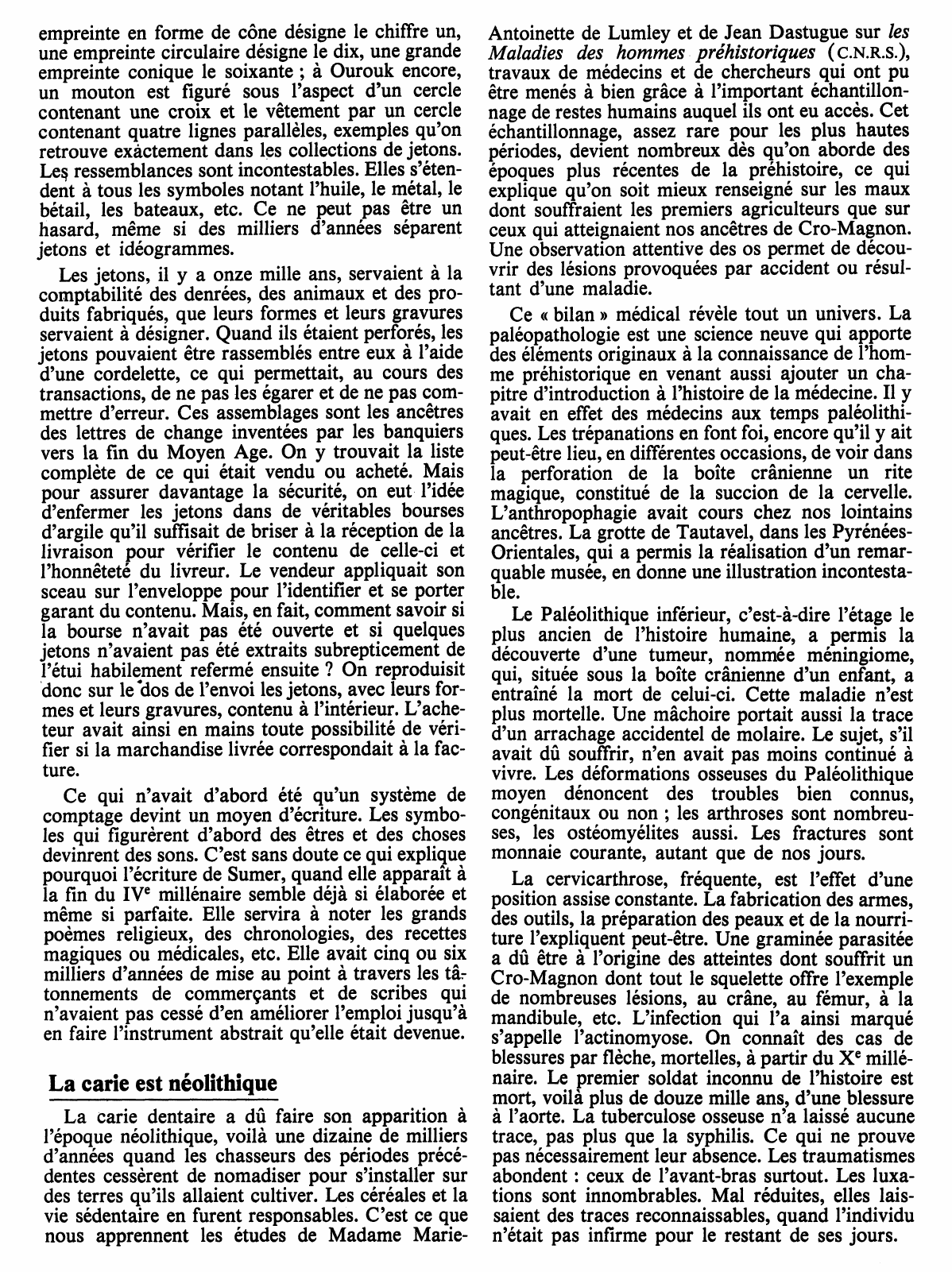L'écriture dérive-t-elle du calcul ?
Publié le 06/12/2011

Extrait du document
Il est généralement admis que l'écriture serait née à la fin du IVe millénaire avant notre ère dans les cités sumériennes de Mésopotamie. On sait ainsi que les scribes d'une ville comme Ourouk avaient su mettre au point un système de notations constitué de chiffres, de pictogrammes et d'idéogrammes. L'idéogramme représente un objet, un animal ou un homme ; le pictogramme, qui s'en inspire, ne retient plus l'image ainsi représentée mais un son. On est ainsi passé d'un système de lecture semblable à celui des rébus à un système conventionnel et abstrait où l'image avait perdu sa signification première. Ce qui s'est produit dans la vallée de l'Euphrate et du Tigre a eu lieu également sur les bords du Nil. Par l'intermédiaire des Phéniciens, les vieux hiéroglyphes égyptiens engendreront les grecs de l'alphabet grec, la première, A n'étant à l'origine qu'une tête de taureau renversée qui n'avait plus qu'une valeur phonétique.
«
empreinte en forme de cône désigne le chiffre un,
une empreinte circulaire désigne le dix, une grande
empreinte conique le soixante ; à Ourouk encore,
un mouton est figuré sous l'aspect d'un cercle
contenant une croix et
le vêtement par un cercle
contenant quatre lignes parallèles, exemples qu'on
retrouve exactement dans
les collections de jetons.
Le~ ressemblances sont incontestables.
Elles s'éten
dent à tous les symboles notant l'huile, le métal, le bétail, les bateaux, etc.
Ce ne peut pas être un
hasard, même si des milliers d'années séparent
jetons et idéogrammes.
Les jetons, il y a onze mille ans, servaient à la
comptabilité des denrées, des animaux et des pro
duits fabriqués, que leurs formes et leurs gravures
servaient à désigner.
Quand ils étaient perforés, les jetons pouvaient être rassemblés entre eux à l'aide
d'une cordelette, ce qui permettait, au cours des transactions, de ne pas les égarer et de ne pas com
mettre d'erreur.
Ces assemblages sont les ancêtres
des lettres de change inventées par les banquiers
vers la fin du Moyen Age.
On y trouvait la liste
complète de ce qui était vendu ou acheté.
Mais
pour assurer davantage la sécurité, on eut l'idée
d'enfermer
les jetons dans de véritables bourses
d'argile qu'il suffisait de briser à la réception de la
livraison pour vérifier le contenu de celle-ci et
l'honnêteté du livreur.
Le vendeur appliquait son
sceau sur l'enveloppe pour l'identifier et se porter
garant du contenu.
Mais, en fait, comment savoir si la bourse n'avait pas été ouverte et si quelques
jetons n'avaient pas été extraits subrepticement de l'étui habilement refermé ensuite? On reproduisit
donc sur le ·dos de l'envoi les jetons, avec leurs for mes et leurs gravures, contenu à l'intérieur.
L'ache
teur avait ainsi en mains toute possibilité de véri
fier si la marchandise livrée correspondait à la fac
ture.
Ce qui n'avait d'abord été qu'un système
de comptage devint un moyen d'écriture.
Les symboles qui figurèrent d'abord des êtres et des choses
devinrent des sons.
C'est sans doute ce qui explique
pourquoi l'écriture de Sumer, quand elle apparaît à
la fin du IV" millénaire semble déjà si élaborée et même si parfaite.
Elle servira à noter les grands
poèmes religieux, des chronologies, des recettes
magiques ou médicales, etc.
Elle avait cinq ou
six milliers d'années de mise au point à travers les tâ" tonnements de commerçants et de scribes qui
n'avaient pas cessé d'en améliorer l'emploi jusqu'à
en faire l'instrument abstrait qu'elle était devenue.
La carie est néolithique
La carie dentaire a dû faire son apparition à
l'époque néolithique, voilà une dizaine de milliers
d'années quand les chasseurs des périodes précé
dentes cessèrent de nomadiser pour s'installer sur des terres qu'ils allaient cultiver.
Les céréales et la
vie sédentaire en furent responsables.
C'est ce que nous apprennent les études de Madame Marie-Antoinette
de Lumley
et de Jean Dastugue sur les Maladies des hommes préhistoriques (c.N.R.S.), travaux de médecins et de chercheurs qui ont pu
être menés à bien grâce à l'important échantillon
nage de restes humains auquel ils ont eu accès.
Cet
échantillonnage, assez rare pour les plus hautes
périodes, devient nombreux dès qu'on aborde des époques plus récentes de la préhistoire, ce qui
explique qu'on soit mieux renseigné sur les maux
dont souffraient les premiers agriculteurs que sur
ceux qui atteignaient nos ancêtres de Cro- Magnon.
Une observation attentive des os permet de décou
vrir des lésions provoquées par accident ou résul
tant d'une maladie.
Ce « bilan )) médical révèle tout un univers.
La
paléopathologie est une science neuve qui apporte
des éléments originaux à la connaissance de l'hom me préhistorique en venant aussi ajouter un cha
pitre d'introduction à l'histoire de la médecine.
Il y
avait en effet des médecins aux temps paléolithi
ques.
Les trépanations en font foi, encore qu'il y ait
peut-être lieu, en différentes occasions, de voir dans
la perforation de la boîte crânienne un rite
magique, constitué de la succion de la cervelle.
L'anthropophagie avait cours chez nos lointains
ancêtres.
La grotte
de Tautavel, dans les Pyrénées
Orientales, qui a permis la réalisation d'un remar
quable musée, en donne une illustration incontesta
ble.
Le Paléolithique inférieur, c'est-à-dire l'étage le plus ancien de l'histoire humaine, a permis la
découverte d'une tumeur, nommée méningiome,
qui, située sous la boîte crânienne d'un enfant, a
entraîné la mort
de celui-ci.
Cette maladie n'est
plus mortelle.
Une mâchoire portait aussi la trace
d'un arrachage accidentel de molaire.
Le sujet, s'il
avait dû souffrir, n'en avait pas moins continué à
vivre.
Les déformations osseuses du Paléolithique
moyen dénoncent des troubles bien connus,
congénitaux ou non ; les arthroses sont nombreu ses, les ostéomyélites aussi.
Les fractures sont
monnaie courante, autant que de nos jours.
La cervicarthrose, fréquente, est l'effet d'une
position assise constante.
La fabrication des armes,
des outils, la préparation des peaux et de la nourri
ture l'expliquent peut-être.
Une graminée parasitée
a dû être à l'origine des atteintes dont souffrit un
Cro-Magnon dont tout le squelette offre l'exemple de nombreuses lésions, au crâne, au fémur, à la
mandibule, etc.
L'infection qui l'a ainsi marqué
s'appelle l'actinomyose.
On connaît des cas de blessures par flèche, mortelles, à partir du x• millé
naire.
Le premier soldat inconnu de l'histoire est
mort, voilà plus de douze mille ans, d'une blessure
à l'aorte.
La tuberculose osseuse n'a laissé aucune
trace, pas plus que la syphilis.
Ce qui ne prouve
pas nécessairement leur absence.
Les traumatismes
abondent: ceux
de l'avant-bras surtout.
Les luxa
tions sont innombrables.
Mal réduites, elles lais
saient
des traces reconnaissables, quand l'individu
n'était pas infirme pour le restant de ses jours..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Comment l’astronomie, la navigation et le calcul bancaire sont-ils à l’origine de l’invention des logarithmes ?
- Mémoire, histoire et écriture dans l'invention du désert
- L’écriture comme la seule voix audible de l’exilé ?
- En quoi l’écriture de soi peut-elle nous rapprocher de l’autre ?
- Calcul Matriciel MPSIA