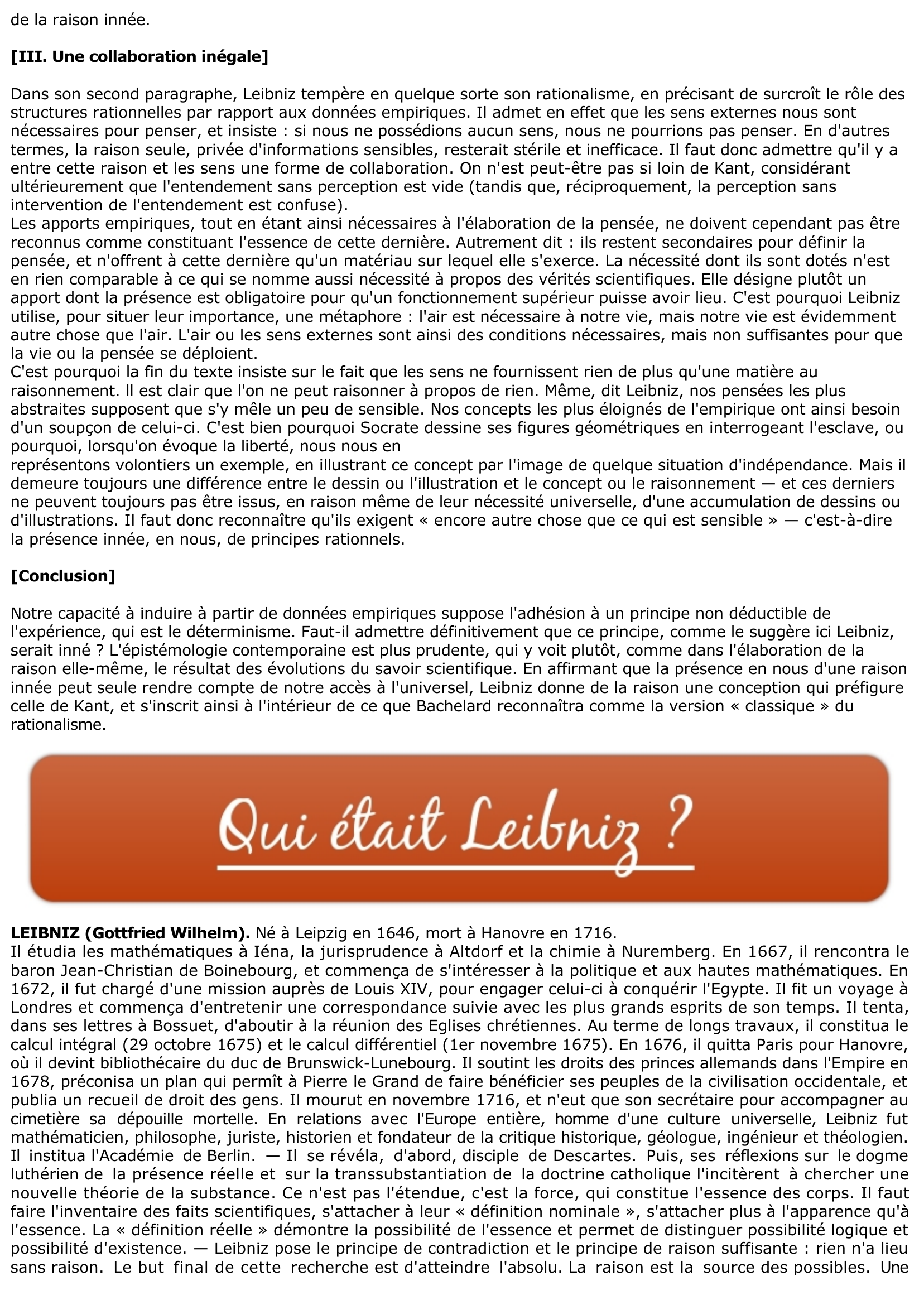LEIBNIZ: Connaissance et raison
Publié le 30/03/2005

Extrait du document
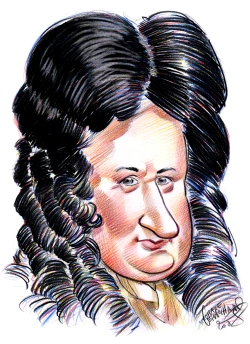
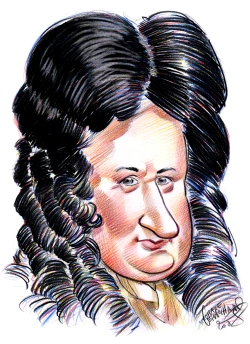
«
de la raison innée.
[III.
Une collaboration inégale]
Dans son second paragraphe, Leibniz tempère en quelque sorte son rationalisme, en précisant de surcroît le rôle desstructures rationnelles par rapport aux données empiriques.
Il admet en effet que les sens externes nous sontnécessaires pour penser, et insiste : si nous ne possédions aucun sens, nous ne pourrions pas penser.
En d'autrestermes, la raison seule, privée d'informations sensibles, resterait stérile et inefficace.
Il faut donc admettre qu'il y aentre cette raison et les sens une forme de collaboration.
On n'est peut-être pas si loin de Kant, considérantultérieurement que l'entendement sans perception est vide (tandis que, réciproquement, la perception sansintervention de l'entendement est confuse).Les apports empiriques, tout en étant ainsi nécessaires à l'élaboration de la pensée, ne doivent cependant pas êtrereconnus comme constituant l'essence de cette dernière.
Autrement dit : ils restent secondaires pour définir lapensée, et n'offrent à cette dernière qu'un matériau sur lequel elle s'exerce.
La nécessité dont ils sont dotés n'esten rien comparable à ce qui se nomme aussi nécessité à propos des vérités scientifiques.
Elle désigne plutôt unapport dont la présence est obligatoire pour qu'un fonctionnement supérieur puisse avoir lieu.
C'est pourquoi Leibnizutilise, pour situer leur importance, une métaphore : l'air est nécessaire à notre vie, mais notre vie est évidemmentautre chose que l'air.
L'air ou les sens externes sont ainsi des conditions nécessaires, mais non suffisantes pour quela vie ou la pensée se déploient.C'est pourquoi la fin du texte insiste sur le fait que les sens ne fournissent rien de plus qu'une matière auraisonnement.
ll est clair que l'on ne peut raisonner à propos de rien.
Même, dit Leibniz, nos pensées les plusabstraites supposent que s'y mêle un peu de sensible.
Nos concepts les plus éloignés de l'empirique ont ainsi besoind'un soupçon de celui-ci.
C'est bien pourquoi Socrate dessine ses figures géométriques en interrogeant l'esclave, oupourquoi, lorsqu'on évoque la liberté, nous nous enreprésentons volontiers un exemple, en illustrant ce concept par l'image de quelque situation d'indépendance.
Mais ildemeure toujours une différence entre le dessin ou l'illustration et le concept ou le raisonnement — et ces derniersne peuvent toujours pas être issus, en raison même de leur nécessité universelle, d'une accumulation de dessins oud'illustrations.
Il faut donc reconnaître qu'ils exigent « encore autre chose que ce qui est sensible » — c'est-à-direla présence innée, en nous, de principes rationnels.
[Conclusion]
Notre capacité à induire à partir de données empiriques suppose l'adhésion à un principe non déductible del'expérience, qui est le déterminisme.
Faut-il admettre définitivement que ce principe, comme le suggère ici Leibniz,serait inné ? L'épistémologie contemporaine est plus prudente, qui y voit plutôt, comme dans l'élaboration de laraison elle-même, le résultat des évolutions du savoir scientifique.
En affirmant que la présence en nous d'une raisoninnée peut seule rendre compte de notre accès à l'universel, Leibniz donne de la raison une conception qui préfigurecelle de Kant, et s'inscrit ainsi à l'intérieur de ce que Bachelard reconnaîtra comme la version « classique » durationalisme.
LEIBNIZ (Gottfried Wilhelm). Né à Leipzig en 1646, mort à Hanovre en 1716. Il étudia les mathématiques à Iéna, la jurisprudence à Altdorf et la chimie à Nuremberg.
En 1667, il rencontra lebaron Jean-Christian de Boinebourg, et commença de s'intéresser à la politique et aux hautes mathématiques.
En1672, il fut chargé d'une mission auprès de Louis XIV, pour engager celui-ci à conquérir l'Egypte.
Il fit un voyage àLondres et commença d'entretenir une correspondance suivie avec les plus grands esprits de son temps.
Il tenta,dans ses lettres à Bossuet, d'aboutir à la réunion des Eglises chrétiennes.
Au terme de longs travaux, il constitua lecalcul intégral (29 octobre 1675) et le calcul différentiel (1er novembre 1675).
En 1676, il quitta Paris pour Hanovre,où il devint bibliothécaire du duc de Brunswick-Lunebourg.
Il soutint les droits des princes allemands dans l'Empire en1678, préconisa un plan qui permît à Pierre le Grand de faire bénéficier ses peuples de la civilisation occidentale, etpublia un recueil de droit des gens.
Il mourut en novembre 1716, et n'eut que son secrétaire pour accompagner aucimetière sa dépouille mortelle.
En relations avec l'Europe entière, homme d'une culture universelle, Leibniz futmathématicien, philosophe, juriste, historien et fondateur de la critique historique, géologue, ingénieur et théologien.Il institua l'Académie de Berlin.
— Il se révéla, d'abord, disciple de Descartes.
Puis, ses réflexions sur le dogmeluthérien de la présence réelle et sur la transsubstantiation de la doctrine catholique l'incitèrent à chercher unenouvelle théorie de la substance.
Ce n'est pas l'étendue, c'est la force, qui constitue l'essence des corps.
Il fautfaire l'inventaire des faits scientifiques, s'attacher à leur « définition nominale », s'attacher plus à l'apparence qu'àl'essence.
La « définition réelle » démontre la possibilité de l'essence et permet de distinguer possibilité logique etpossibilité d'existence.
— Leibniz pose le principe de contradiction et le principe de raison suffisante : rien n'a lieusans raison.
Le but final de cette recherche est d'atteindre l'absolu.
La raison est la source des possibles.
Une.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La connaissance des vérités nécessaires et éternelles est ce qui nous distingue des simples animaux et nous fait avoir la raison et les sciences, en nous élevant à la connaissance de nous-mêmes et de Dieu. » Leibniz, La Monadologie, 1721 (posth.). Commentez cette citation.
- PRINCIPES DE LA NATURE ET DE LA GRACE FONDÉS EN RAISON Leibniz (résumé et analyse de l’oeuvre)
- PRINCIPES DE LA NATURE ET DE LA GRÂCE FONDÉS EN RAISON de Gottfried Wilhelm Leibniz
- LA CONNAISSANCE ET LA RAISON - COURNOT
- La raison, cause de notre jugement ou cause dans les choses ? G. W. LEIBNIZ