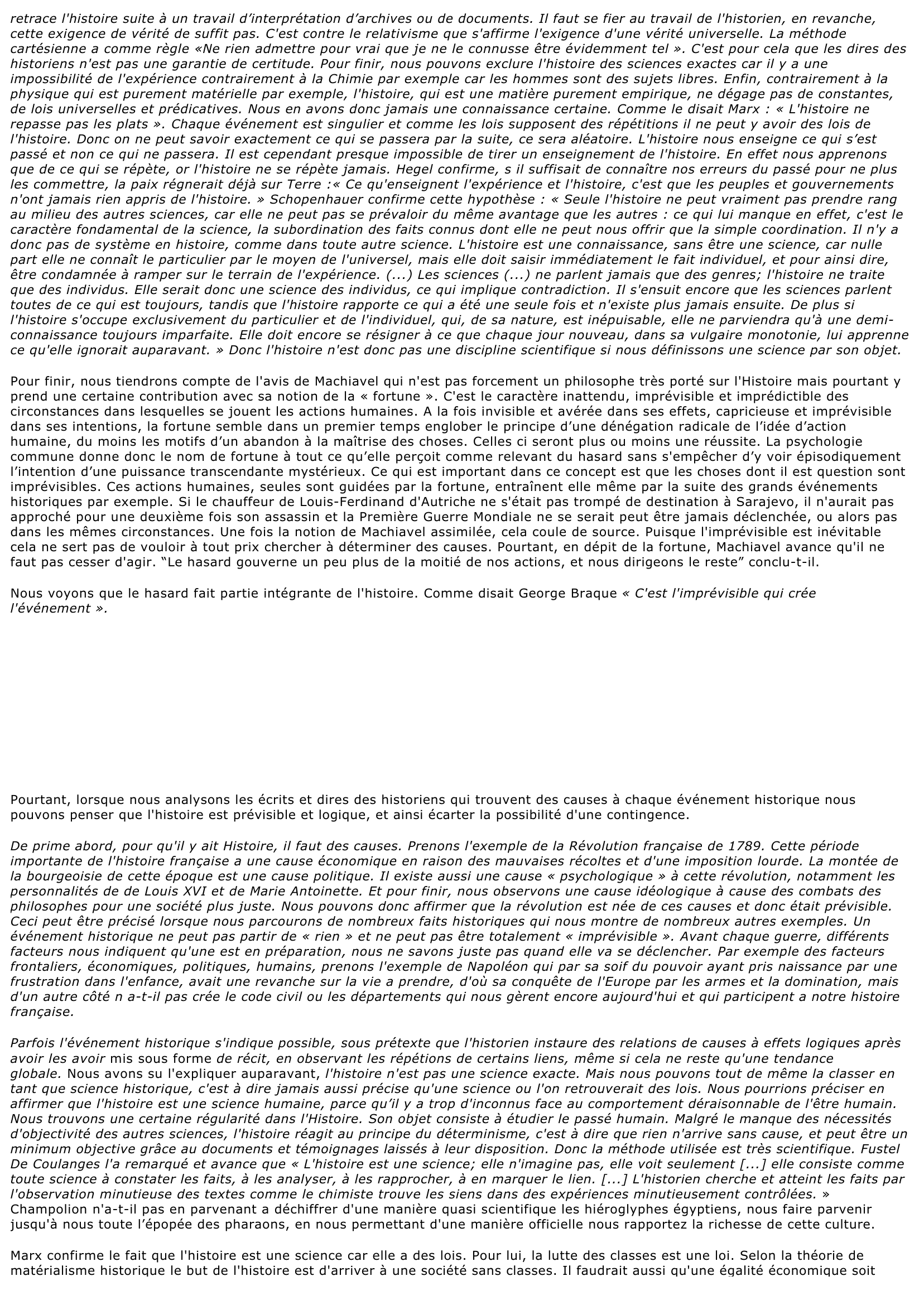L'Histoire est elle le règne du hasard ?
Publié le 25/03/2012

Extrait du document

La notion d'histoire est complexe à développer, dévoilant son double contenu. Son usage commun recèle beaucoup de contradictions et d'incertitudes alors qu'il apparaît sous une apparence familière. Il est facile de dire que ce n'est que l'étude du passé humain. Or l'histoire désigne à la fois la connaissance d'une matière et la matière de cette connaissance. Nous pourrions dire que l'histoire est l'étude de l'histoire. Elle se distingue donc de la géologie. Il est reconnu de dater la naissance du récit historique au moment de l'invention de l'écriture puisque la discipline consiste à reconstituer le passé à partir de traces écrites, notamment avec des documents et témoignages, ou bien encore des monuments. Le terme histoire peut très bien être utilisé au sens policier puisqu'il signifie « enquête «, à la recherche de faits à partir des événements. Or le propre de celui ci est de faire rupture et d'être déstabilisant. Néanmoins, après le travail de l'historien, chaque événement paraît inévitable. Ce dernier ne prend pas en compte la contingence possible dans ses études. Il sous estime cette idée car si l'histoire est aussi inéducable nous aurions dû être au courant de ce qui se passait et peut être ainsi éviter les grands drames historiques. La notion de hasard est également une notion difficile à définir car abstraite. Du point de vue métaphysique manichéen, le concept de hasard pur, absolu est une absurdité: ce qui le représente est le phénomène de probabilité, mais le hasard lui-même, est une notion portant sur l'existence réelle, ce dont nous avons dit qu'elle n'était pas un concept logique. Parler de hasard, c'est faire abstraction de l'influence des choix certains de la liberté qui en est l'origine, l'écarter pour minimiser le phénomène à son apparence matérielle et rationnelle, tel que le décrivent les probabilités.

«
retrace l'histoire suite à un travail d’interprétation d’archives ou de documents.
Il faut se fier au travail de l'historien, en revanche,cette exigence de vérité de suffit pas.
C'est contre le relativisme que s'affirme l'exigence d'une vérité universelle.
La méthodecartésienne a comme règle «Ne rien admettre pour vrai que je ne le connusse être évidemment tel ». C'est pour cela que les dires des historiens n'est pas une garantie de certitude.
Pour finir, nous pouvons exclure l'histoire des sciences exactes car il y a uneimpossibilité de l'expérience contrairement à la Chimie par exemple car les hommes sont des sujets libres.
Enfin, contrairement à laphysique qui est purement matérielle par exemple, l'histoire, qui est une matière purement empirique, ne dégage pas de constantes,de lois universelles et prédicatives.
Nous en avons donc jamais une connaissance certaine.
Comme le disait Marx : « L'histoire nerepasse pas les plats ».
Chaque événement est singulier et comme les lois supposent des répétitions il ne peut y avoir des lois del'histoire.
Donc on ne peut savoir exactement ce qui se passera par la suite, ce sera aléatoire.
L'histoire nous enseigne ce qui s’estpassé et non ce qui ne passera.
Il est cependant presque impossible de tirer un enseignement de l'histoire.
En effet nous apprenonsque de ce qui se répète, or l'histoire ne se répète jamais. Hegel confirme, s il suffisait de connaître nos erreurs du passé pour ne plus les commettre, la paix régnerait déjà sur Terre :« Ce qu'enseignent l'expérience et l'histoire, c'est que les peuples et gouvernementsn'ont jamais rien appris de l'histoire.
» Schopenhauer confirme cette hypothèse : « Seule l'histoire ne peut vraiment pas prendre rang au milieu des autres sciences, car elle ne peut pas se prévaloir du même avantage que les autres : ce qui lui manque en effet, c'est lecaractère fondamental de la science, la subordination des faits connus dont elle ne peut nous offrir que la simple coordination.
Il n'y adonc pas de système en histoire, comme dans toute autre science.
L'histoire est une connaissance, sans être une science, car nulle part elle ne connaît le particulier par le moyen de l'universel, mais elle doit saisir immédiatement le fait individuel, et pour ainsi dire,être condamnée à ramper sur le terrain de l'expérience.
(...) Les sciences (...) ne parlent jamais que des genres; l'histoire ne traiteque des individus.
Elle serait donc une science des individus, ce qui implique contradiction.
Il s'ensuit encore que les sciences parlenttoutes de ce qui est toujours, tandis que l'histoire rapporte ce qui a été une seule fois et n'existe plus jamais ensuite.
De plus sil'histoire s'occupe exclusivement du particulier et de l'individuel, qui, de sa nature, est inépuisable, elle ne parviendra qu'à une demi-connaissance toujours imparfaite.
Elle doit encore se résigner à ce que chaque jour nouveau, dans sa vulgaire monotonie, lui apprennece qu'elle ignorait auparavant.
» Donc l'histoire n'est donc pas une discipline scientifique si nous définissons une science par son objet.
Pour finir, nous tiendrons compte de l'avis de Machiavel qui n'est pas forcement un philosophe très porté sur l'Histoire mais pourtant yprend une certaine contribution avec sa notion de la « fortune ».
C'est le caractère inattendu, imprévisible et imprédictible descirconstances dans lesquelles se jouent les actions humaines.
A la fois invisible et avérée dans ses effets, capricieuse et imprévisibledans ses intentions, la fortune semble dans un premier temps englober le principe d’une dénégation radicale de l’idée d’actionhumaine, du moins les motifs d’un abandon à la maîtrise des choses.
Celles ci seront plus ou moins une réussite.
La psychologiecommune donne donc le nom de fortune à tout ce qu’elle perçoit comme relevant du hasard sans s'empêcher d’y voir épisodiquementl’intention d’une puissance transcendante mystérieux.
Ce qui est important dans ce concept est que les choses dont il est question sontimprévisibles.
Ces actions humaines, seules sont guidées par la fortune, entraînent elle même par la suite des grands événementshistoriques par exemple.
Si le chauffeur de Louis-Ferdinand d'Autriche ne s'était pas trompé de destination à Sarajevo, il n'aurait pasapproché pour une deuxième fois son assassin et la Première Guerre Mondiale ne se serait peut être jamais déclenchée, ou alors pasdans les mêmes circonstances.
Une fois la notion de Machiavel assimilée, cela coule de source.
Puisque l'imprévisible est inévitablecela ne sert pas de vouloir à tout prix chercher à déterminer des causes.
Pourtant, en dépit de la fortune, Machiavel avance qu'il nefaut pas cesser d'agir.
“Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions, et nous dirigeons le reste” conclu-t-il.
Nous voyons que le hasard fait partie intégrante de l'histoire.
Comme disait George Braque « C'est l'imprévisible qui crée l'événement ».
Pourtant, lorsque nous analysons les écrits et dires des historiens qui trouvent des causes à chaque événement historique nouspouvons penser que l'histoire est prévisible et logique, et ainsi écarter la possibilité d'une contingence.
De prime abord, pour qu'il y ait Histoire, il faut des causes.
Prenons l'exemple de la Révolution française de 1789.
Cette périodeimportante de l'histoire française a une cause économique en raison des mauvaises récoltes et d'une imposition lourde.
La montée dela bourgeoisie de cette époque est une cause politique.
Il existe aussi une cause « psychologique » à cette révolution, notamment lespersonnalités de de Louis XVI et de Marie Antoinette.
Et pour finir, nous observons une cause idéologique à cause des combats desphilosophes pour une société plus juste.
Nous pouvons donc affirmer que la révolution est née de ces causes et donc était prévisible.Ceci peut être précisé lorsque nous parcourons de nombreux faits historiques qui nous montre de nombreux autres exemples.
Unévénement historique ne peut pas partir de « rien » et ne peut pas être totalement « imprévisible ».
Avant chaque guerre, différents facteurs nous indiquent qu'une est en préparation, nous ne savons juste pas quand elle va se déclencher.
Par exemple des facteursfrontaliers, économiques, politiques, humains, prenons l'exemple de Napoléon qui par sa soif du pouvoir ayant pris naissance par unefrustration dans l'enfance, avait une revanche sur la vie a prendre, d'où sa conquête de l'Europe par les armes et la domination, maisd'un autre côté n a-t-il pas crée le code civil ou les départements qui nous gèrent encore aujourd'hui et qui participent a notre histoirefrançaise.
Parfois l'événement historique s'indique possible, sous prétexte que l'historien instaure des relations de causes à effets logiques aprèsavoir les avoir mis sous forme de récit, en observant les répétions de certains liens, même si cela ne reste qu'une tendance globale. Nous avons su l'expliquer auparavant, l'histoire n'est pas une science exacte.
Mais nous pouvons tout de même la classer en tant que science historique, c'est à dire jamais aussi précise qu'une science ou l'on retrouverait des lois.
Nous pourrions préciser enaffirmer que l'histoire est une science humaine, parce qu’il y a trop d'inconnus face au comportement déraisonnable de l'être humain.Nous trouvons une certaine régularité dans l'Histoire.
Son objet consiste à étudier le passé humain.
Malgré le manque des nécessitésd'objectivité des autres sciences, l'histoire réagit au principe du déterminisme, c'est à dire que rien n'arrive sans cause, et peut être unminimum objective grâce au documents et témoignages laissés à leur disposition.
Donc la méthode utilisée est très scientifique.
FustelDe Coulanges l'a remarqué et avance que « L'histoire est une science; elle n'imagine pas, elle voit seulement [...] elle consiste commetoute science à constater les faits, à les analyser, à les rapprocher, à en marquer le lien.
[...] L'historien cherche et atteint les faits parl'observation minutieuse des textes comme le chimiste trouve les siens dans des expériences minutieusement contrôlées.
» Champolion n'a-t-il pas en parvenant a déchiffrer d'une manière quasi scientifique les hiéroglyphes égyptiens, nous faire parvenirjusqu'à nous toute l’épopée des pharaons, en nous permettant d'une manière officielle nous rapportez la richesse de cette culture.
Marx confirme le fait que l'histoire est une science car elle a des lois.
Pour lui, la lutte des classes est une loi.
Selon la théorie dematérialisme historique le but de l'histoire est d'arriver à une société sans classes.
Il faudrait aussi qu'une égalité économique soit.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'histoire est-elle le règne du hasard ?
- L'Histoire est elle le règne du hasard ?
- HISTOIRE DU RÈGNE DE L'EMPEREUR CHARLES-QUINT [The History of the Reign of the Emperor Charles V].
- Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique: Y a-t-il un sens de l’Histoire ? Ou l’Histoire va-t-elle au hasard ?
- LA SIGNIFICATION DE L'HISTOIRE : Peut-on envisager le devenir historique entièrement tracé d'avance et une fois pour toutes, ou bien alors comme le simple fait du hasard, ou bien encore dépend-il du libre choix de l'homme ?