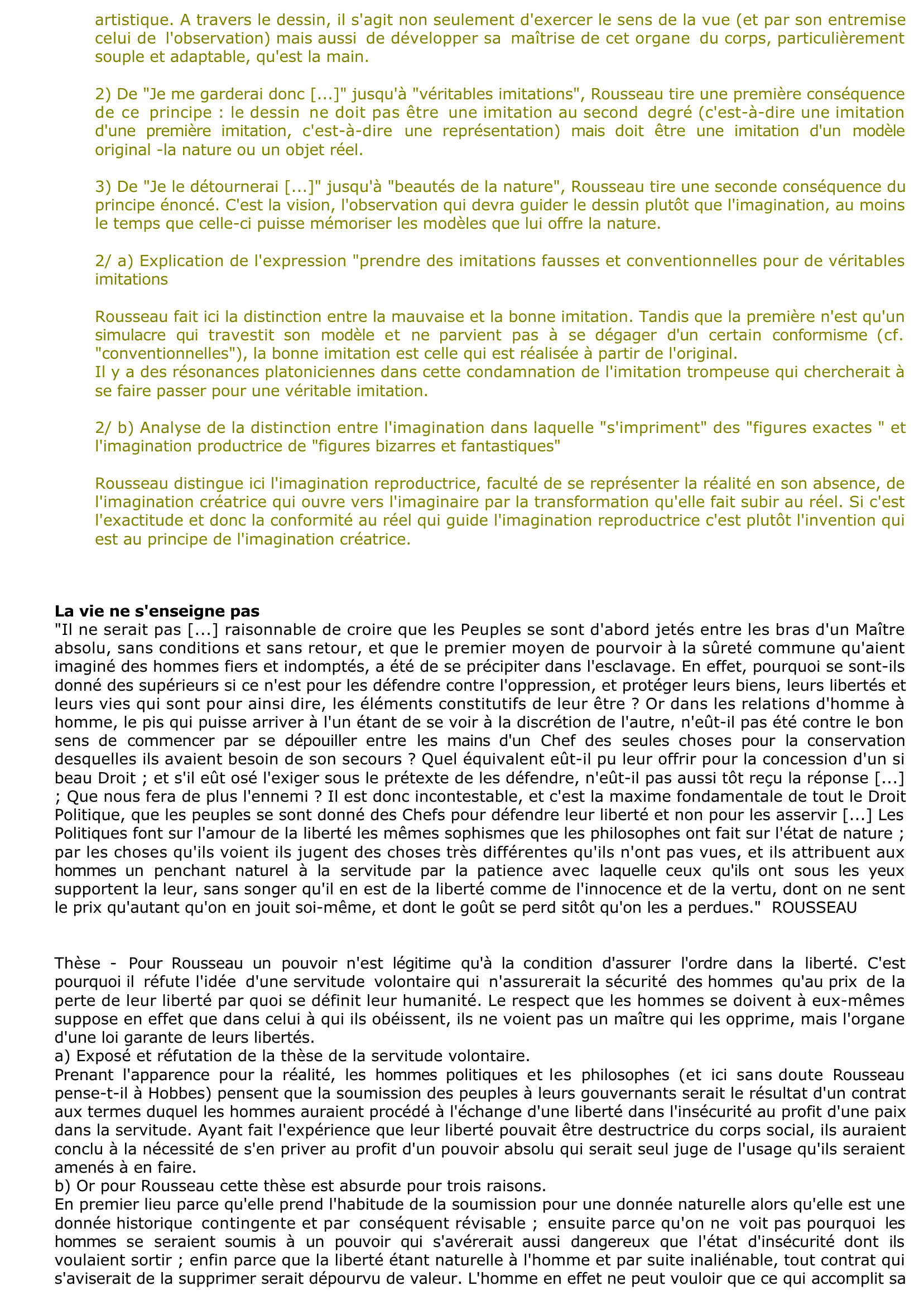L'homme doit-il avoir un maître ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document
«
artistique.
A travers le dessin, il s'agit non seulement d'exercer le sens de la vue (et par son entremisecelui de l'observation) mais aussi de développer sa maîtrise de cet organe du corps, particulièrementsouple et adaptable, qu'est la main.
2) De "Je me garderai donc [...]" jusqu'à "véritables imitations", Rousseau tire une première conséquencede ce principe : le dessin ne doit pas être une imitation au second degré (c'est-à-dire une imitationd'une première imitation, c'est-à-dire une représentation) mais doit être une imitation d'un modèleoriginal -la nature ou un objet réel.
3) De "Je le détournerai [...]" jusqu'à "beautés de la nature", Rousseau tire une seconde conséquence duprincipe énoncé.
C'est la vision, l'observation qui devra guider le dessin plutôt que l'imagination, au moinsle temps que celle-ci puisse mémoriser les modèles que lui offre la nature.
2/ a) Explication de l'expression "prendre des imitations fausses et conventionnelles pour de véritablesimitations
Rousseau fait ici la distinction entre la mauvaise et la bonne imitation.
Tandis que la première n'est qu'unsimulacre qui travestit son modèle et ne parvient pas à se dégager d'un certain conformisme (cf."conventionnelles"), la bonne imitation est celle qui est réalisée à partir de l'original.Il y a des résonances platoniciennes dans cette condamnation de l'imitation trompeuse qui chercherait àse faire passer pour une véritable imitation.
2/ b) Analyse de la distinction entre l'imagination dans laquelle "s'impriment" des "figures exactes " etl'imagination productrice de "figures bizarres et fantastiques"
Rousseau distingue ici l'imagination reproductrice, faculté de se représenter la réalité en son absence, del'imagination créatrice qui ouvre vers l'imaginaire par la transformation qu'elle fait subir au réel.
Si c'estl'exactitude et donc la conformité au réel qui guide l'imagination reproductrice c'est plutôt l'invention quiest au principe de l'imagination créatrice.
La vie ne s'enseigne pas"Il ne serait pas [...] raisonnable de croire que les Peuples se sont d'abord jetés entre les bras d'un Maîtreabsolu, sans conditions et sans retour, et que le premier moyen de pourvoir à la sûreté commune qu'aientimaginé des hommes fiers et indomptés, a été de se précipiter dans l'esclavage.
En effet, pourquoi se sont-ilsdonné des supérieurs si ce n'est pour les défendre contre l'oppression, et protéger leurs biens, leurs libertés etleurs vies qui sont pour ainsi dire, les éléments constitutifs de leur être ? Or dans les relations d'homme àhomme, le pis qui puisse arriver à l'un étant de se voir à la discrétion de l'autre, n'eût-il pas été contre le bonsens de commencer par se dépouiller entre les mains d'un Chef des seules choses pour la conservationdesquelles ils avaient besoin de son secours ? Quel équivalent eût-il pu leur offrir pour la concession d'un sibeau Droit ; et s'il eût osé l'exiger sous le prétexte de les défendre, n'eût-il pas aussi tôt reçu la réponse [...]; Que nous fera de plus l'ennemi ? Il est donc incontestable, et c'est la maxime fondamentale de tout le DroitPolitique, que les peuples se sont donné des Chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir [...] LesPolitiques font sur l'amour de la liberté les mêmes sophismes que les philosophes ont fait sur l'état de nature ;par les choses qu'ils voient ils jugent des choses très différentes qu'ils n'ont pas vues, et ils attribuent auxhommes un penchant naturel à la servitude par la patience avec laquelle ceux qu'ils ont sous les yeuxsupportent la leur, sans songer qu'il en est de la liberté comme de l'innocence et de la vertu, dont on ne sentle prix qu'autant qu'on en jouit soi-même, et dont le goût se perd sitôt qu'on les a perdues." ROUSSEAU
Thèse - Pour Rousseau un pouvoir n'est légitime qu'à la condition d'assurer l'ordre dans la liberté.
C'estpourquoi il réfute l'idée d'une servitude volontaire qui n'assurerait la sécurité des hommes qu'au prix de laperte de leur liberté par quoi se définit leur humanité.
Le respect que les hommes se doivent à eux-mêmessuppose en effet que dans celui à qui ils obéissent, ils ne voient pas un maître qui les opprime, mais l'organed'une loi garante de leurs libertés.a) Exposé et réfutation de la thèse de la servitude volontaire.Prenant l'apparence pour la réalité, les hommes politiques et les philosophes (et ici sans doute Rousseaupense-t-il à Hobbes) pensent que la soumission des peuples à leurs gouvernants serait le résultat d'un contrataux termes duquel les hommes auraient procédé à l'échange d'une liberté dans l'insécurité au profit d'une paixdans la servitude.
Ayant fait l'expérience que leur liberté pouvait être destructrice du corps social, ils auraientconclu à la nécessité de s'en priver au profit d'un pouvoir absolu qui serait seul juge de l'usage qu'ils seraientamenés à en faire.b) Or pour Rousseau cette thèse est absurde pour trois raisons.En premier lieu parce qu'elle prend l'habitude de la soumission pour une donnée naturelle alors qu'elle est unedonnée historique contingente et par conséquent révisable ; ensuite parce qu'on ne voit pas pourquoi leshommes se seraient soumis à un pouvoir qui s'avérerait aussi dangereux que l'état d'insécurité dont ilsvoulaient sortir ; enfin parce que la liberté étant naturelle à l'homme et par suite inaliénable, tout contrat quis'aviserait de la supprimer serait dépourvu de valeur.
L'homme en effet ne peut vouloir que ce qui accomplit sa.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MAÎTRE DE RIEUX-CHÂTEAUNEUF : Portrait d'homme (analyse du tableau).
- L'homme est-il maître et possesseur de la nature ?
- Alfred de Musset :« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître ».
- Sujet : L'Homme doit-il se rendre maître et possesseur de la nature ?
- L'homme maître et possesseur de la nature