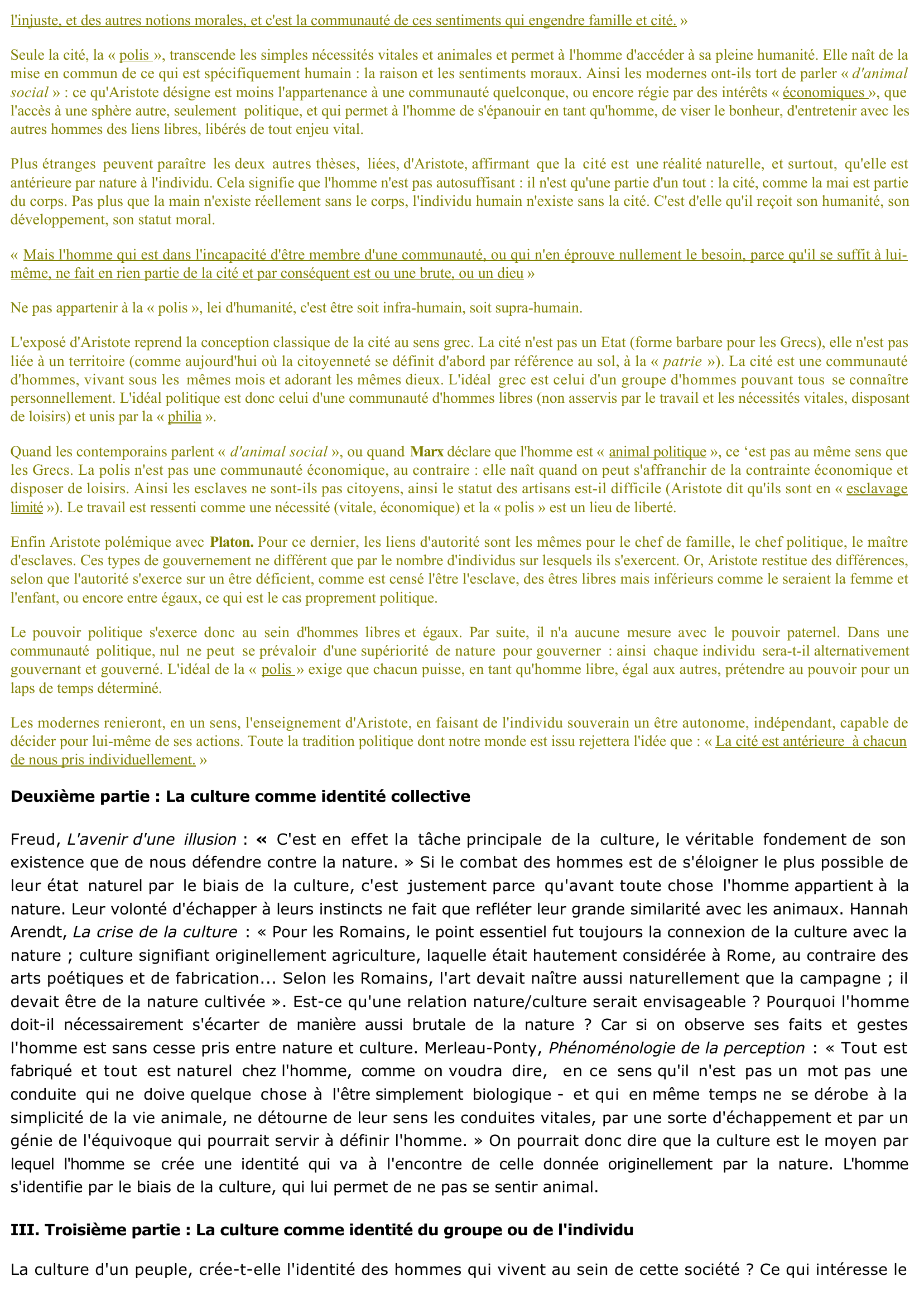l'homme est-il un être culturel ?
Publié le 22/11/2005

Extrait du document
«
l'injuste, et des autres notions morales, et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité. »
Seule la cité, la « polis », transcende les simples nécessités vitales et animales et permet à l'homme d'accéder à sa pleine humanité.
Elle naît de la mise en commun de ce qui est spécifiquement humain : la raison et les sentiments moraux.
Ainsi les modernes ont-ils tort de parler « d'animal social » : ce qu'Aristote désigne est moins l'appartenance à une communauté quelconque, ou encore régie par des intérêts « économiques », que l'accès à une sphère autre, seulement politique, et qui permet à l'homme de s'épanouir en tant qu'homme, de viser le bonheur, d'entretenir avec lesautres hommes des liens libres, libérés de tout enjeu vital.
Plus étranges peuvent paraître les deux autres thèses, liées, d'Aristote, affirmant que la cité est une réalité naturelle, et surtout, qu'elle estantérieure par nature à l'individu.
Cela signifie que l'homme n'est pas autosuffisant : il n'est qu'une partie d'un tout : la cité, comme la mai est partiedu corps.
Pas plus que la main n'existe réellement sans le corps, l'individu humain n'existe sans la cité.
C'est d'elle qu'il reçoit son humanité, sondéveloppement, son statut moral.
« Mais l'homme qui est dans l'incapacité d'être membre d'une communauté, ou qui n'en éprouve nullement le besoin, parce qu'il se suffit à lui-même, ne fait en rien partie de la cité et par conséquent est ou une brute, ou un dieu »
Ne pas appartenir à la « polis », lei d'humanité, c'est être soit infra-humain, soit supra-humain.
L'exposé d'Aristote reprend la conception classique de la cité au sens grec.
La cité n'est pas un Etat (forme barbare pour les Grecs), elle n'est pasliée à un territoire (comme aujourd'hui où la citoyenneté se définit d'abord par référence au sol, à la « patrie »).
La cité est une communauté d'hommes, vivant sous les mêmes mois et adorant les mêmes dieux.
L'idéal grec est celui d'un groupe d'hommes pouvant tous se connaîtrepersonnellement.
L'idéal politique est donc celui d'une communauté d'hommes libres (non asservis par le travail et les nécessités vitales, disposantde loisirs) et unis par la « philia ».
Quand les contemporains parlent « d'animal social », ou quand Marx déclare que l'homme est « animal politique », ce ‘est pas au même sens que les Grecs.
La polis n'est pas une communauté économique, au contraire : elle naît quand on peut s'affranchir de la contrainte économique etdisposer de loisirs.
Ainsi les esclaves ne sont-ils pas citoyens, ainsi le statut des artisans est-il difficile (Aristote dit qu'ils sont en « esclavage limité »).
Le travail est ressenti comme une nécessité (vitale, économique) et la « polis » est un lieu de liberté.
Enfin Aristote polémique avec Platon. Pour ce dernier, les liens d'autorité sont les mêmes pour le chef de famille, le chef politique, le maître d'esclaves.
Ces types de gouvernement ne différent que par le nombre d'individus sur lesquels ils s'exercent.
Or, Aristote restitue des différences,selon que l'autorité s'exerce sur un être déficient, comme est censé l'être l'esclave, des êtres libres mais inférieurs comme le seraient la femme etl'enfant, ou encore entre égaux, ce qui est le cas proprement politique.
Le pouvoir politique s'exerce donc au sein d'hommes libres et égaux.
Par suite, il n'a aucune mesure avec le pouvoir paternel.
Dans unecommunauté politique, nul ne peut se prévaloir d'une supériorité de nature pour gouverner : ainsi chaque individu sera-t-il alternativementgouvernant et gouverné.
L'idéal de la « polis » exige que chacun puisse, en tant qu'homme libre, égal aux autres, prétendre au pouvoir pour un laps de temps déterminé.
Les modernes renieront, en un sens, l'enseignement d'Aristote, en faisant de l'individu souverain un être autonome, indépendant, capable dedécider pour lui-même de ses actions.
Toute la tradition politique dont notre monde est issu rejettera l'idée que : « La cité est antérieure à chacun de nous pris individuellement. »
Deuxième partie : La culture comme identité collective
Freud, L'avenir d'une illusion : « C'est en effet la tâche principale de la culture, le véritable fondement de son existence que de nous défendre contre la nature.
» Si le combat des hommes est de s'éloigner le plus possible deleur état naturel par le biais de la culture, c'est justement parce qu'avant toute chose l'homme appartient à lanature.
Leur volonté d'échapper à leurs instincts ne fait que refléter leur grande similarité avec les animaux.
HannahArendt, La crise de la culture : « Pour les Romains, le point essentiel fut toujours la connexion de la culture avec la nature ; culture signifiant originellement agriculture, laquelle était hautement considérée à Rome, au contraire desarts poétiques et de fabrication...
Selon les Romains, l'art devait naître aussi naturellement que la campagne ; ildevait être de la nature cultivée ».
Est-ce qu'une relation nature/culture serait envisageable ? Pourquoi l'hommedoit-il nécessairement s'écarter de manière aussi brutale de la nature ? Car si on observe ses faits et gestesl'homme est sans cesse pris entre nature et culture.
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception : « Tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en ce sens qu'il n'est pas un mot pas uneconduite qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique - et qui en même temps ne se dérobe à lasimplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par une sorte d'échappement et par ungénie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme.
» On pourrait donc dire que la culture est le moyen parlequel l'homme se crée une identité qui va à l'encontre de celle donnée originellement par la nature.
L'hommes'identifie par le biais de la culture, qui lui permet de ne pas se sentir animal.
III.
Troisième partie : La culture comme identité du groupe ou de l'individu
La culture d'un peuple, crée-t-elle l'identité des hommes qui vivent au sein de cette société ? Ce qui intéresse le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'homme est-il UN ÊTRE NATUREL OU CULTUREL?
- L'homme est-il naturellement un être culturel ?
- « En quel sens peut-on dire que l'homme est un être culturel ? »
- A travers le roman et l'adaptation filmique de Frears des Liaisons Dangereuses, comment expliquer que tant de personnages se dévoilent et se confessent, alors que dans un contexte religieux et culturel du XVIIIe siècle, seul un homme d'église est habilité à entendre un pêcheur en confession ?
- L'homme est naturellement culturel et culturellement naturel ?