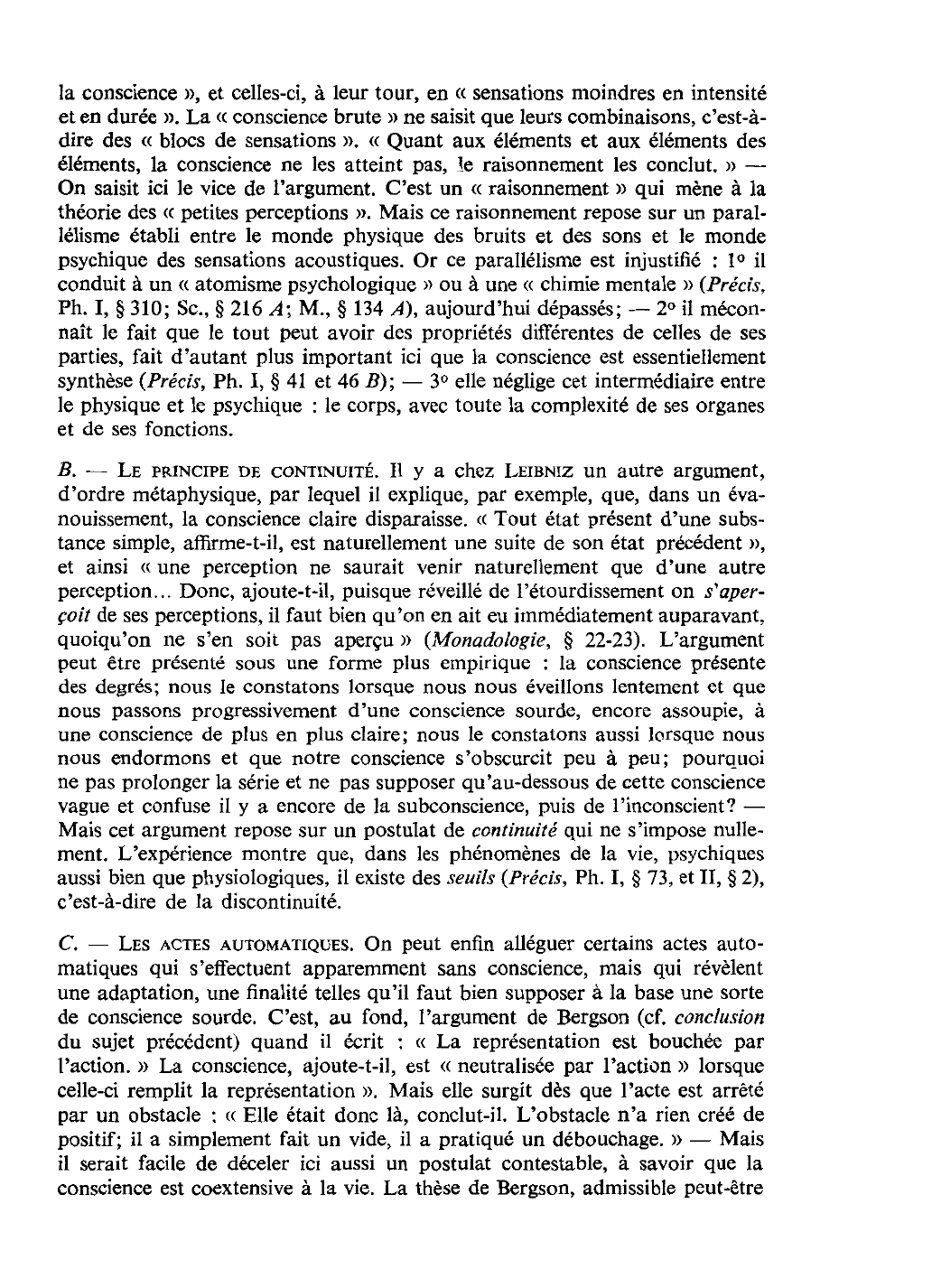L'inconscient est-il prouvable ?
Publié le 04/07/2012
Extrait du document
LE CAS DU RÊVE. Il existe au moins un cas qui nous met en présence d'une activité incontestablement psychique, se déroulant cependant en dehors de la conscience normale : c'est le cas du rêve (Freud). Que le rêve soit de nature psychique, personne ne le conteste plus aujourd'hui : il est même capable, dans une certaine mesure, d'invention et d'organisation. Il n'en est pas moins vrai que Je rêve par son indifférence aux formes de la conscience normale...
«
la conscience», et celles-ci, à leur tour, en «sensations moindres en intensité et en durée>>.
La« conscience brute>> ne saisit que leurs combinaisons, c'est-à
dire des « blocs de sensations ».
« Quant aux éléments et aux éléments des
éléments, la conscience ne les atteint pas, Je raisonnement les conclut.
» - On saisit ici le vice de l'argument.
C'est un «raisonnement>> qui mène à la
théorie des« petites perceptions>>.
Mais ce raisonnement repose sur un paral
lélisme établi entre le monde physique des bruits et des sons et le monde
psychique des sensations acoustiques.
Or ce parallélisme est injustifié : 1° il
conduit à un « atomisme psychologique » ou à une « chimie mentale » (Précis, Ph.
1, § 310; Sc., § 216 A; M.,§ 134 A), aujourd'hui dépassés; - 2° il mécon
naît le fait que le tout peut avoir des propriétés différentes de celles de ses
parties, fait d'autant plus important ici que la conscience est essentiellement
synthèse (Précis, Ph.
1, § 41 et 46 B); - 3° elle néglige cet intermédiaire entre
le physique et le psychique : le corps, avec toute la complexité de ses organes
et de ses fonctions.
B.
- LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ.
Il y a chez LEIBNIZ un autre argument,
d'ordre métaphysique, par lequel il explique, par exemple, que, dans un éva
nouissement, la conscience claire disparaisse.
«Tout état présent d'une subs
tance simple, affirme-t-il, est naturellement une suite de son état précédent », et ainsi «une perception ne saurait venir naturellement que d'une autre
perception ...
Donc, ajoute-t-il, puisque réveillé de l'étourdissement on s'aper
çoit de ses perceptions, il faut bien qu'on en ait eu immédiatement auparavant, quoiqu'on ne s'en soit pas aperçu>> (Monadologie, § 22-23).
L'argument
peut être présenté sous une forme plus empirique : la conscience présente
des degrés; nous le constatons lorsque nous nous éveillons lentement
et que
nous passons progressivement d'une conscience sourde, encore assoupie, à
une conscience de plus en plus claire; nous le constatons aussi lorsque nous
nous endormons et que notre conscience s'obscurcit peu à peu; pourquoi
ne pas prolonger la série et ne pas supposer qu'au-dessous de cette conscience
vague et confuse
il y a encore de la subconscience, puis de l'inconscient? -
Mais cet argument repose sur un postulat de continuité qui ne s'impose nulle
ment.
L'expérience montre que, dans les phénomènes de la vie, psychiques
aussi bien que physiologiques, il existe des
seuils (Précis, Ph.
1, § 73, et II, § 2), c'est-à-dire de la discontinuité.
C.
- LEs ACTES AUTOMATIQUES.
On peut enfin alléguer certains actes auto
matiques qui s'effectuent apparemment sans conscience, mais qui révèlent
une adaptation, une finalité telles qu'il faut bien supposer à la base une sorte
de conscience sourde.
C'est,
au fond, l'argument de Bergson (cf.
conclusion du sujet précédent) quand il écrit : « La représentation est bouchée par l'action.
>> La conscience, ajoute-t-il, est « neutralisée par 1 'action » lorsque
celle-ci remplit la représentation ».
Mais elle surgit dès que 1 'acte est arrêté par un obstacle :.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Leçon :LACONSCIENCEETL’INCONSCIENT
- ***** - L'Inconscient (cours complet de philosophie - *****
- Peut-il y avoir une science de l'inconscient ?
- Une théorie de l’inconscient psychique est-elle nécessaire pour expliquer les comportements humains ?
- L'inconscient de Freud