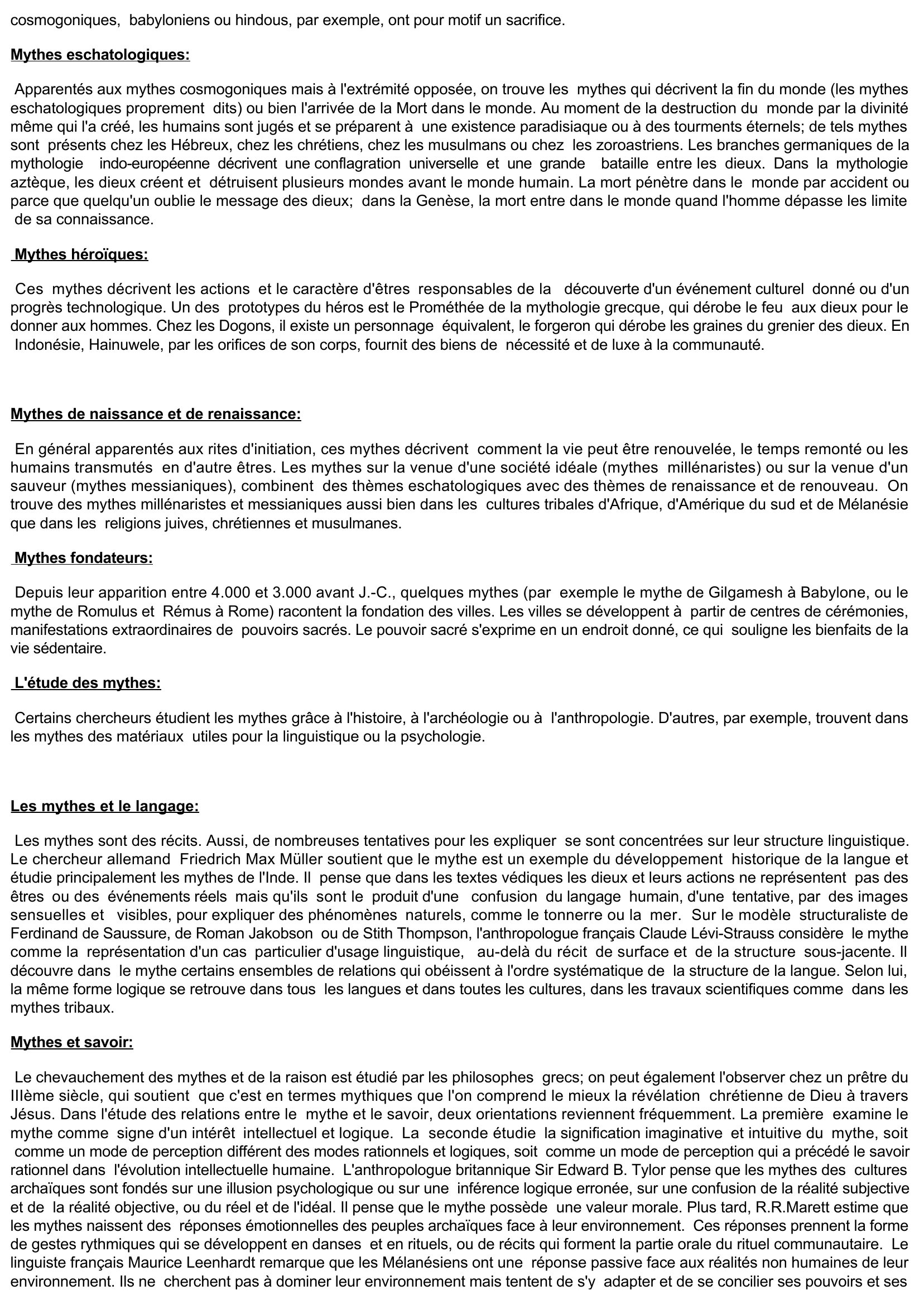Mythe et Culture
Publié le 22/02/2012

Extrait du document


«
cosmogoniques, babyloniens ou hindous, par exemple, ont pour motif un sacrifice.
Mythes eschatologiques:
Apparentés aux mythes cosmogoniques mais à l'extrémité opposée, on trouve les mythes qui décrivent la fin du monde (les mytheseschatologiques proprement dits) ou bien l'arrivée de la Mort dans le monde.
Au moment de la destruction du monde par la divinitémême qui l'a créé, les humains sont jugés et se préparent à une existence paradisiaque ou à des tourments éternels; de tels mythessont présents chez les Hébreux, chez les chrétiens, chez les musulmans ou chez les zoroastriens.
Les branches germaniques de lamythologie indo-européenne décrivent une conflagration universelle et une grande bataille entre les dieux.
Dans la mythologieaztèque, les dieux créent et détruisent plusieurs mondes avant le monde humain.
La mort pénètre dans le monde par accident ouparce que quelqu'un oublie le message des dieux; dans la Genèse, la mort entre dans le monde quand l'homme dépasse les limite de sa connaissance.
Mythes héroïques:
Ces mythes décrivent les actions et le caractère d'êtres responsables de la découverte d'un événement culturel donné ou d'unprogrès technologique.
Un des prototypes du héros est le Prométhée de la mythologie grecque, qui dérobe le feu aux dieux pour ledonner aux hommes.
Chez les Dogons, il existe un personnage équivalent, le forgeron qui dérobe les graines du grenier des dieux.
En Indonésie, Hainuwele, par les orifices de son corps, fournit des biens de nécessité et de luxe à la communauté.
Mythes de naissance et de renaissance:
En général apparentés aux rites d'initiation, ces mythes décrivent comment la vie peut être renouvelée, le temps remonté ou leshumains transmutés en d'autre êtres.
Les mythes sur la venue d'une société idéale (mythes millénaristes) ou sur la venue d'unsauveur (mythes messianiques), combinent des thèmes eschatologiques avec des thèmes de renaissance et de renouveau.
Ontrouve des mythes millénaristes et messianiques aussi bien dans les cultures tribales d'Afrique, d'Amérique du sud et de Mélanésieque dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes.
Mythes fondateurs:
Depuis leur apparition entre 4.000 et 3.000 avant J.-C., quelques mythes (par exemple le mythe de Gilgamesh à Babylone, ou lemythe de Romulus et Rémus à Rome) racontent la fondation des villes.
Les villes se développent à partir de centres de cérémonies,manifestations extraordinaires de pouvoirs sacrés.
Le pouvoir sacré s'exprime en un endroit donné, ce qui souligne les bienfaits de lavie sédentaire.
L'étude des mythes:
Certains chercheurs étudient les mythes grâce à l'histoire, à l'archéologie ou à l'anthropologie.
D'autres, par exemple, trouvent dansles mythes des matériaux utiles pour la linguistique ou la psychologie.
Les mythes et le langage:
Les mythes sont des récits.
Aussi, de nombreuses tentatives pour les expliquer se sont concentrées sur leur structure linguistique.Le chercheur allemand Friedrich Max Müller soutient que le mythe est un exemple du développement historique de la langue etétudie principalement les mythes de l'Inde.
Il pense que dans les textes védiques les dieux et leurs actions ne représentent pas desêtres ou des événements réels mais qu'ils sont le produit d'une confusion du langage humain, d'une tentative, par des imagessensuelles et visibles, pour expliquer des phénomènes naturels, comme le tonnerre ou la mer.
Sur le modèle structuraliste deFerdinand de Saussure, de Roman Jakobson ou de Stith Thompson, l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss considère le mythecomme la représentation d'un cas particulier d'usage linguistique, au-delà du récit de surface et de la structure sous-jacente.
Ildécouvre dans le mythe certains ensembles de relations qui obéissent à l'ordre systématique de la structure de la langue.
Selon lui,la même forme logique se retrouve dans tous les langues et dans toutes les cultures, dans les travaux scientifiques comme dans lesmythes tribaux.
Mythes et savoir:
Le chevauchement des mythes et de la raison est étudié par les philosophes grecs; on peut également l'observer chez un prêtre duIIIème siècle, qui soutient que c'est en termes mythiques que l'on comprend le mieux la révélation chrétienne de Dieu à traversJésus.
Dans l'étude des relations entre le mythe et le savoir, deux orientations reviennent fréquemment.
La première examine lemythe comme signe d'un intérêt intellectuel et logique.
La seconde étudie la signification imaginative et intuitive du mythe, soit comme un mode de perception différent des modes rationnels et logiques, soit comme un mode de perception qui a précédé le savoirrationnel dans l'évolution intellectuelle humaine.
L'anthropologue britannique Sir Edward B.
Tylor pense que les mythes des culturesarchaïques sont fondés sur une illusion psychologique ou sur une inférence logique erronée, sur une confusion de la réalité subjectiveet de la réalité objective, ou du réel et de l'idéal.
Il pense que le mythe possède une valeur morale.
Plus tard, R.R.Marett estime queles mythes naissent des réponses émotionnelles des peuples archaïques face à leur environnement.
Ces réponses prennent la formede gestes rythmiques qui se développent en danses et en rituels, ou de récits qui forment la partie orale du rituel communautaire.
Lelinguiste français Maurice Leenhardt remarque que les Mélanésiens ont une réponse passive face aux réalités non humaines de leurenvironnement.
Ils ne cherchent pas à dominer leur environnement mais tentent de s'y adapter et de se concilier ses pouvoirs et ses.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation sur la culture - Sujet : « Dans quelle mesure peut-on dire que l’on est enfermé dans sa culture ? »
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme
- La culture éloigne-t-elle l’humain de la nature ?
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ADJOINT TECHNIQUE D'ACCUEIL, DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme ?