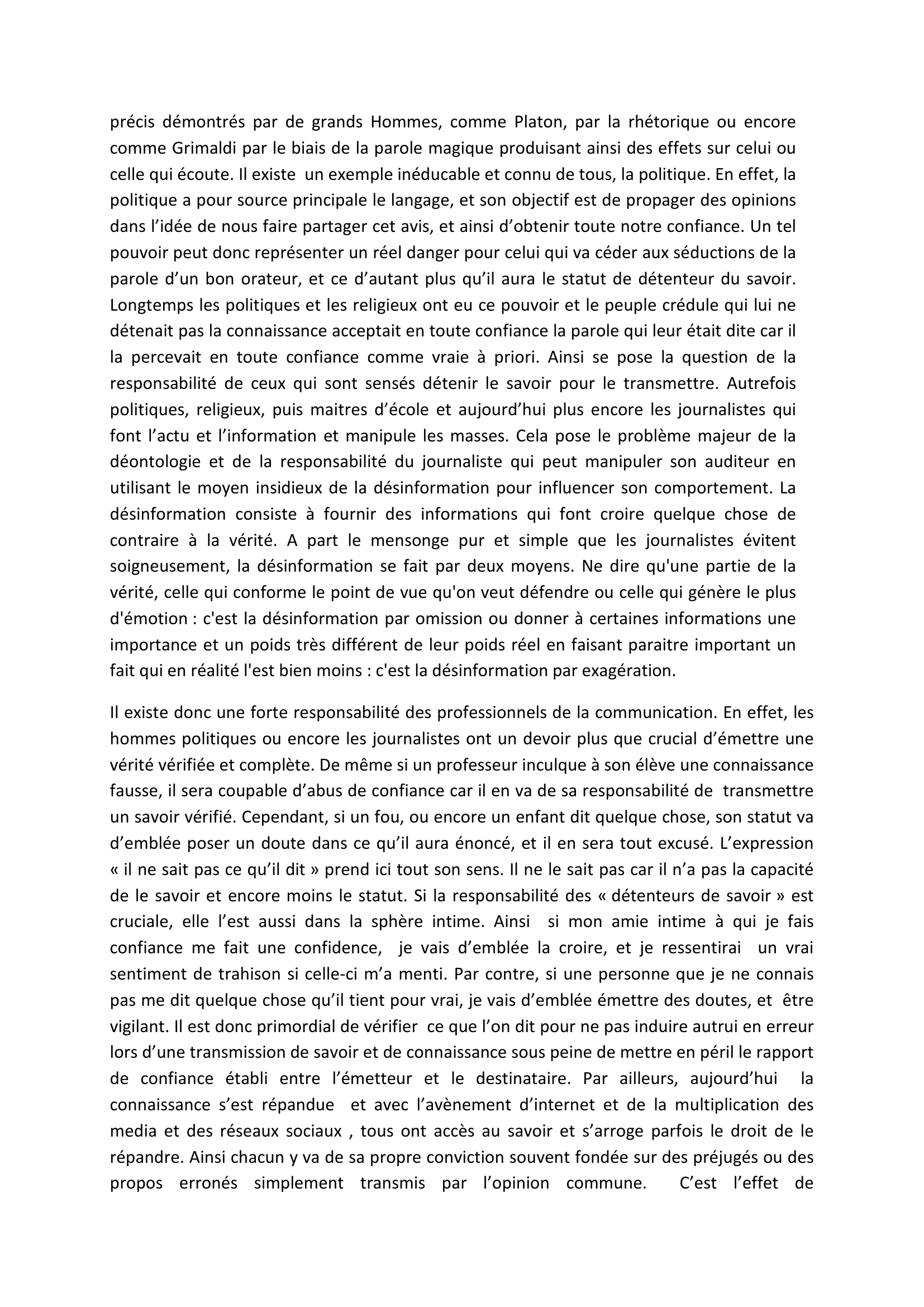Ne devrions nous parler que de ce que nous savons ?
Publié le 23/01/2012

Extrait du document
Le XXIème siècle marque l’avènement de la multiplication des échanges et de la communication. Chacun peut aujourd’hui communiquer, dialoguer dire tout et n’importe quoi avec sa tablette, son I phone ou son ordinateur portable. Autrefois les sages détenaient le savoir et le transmettaient au peuple par la parole. Il y a encore même quelques dizaines d’années les maîtres d’école détenteurs de la connaissance étaient responsables de ce qu’ils transmettaient. Ils leur appartenaient donc de faire le tri et de ne parler que de ce qu’ils savaient. Ainsi la connaissance était transmise selon les règles et selon un code de bonne conduite que leur imposait leur déontologie. Mais, aujourd’hui avec la multiplication des media et de la communication sur internet et des réseaux sociaux se pose la question de l’abus de l’utilisation de la parole. Tout le monde parle à tort et à travers souvent pour ne rien dire et s’arroge le droit d’affirmer ce qu’il tient pour vrai. Il est donc extrêmement difficile de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. On pourrait donc en déduire que chacun devrait se maitriser et avoir sur soi-même un code de bonne conduite qui serait : je ne dois parler que de ce que je sais. Mais pour autant serait-ce suffisant ?
«
précis démontrés par de grands Hommes, comme Platon, par la rhétorique ou encore
comme Grimaldi par le biais de la parole magique produisant ainsi des effets sur celui ou
celle qui écoute.
Il existe un exemple inéducable et connu de tous, la politique.
En effet, la
politique a pour source principale le langage, et son objectif est de propager des opinions
dans l’idée de nous faire partager cet avis, et ainsi d’obtenir toute notre confiance.
Un tel
pouvoir peut donc représente r un réel danger pour celui qui va céder aux séductions de la
parole d’un bon or ateur, et ce d’autant plus qu’il aura le statut de détenteur du savoir .
Longtemps les politiques et les religieux ont eu ce pouvoir et le peuple crédule qui lui ne
détenait pas la connaissance acceptait en toute confiance la parole qui leur était dite car il
la percevait en toute c onfiance comme vraie à priori.
Ainsi se pose la question de la
responsabilité de ceux qui sont sensés détenir le savoir pour le transmettre.
Autrefois
politiques, religieux, puis maitres d’école et aujourd’hui plus encore les journalistes qui
font l’actu et l’information et manipule les masses.
Cela pose le problème majeur de la
déontologie et de la responsabilité du journaliste qui peut manipuler son auditeur en
utilisant le moyen insidieux de la désinformation pour influencer son comportement.
La
désinformation consiste à fournir des informations qui font croire quelque chose de
contraire à la vérité.
A part le mensonge pur et sim ple que les journalistes évitent
soigneusement, la désinformation se fait par deux moyens .
Ne dire qu'une partie de la
vérité, celle qui conforme le point de vue qu'on veut défendre ou celle qui génère le plus
d'émotion : c'est la désinformation par omission ou d onner à certaines informations une
importance et un poids très différent de leur poids réel en faisant paraitre important un
fait qui en réalité l'est bien moins : c'est la désinformation par exagération.
Il existe donc une forte responsabilité des professionnels de la com munication.
En effet, les
hommes politiques ou encore les journalistes ont un devoir plus que crucia l d’émettre une
vérité vérifiée et complète .
De même si un professeur inculque à son élève une connaissance
fausse, il sera coupable d’abus de confiance car il en va de sa responsabilité de transmettre
un savoir vérifié.
Cependant, si un fou, ou encore un enfant dit quelque chose, son statut va
d’emblée poser un doute dans ce qu’il aura énoncé, et il en sera tout excusé.
L’expression
« il ne sait pas ce qu’il dit » prend ici tout son sens.
Il ne le sait pas car il n’a pas la capacité
de le savoir et encore moins le statut.
Si la responsabilité des « déte nteurs de savoir » est
cruciale , elle l’est aussi dans la sphère intime.
Ainsi si mon amie intime à qui je fais
confiance me fait une confidence, je vais d’emblée la croire , et je ressentirai un vrai
sentiment de tra hison si celle-ci m’a menti.
Par contre, si une personne que je ne connais
pas me dit quelque chose qu’il tient pour vra i, je vais d’emblée émettre des doutes , et être
vigilant.
Il est donc primordial de vérifier ce que l’on dit pour ne pas induire autrui en erreur
lors d’une transmission de savoir et de connaissance sous peine de mettre en péril le rapport
de confiance é tabli entre l’émetteur et le destinataire .
Par ailleurs, aujourd’hui la
connaissance s’est répandue et avec l’avènement d’internet et de la multiplication des
media et des réseaux sociaux , tous ont accès au savoir et s’arroge parfois le droit de le
répandre.
Ainsi chacun y va de sa propre conviction souvent fondée sur des préjugés ou des
propos erronés simplement transmis par l’opinion commune .
C’est l’effet de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Savons nous ce que nous desirons?
- Dissertation : "Savons-nous qui nous sommes vraiment ?"
- Selon vous, qui devrions-nous choisir comme modèle, Socrate ou les sophistes?
- A-t-on toujours la force d’agir moralement ? Comment définir la morale ? Savons-nous toujours ce qui est moral ?
- P. Valéry écrit : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles; nous avions en¬tendu parler de mondes disparus tout entiers, d'em¬pires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond Inexplorable des siècles, avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs dictionnaires, leurs classiques. leurs roman¬tiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques... Qu'en pensez-vous ?