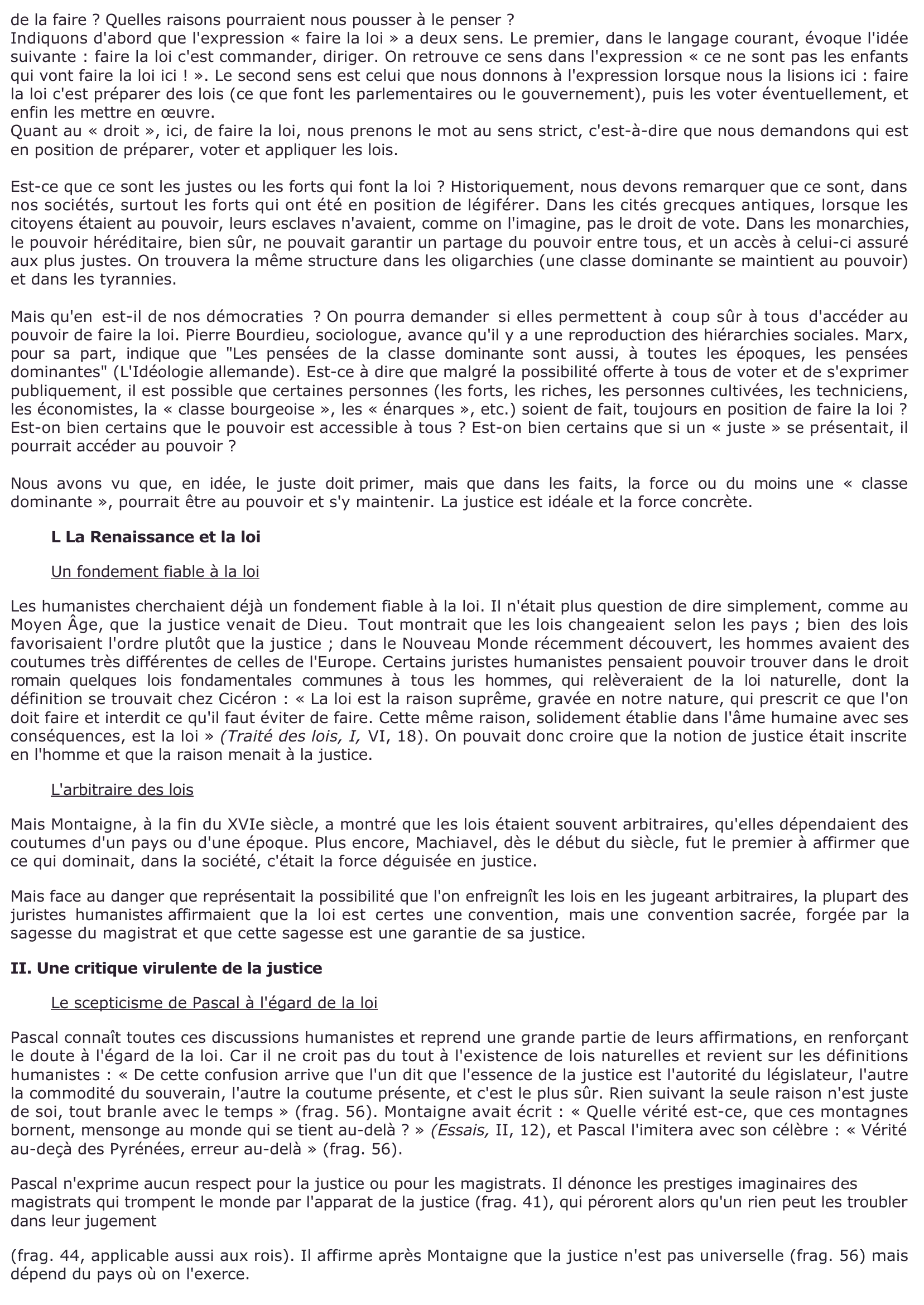Pascal et la justice
Publié le 20/10/2010
Extrait du document

La justice, dans notre texte, est la justice en tant qu'idée, en tant qu'idéal. Elle porte en elle sa propre légitimité : « il est juste que ce qui est juste soit suivi «, mais elle est faible, puisqu'elle n'est qu'une idée (et pas encore une institution), sur laquelle tous ne sont pas d'accord. La force est effective, c'est-à-dire qu'elle a une efficacité pratique. Elle est illégitime (« tyrannique «), si elle n'est pas juste, et en cela elle est faible (le tyran consolidera son pouvoir s'il parvient à le faire passer pour juste); mais elle s'inscrit dans la nécessité (ligne 1), c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir contraignant auquel on n'échappe pas (contrainte physique).

«
de la faire ? Quelles raisons pourraient nous pousser à le penser ?Indiquons d'abord que l'expression « faire la loi » a deux sens.
Le premier, dans le langage courant, évoque l'idéesuivante : faire la loi c'est commander, diriger.
On retrouve ce sens dans l'expression « ce ne sont pas les enfantsqui vont faire la loi ici ! ».
Le second sens est celui que nous donnons à l'expression lorsque nous la lisions ici : fairela loi c'est préparer des lois (ce que font les parlementaires ou le gouvernement), puis les voter éventuellement, etenfin les mettre en œuvre.Quant au « droit », ici, de faire la loi, nous prenons le mot au sens strict, c'est-à-dire que nous demandons qui esten position de préparer, voter et appliquer les lois.
Est-ce que ce sont les justes ou les forts qui font la loi ? Historiquement, nous devons remarquer que ce sont, dansnos sociétés, surtout les forts qui ont été en position de légiférer.
Dans les cités grecques antiques, lorsque lescitoyens étaient au pouvoir, leurs esclaves n'avaient, comme on l'imagine, pas le droit de vote.
Dans les monarchies,le pouvoir héréditaire, bien sûr, ne pouvait garantir un partage du pouvoir entre tous, et un accès à celui-ci assuréaux plus justes.
On trouvera la même structure dans les oligarchies (une classe dominante se maintient au pouvoir)et dans les tyrannies.
Mais qu'en est-il de nos démocraties ? On pourra demander si elles permettent à coup sûr à tous d'accéder aupouvoir de faire la loi.
Pierre Bourdieu, sociologue, avance qu'il y a une reproduction des hiérarchies sociales.
Marx,pour sa part, indique que "Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les penséesdominantes" (L'Idéologie allemande).
Est-ce à dire que malgré la possibilité offerte à tous de voter et de s'exprimerpubliquement, il est possible que certaines personnes (les forts, les riches, les personnes cultivées, les techniciens,les économistes, la « classe bourgeoise », les « énarques », etc.) soient de fait, toujours en position de faire la loi ?Est-on bien certains que le pouvoir est accessible à tous ? Est-on bien certains que si un « juste » se présentait, ilpourrait accéder au pouvoir ?
Nous avons vu que, en idée, le juste doit primer, mais que dans les faits, la force ou du moins une « classedominante », pourrait être au pouvoir et s'y maintenir.
La justice est idéale et la force concrète.
L La Renaissance et la loi
Un fondement fiable à la loi
Les humanistes cherchaient déjà un fondement fiable à la loi.
Il n'était plus question de dire simplement, comme auMoyen Âge, que la justice venait de Dieu.
Tout montrait que les lois changeaient selon les pays ; bien des loisfavorisaient l'ordre plutôt que la justice ; dans le Nouveau Monde récemment découvert, les hommes avaient descoutumes très différentes de celles de l'Europe.
Certains juristes humanistes pensaient pouvoir trouver dans le droitromain quelques lois fondamentales communes à tous les hommes, qui relèveraient de la loi naturelle, dont ladéfinition se trouvait chez Cicéron : « La loi est la raison suprême, gravée en notre nature, qui prescrit ce que l'ondoit faire et interdit ce qu'il faut éviter de faire.
Cette même raison, solidement établie dans l'âme humaine avec sesconséquences, est la loi » (Traité des lois, I, VI, 18).
On pouvait donc croire que la notion de justice était inscrite en l'homme et que la raison menait à la justice.
L'arbitraire des lois
Mais Montaigne, à la fin du XVIe siècle, a montré que les lois étaient souvent arbitraires, qu'elles dépendaient descoutumes d'un pays ou d'une époque.
Plus encore, Machiavel, dès le début du siècle, fut le premier à affirmer quece qui dominait, dans la société, c'était la force déguisée en justice.
Mais face au danger que représentait la possibilité que l'on enfreignît les lois en les jugeant arbitraires, la plupart desjuristes humanistes affirmaient que la loi est certes une convention, mais une convention sacrée, forgée par lasagesse du magistrat et que cette sagesse est une garantie de sa justice.
II.
Une critique virulente de la justice
Le scepticisme de Pascal à l'égard de la loi
Pascal connaît toutes ces discussions humanistes et reprend une grande partie de leurs affirmations, en renforçantle doute à l'égard de la loi.
Car il ne croit pas du tout à l'existence de lois naturelles et revient sur les définitionshumanistes : « De cette confusion arrive que l'un dit que l'essence de la justice est l'autorité du législateur, l'autrela commodité du souverain, l'autre la coutume présente, et c'est le plus sûr.
Rien suivant la seule raison n'est justede soi, tout branle avec le temps » (frag.
56).
Montaigne avait écrit : « Quelle vérité est-ce, que ces montagnesbornent, mensonge au monde qui se tient au-delà ? » (Essais, II, 12), et Pascal l'imitera avec son célèbre : « Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » (frag.
56).
Pascal n'exprime aucun respect pour la justice ou pour les magistrats.
Il dénonce les prestiges imaginaires desmagistrats qui trompent le monde par l'apparat de la justice (frag.
41), qui pérorent alors qu'un rien peut les troublerdans leur jugement
(frag.
44, applicable aussi aux rois).
Il affirme après Montaigne que la justice n'est pas universelle (frag.
56) maisdépend du pays où on l'exerce..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Blaise Pascal, Pensées: La justice et la force
- Comment Pascal envisage-t-il la justice ?
- «Justice-Force»: PASCAL,Pensées
- Pascal : Justice, Force.
- Justice et droit chez Pascal