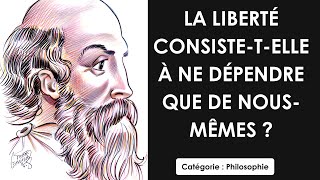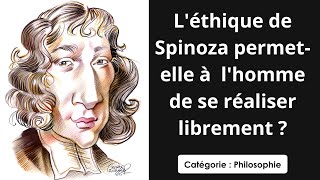Pensez-vous que la science des m?urs importe à la vie morale ?
Publié le 27/02/2008
Extrait du document

. ») au normatif (« nous devons... ») ou,
comme disait H. POINCARE, de l'indicatif à l'impératif, qui est une véritable
faute logique. Il en est de même lorsqu'un peu plus loin, Durkheim écrit que le
« type normal » peut contenir « des contradictions, c'est-à-dire des
imperfections » : il est évident que ce « c'est-à-dire » ne se justifie que pour
qui admet un impératif de cohérence, qui demanderait à être formulé
explicitement. On ne peut pas passer directement, et sans impliquer toutes
sortes de jugements de valeur sous-entendus, de ce qui est (ou même tend à être)
à ce qui doit être.
C. ? En réalité, toute attitude morale demande un choix, ? choix motivé certes,
et la science des moeurs peut contribuer, pour sa part, à le motiver ; mais ce
choix dépasse toujours les données positives qu'elle est capable de fournir.
D. ? De toute façon, la Science des moeurs n'épuise pas l'ensemble des problèmes
moraux qui se posent à la conscience. 1° DURKHEIM lui-même (Soc.
Liens utiles
- MORALE ET LA SCIENCE DES MœURS (LA), Lucien Léw-Bruhl - résumé de l'oeuvre
- MORALE ET LA SCIENCE DES MœURS (La). Lucien Lévy-Bruhl - résumé, analyse
- Madame de Staël écrit on 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap. 11 ) : « Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune: ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent a ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité: mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper
- Les anciens Grecs proposaient comme modèle à la conduite « la vie conforme à la nature ». Quels sens donneriez-vous à cette formule célèbre ? Pensez-vous que cette manière de concevoir la morale puisse être encore la nôtre ?
- Que pensez-vous de la façon dont Antoine Adam voit les rapports de la passion et de la raison au XVIIIe siècle : «Dans ce monde, oeuvre d'un Dieu infiniment sage et bon, comment les passions auraient-elles pu apparaître comme des forces mauvaises ? Comment les nouveaux moralistes auraient-ils opposé, comme ceux de l'ancienne génération, les passions à la raison ? Bien loin de les condamner, ils les proclamaient nécessaires et fécondes. Cette époque, que tant d'historiens accusent d'êtr