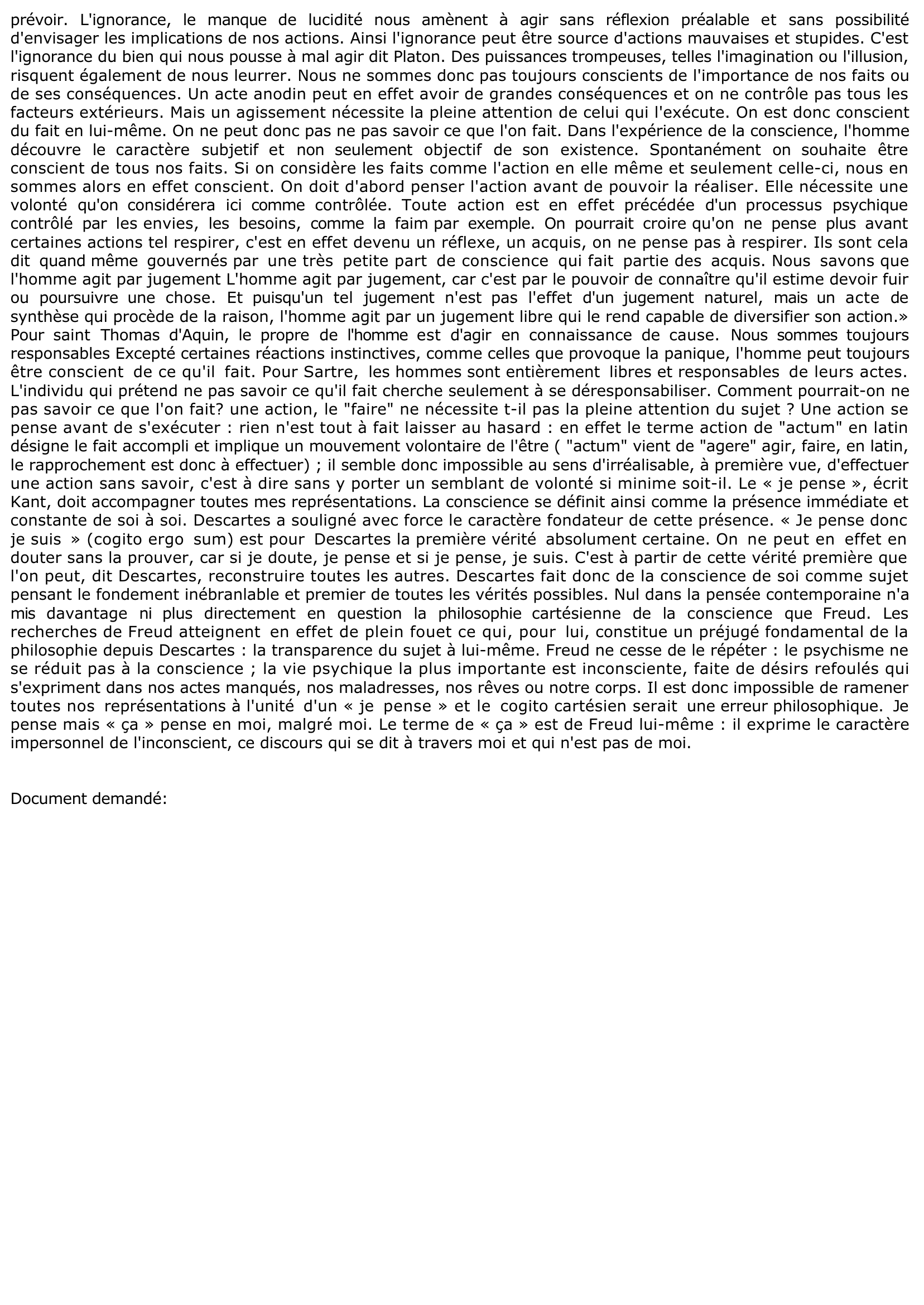Peut-on ne pas savoir ce que l'on fait ?
Publié le 09/11/2011

Extrait du document
Avoir conscience, c'est d'abord prendre acte de quelque chose. Je sais que je suis en Normandie, que j'ai froid, que je dois rendre ma dissertation jeudi. Donc il semble que tous nos actes s'accompagnent d'une conscience immédiate. Mais avoir conscience c'est aussi et surtout avoir la connaissance, or connaître ou comprendre quelque chose, c'est en saisir les causes ou le but, le sens, le contenu. Or si nous savons ce que nous sommes en train de faire, nous ne savons pas nécessairement les raisons et effets de nos agissements. On peut ici penser aux actes irréfléchis, compulsifs ou à tous ces moments où on ne se reconnaît plus. Il est donc possible que nous ne sachions pas ce qui nous pousse à faire telle ou telle chose et où cela nous mène. Dans le sujet « Peut-on ne pas savoir ce que l'on fait ? «, la question porte sur les limites et différents degrés de la conscience humaine.
«
prévoir.
L'ignorance, le manque de lucidité nous amènent à agir sans réflexion préalable et sans possibilitéd'envisager les implications de nos actions.
Ainsi l'ignorance peut être source d'actions mauvaises et stupides.
C'estl'ignorance du bien qui nous pousse à mal agir dit Platon.
Des puissances trompeuses, telles l'imagination ou l'illusion,risquent également de nous leurrer.
Nous ne sommes donc pas toujours conscients de l'importance de nos faits oude ses conséquences.
Un acte anodin peut en effet avoir de grandes conséquences et on ne contrôle pas tous lesfacteurs extérieurs.
Mais un agissement nécessite la pleine attention de celui qui l'exécute.
On est donc conscientdu fait en lui-même.
On ne peut donc pas ne pas savoir ce que l'on fait.
Dans l'expérience de la conscience, l'hommedécouvre le caractère subjetif et non seulement objectif de son existence.
Spontanément on souhaite êtreconscient de tous nos faits.
Si on considère les faits comme l'action en elle même et seulement celle-ci, nous ensommes alors en effet conscient.
On doit d'abord penser l'action avant de pouvoir la réaliser.
Elle nécessite unevolonté qu'on considérera ici comme contrôlée.
Toute action est en effet précédée d'un processus psychiquecontrôlé par les envies, les besoins, comme la faim par exemple.
On pourrait croire qu'on ne pense plus avantcertaines actions tel respirer, c'est en effet devenu un réflexe, un acquis, on ne pense pas à respirer.
Ils sont celadit quand même gouvernés par une très petite part de conscience qui fait partie des acquis.
Nous savons quel'homme agit par jugement L'homme agit par jugement, car c'est par le pouvoir de connaître qu'il estime devoir fuirou poursuivre une chose.
Et puisqu'un tel jugement n'est pas l'effet d'un jugement naturel, mais un acte desynthèse qui procède de la raison, l'homme agit par un jugement libre qui le rend capable de diversifier son action.»Pour saint Thomas d'Aquin, le propre de l'homme est d'agir en connaissance de cause.
Nous sommes toujoursresponsables Excepté certaines réactions instinctives, comme celles que provoque la panique, l'homme peut toujoursêtre conscient de ce qu'il fait.
Pour Sartre, les hommes sont entièrement libres et responsables de leurs actes.L'individu qui prétend ne pas savoir ce qu'il fait cherche seulement à se déresponsabiliser.
Comment pourrait-on nepas savoir ce que l'on fait? une action, le "faire" ne nécessite t-il pas la pleine attention du sujet ? Une action sepense avant de s'exécuter : rien n'est tout à fait laisser au hasard : en effet le terme action de "actum" en latindésigne le fait accompli et implique un mouvement volontaire de l'être ( "actum" vient de "agere" agir, faire, en latin,le rapprochement est donc à effectuer) ; il semble donc impossible au sens d'irréalisable, à première vue, d'effectuerune action sans savoir, c'est à dire sans y porter un semblant de volonté si minime soit-il.
Le « je pense », écritKant, doit accompagner toutes mes représentations.
La conscience se définit ainsi comme la présence immédiate etconstante de soi à soi.
Descartes a souligné avec force le caractère fondateur de cette présence.
« Je pense doncje suis » (cogito ergo sum) est pour Descartes la première vérité absolument certaine.
On ne peut en effet endouter sans la prouver, car si je doute, je pense et si je pense, je suis.
C'est à partir de cette vérité première quel'on peut, dit Descartes, reconstruire toutes les autres.
Descartes fait donc de la conscience de soi comme sujetpensant le fondement inébranlable et premier de toutes les vérités possibles.
Nul dans la pensée contemporaine n'amis davantage ni plus directement en question la philosophie cartésienne de la conscience que Freud.
Lesrecherches de Freud atteignent en effet de plein fouet ce qui, pour lui, constitue un préjugé fondamental de laphilosophie depuis Descartes : la transparence du sujet à lui-même.
Freud ne cesse de le répéter : le psychisme nese réduit pas à la conscience ; la vie psychique la plus importante est inconsciente, faite de désirs refoulés quis'expriment dans nos actes manqués, nos maladresses, nos rêves ou notre corps.
Il est donc impossible de ramenertoutes nos représentations à l'unité d'un « je pense » et le cogito cartésien serait une erreur philosophique.
Jepense mais « ça » pense en moi, malgré moi.
Le terme de « ça » est de Freud lui-même : il exprime le caractèreimpersonnel de l'inconscient, ce discours qui se dit à travers moi et qui n'est pas de moi.
Document demandé:.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- j'aime presque autant douter que savoir
- La science ne vise-t-elle que la satisfaction de notre désir de savoir ?
- EMC ORAL : La transparence et le droit de savoir
- SUJET N° 7 : Le questionnement perpétuel peut-il être source de savoir ?
- Est-il donc impossible de savoir qui nous sommes ?