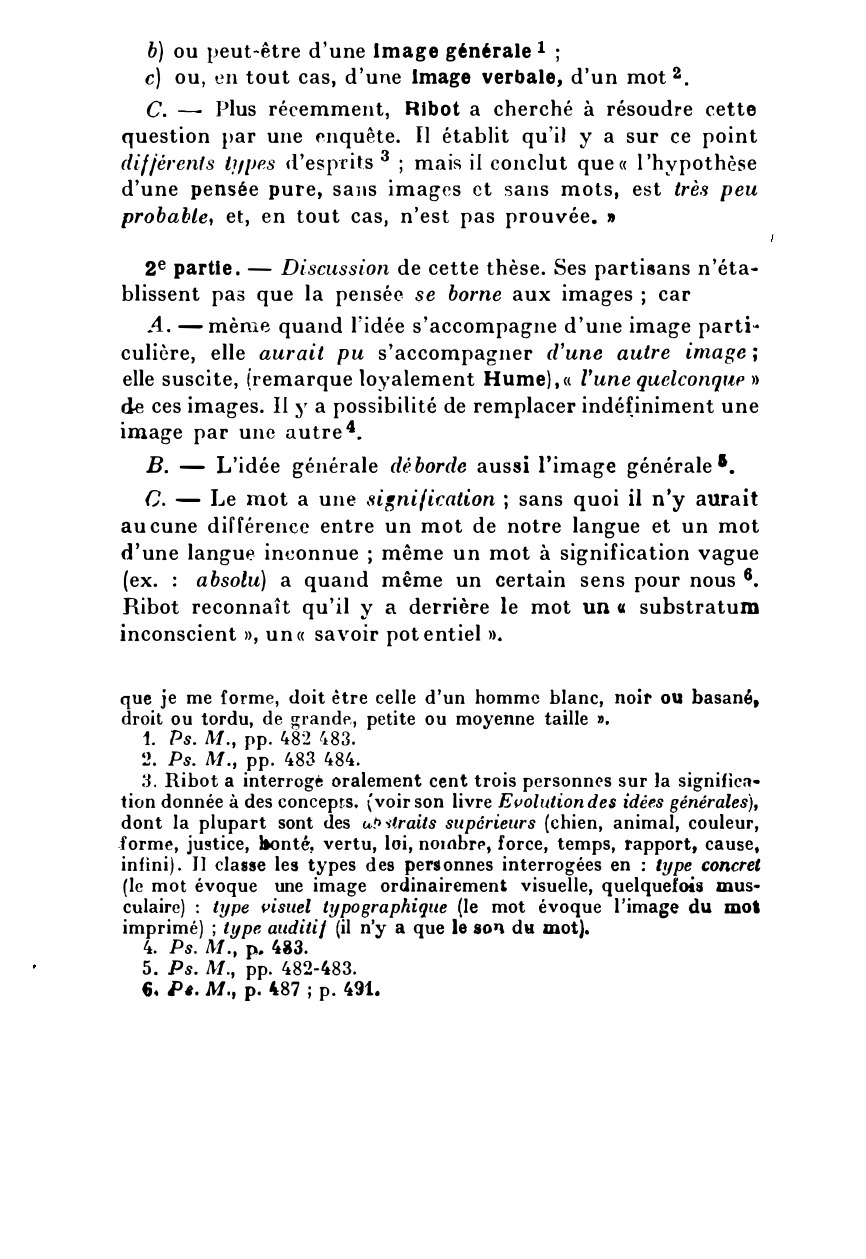Peut on penser sans images ?
Publié le 04/02/2016

Extrait du document
3e partie. — Antithèse. Il y a une pensée sans images.
A. En France, Alfred Binet le soutient. Il établit par sa méthode d’introspection expérimentale, que la pensée déborde infiniment l'image. Dans la généralisation, ce qui constitue l\" général, ce n'est pas l'image, c'est l'intention, c'est à dire la direction de la pensée.
«
b)
ou peut-être d'une Image générale 1
;
c) ou, en tout cas, d'une Image verbale, d'un mot 2.
C .
- Plus récemment, Ribot a cherché à résoudre cette
question par une "nquète.
Il établit qu'il y a sur ce point
diff érenfs llfpPs d'esprits 3 ; mais il conclut que" l'hypothèse
d'une pensée pure, salis images ct sans mots, est très peu
pro bable, et, en tout cas, n'est pas prouvée.
•
2 e part ie.
- Discussion de cette thèse.
Ses partisans n'éta
blissent pas que la pensée se borne aux images ; car
A.
-mème quand l'idée s'accompagne d'une image parti·
culière, elle aurait pu s'accompagner d'une autre image ;
elle suscite, (remarque loyalement Hume),« l'une quelcon qrœ »
de ces images.
Il y a possibilité de remplacer indéfiniment une
image par une autre 4.
B.
- L'idée générale déborde aussi l'image générale 1.
C.
- Le mot a une signif ication ; sans quoi il n'y aurait
au cune différence entre un mot de notre langue et un mot
d'u ne langue inconnue ; même un mot à signification vague
(ex.
: absolu) a quand même un certain sens pour nous 6•
Ribot reconnaît qu'il y a derrière le mot un a substratum
inconscient », un " savoir pot en ti el ».
que je me forme, doit être celle d'un homme blanc, noir ou basané,
droit ou tordu, de grande ,, petite ou moyenne taille ».
1.
Ps.
M., pp.
482 1,83.
2.
Ps.
M., pp.
483 484.
:� .
Ribot a interrogé oralement cent trois personnes sur la significa
tion donnée à des concepts.
(voir son livre Evolution des idùs générales),
dont la plupart sont des � 'traits supérieurs (chien, animal, couleur,
forme, justice, »onté, vertu, loi, nOJabre, force, temps, rapport, cause,
infini) .
II classe les types des pet 'lonnes interrogées en : type concret
(le mot évoque une image ordinairement visuelle, quelquefois mus
culaire) : type visuel typograph ique (le mot évoque l'image du mot
imprimé) ; type auditif (il n'y a que le SO'l dll mot).
4.
Ps.
M., p.
433.
5.
Ps.
M., pp.
482-483.
6.
Pa.
M., p.
487 ; p.
491..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vous illustrerez et discuterez cette opinion de René Huyghe, en vous fondant sur votre expérience personnelle des oeuvres littéraires ou artistiques : « L'oeuvre d'art n'est pas un simple miroir passif, elle joue dans notre psychologie un rôle agissant. Les images créées par l'art remplissent dans notre vie deux rôles très différents et presque opposés : tantôt elles y insinuent des manières de sentir et de penser, nous les imposent; tantôt, elles nous libèrent, au contraire, de certai
- Le pouvoir des images contrarie-t-il ma liberté de penser ?
- Peut-on penser sans images ? l'image est-elle toute l'idée ?
- Peut-on penser sans images ?
- Penser le temps