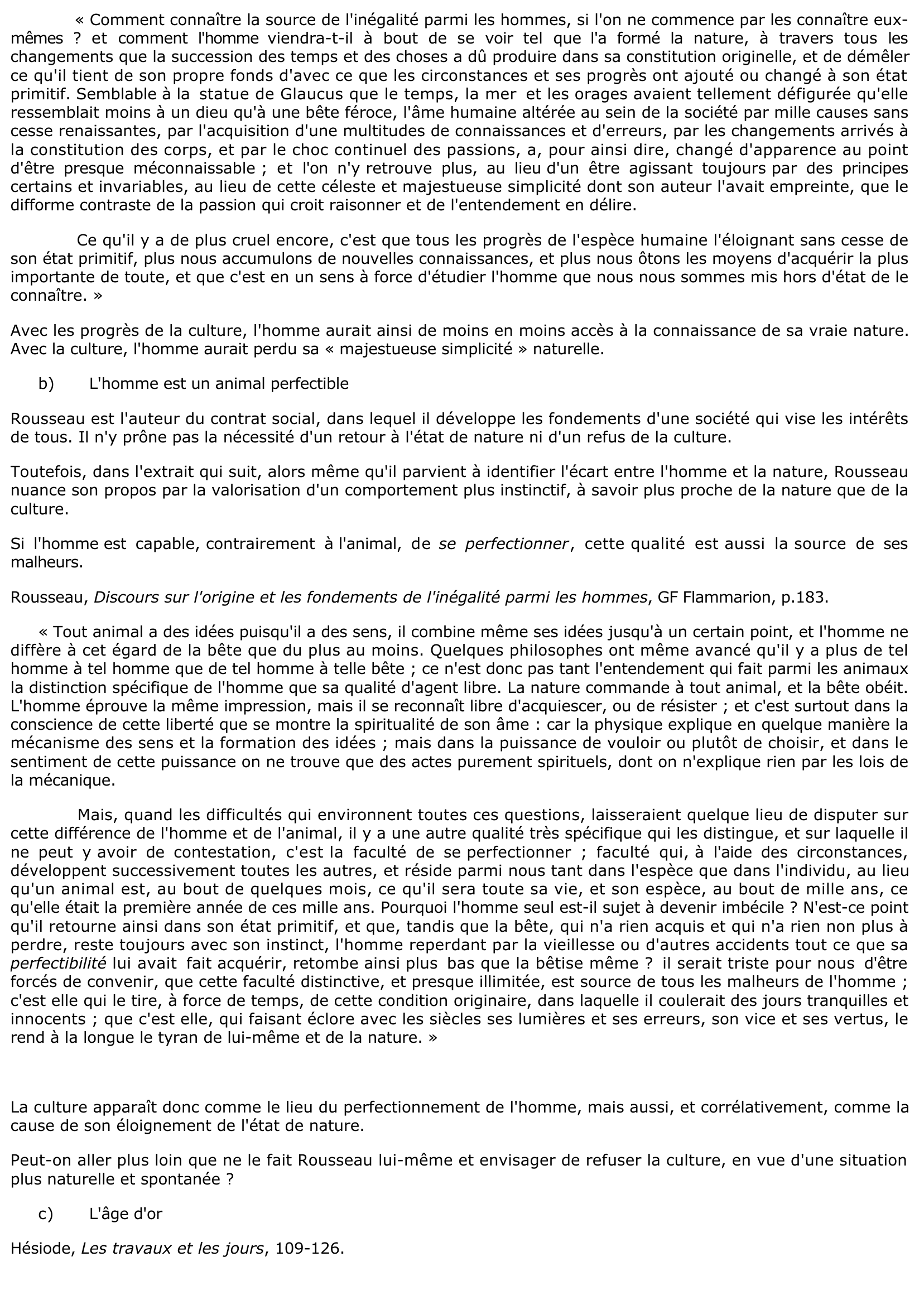Peut-on refuser la culture?
Publié le 09/04/2005

Extrait du document

Dans une première partie, on montrera quels peuvent être les motifs d’un refus global de la culture.
La seconde partie présentera une acception de la culture qui ne peut pas être refusée.
Ensuite, on donnera à la culture une définition plus restreinte qui nous confirmera qu’il ne faut sans doute pas la refuser, mais au contraire la développer.
Toutefois, en reconnaissant que tout ce qui s’appelle « culture « n’en a pas la dignité, on proposera dans une quatrième partie une nouvelle base pour interroger la possibilité de refuser la culture.

«
« Comment connaître la source de l'inégalité parmi les hommes, si l'on ne commence par les connaître eux-mêmes ? et comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous leschangements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêlerce qu'il tient de son propre fonds d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son étatprimitif.
Semblable à la statue de Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée qu'elleressemblait moins à un dieu qu'à une bête féroce, l'âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sanscesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitudes de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés àla constitution des corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d'apparence au pointd'être presque méconnaissable ; et l'on n'y retrouve plus, au lieu d'un être agissant toujours par des principescertains et invariables, au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que ledifforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement en délire.
Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans cesse deson état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous ôtons les moyens d'acquérir la plusimportante de toute, et que c'est en un sens à force d'étudier l'homme que nous nous sommes mis hors d'état de leconnaître.
»
Avec les progrès de la culture, l'homme aurait ainsi de moins en moins accès à la connaissance de sa vraie nature.Avec la culture, l'homme aurait perdu sa « majestueuse simplicité » naturelle.
b) L'homme est un animal perfectible
Rousseau est l'auteur du contrat social, dans lequel il développe les fondements d'une société qui vise les intérêtsde tous.
Il n'y prône pas la nécessité d'un retour à l'état de nature ni d'un refus de la culture.
Toutefois, dans l'extrait qui suit, alors même qu'il parvient à identifier l'écart entre l'homme et la nature, Rousseaunuance son propos par la valorisation d'un comportement plus instinctif, à savoir plus proche de la nature que de laculture.
Si l'homme est capable, contrairement à l'animal, de se perfectionner , cette qualité est aussi la source de ses malheurs.
Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes , GF Flammarion, p.183.
« Tout animal a des idées puisqu'il a des sens, il combine même ses idées jusqu'à un certain point, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins.
Quelques philosophes ont même avancé qu'il y a plus de telhomme à tel homme que de tel homme à telle bête ; ce n'est donc pas tant l'entendement qui fait parmi les animauxla distinction spécifique de l'homme que sa qualité d'agent libre.
La nature commande à tout animal, et la bête obéit.L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer, ou de résister ; et c'est surtout dans laconscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme : car la physique explique en quelque manière lamécanisme des sens et la formation des idées ; mais dans la puissance de vouloir ou plutôt de choisir, et dans lesentiment de cette puissance on ne trouve que des actes purement spirituels, dont on n'explique rien par les lois dela mécanique.
Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelque lieu de disputer surcette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle ilne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner ; faculté qui, à l'aide des circonstances,développent successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieuqu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, cequ'elle était la première année de ces mille ans.
Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N'est-ce pointqu'il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus àperdre, reste toujours avec son instinct, l'homme reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que saperfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bêtise même ? il serait triste pour nous d'être forcés de convenir, que cette faculté distinctive, et presque illimitée, est source de tous les malheurs de l'homme ;c'est elle qui le tire, à force de temps, de cette condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours tranquilles etinnocents ; que c'est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, son vice et ses vertus, lerend à la longue le tyran de lui-même et de la nature.
»
La culture apparaît donc comme le lieu du perfectionnement de l'homme, mais aussi, et corrélativement, comme lacause de son éloignement de l'état de nature.
Peut-on aller plus loin que ne le fait Rousseau lui-même et envisager de refuser la culture, en vue d'une situationplus naturelle et spontanée ?
c) L'âge d'or
Hésiode, Les travaux et les jours , 109-126..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation sur la culture - Sujet : « Dans quelle mesure peut-on dire que l’on est enfermé dans sa culture ? »
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme
- La culture éloigne-t-elle l’humain de la nature ?
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ADJOINT TECHNIQUE D'ACCUEIL, DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE
- La culture parvient-elle à contenir les tendances agressives de l'Homme ?