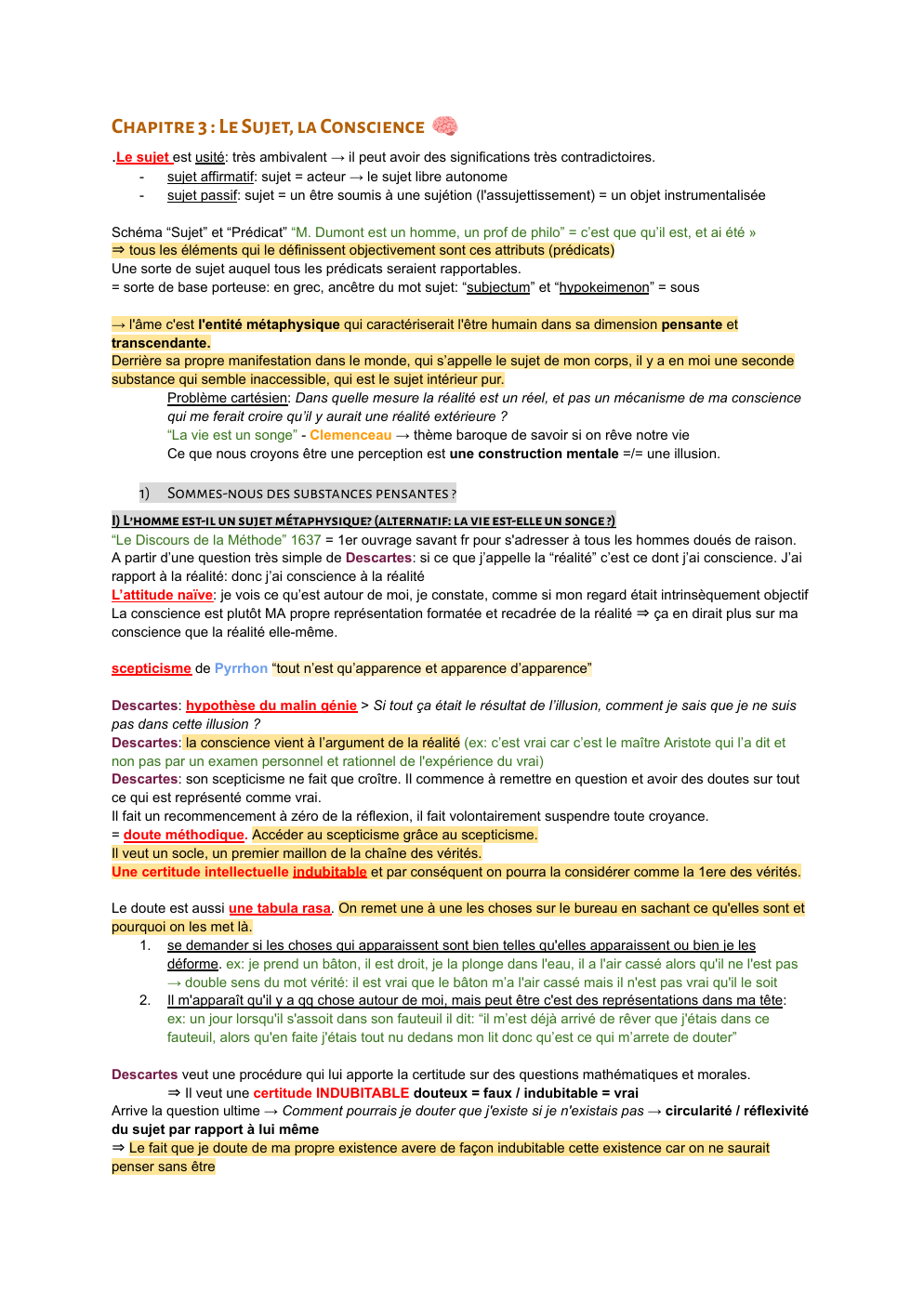Philosophie terminale: Le sujet, La conscience
Publié le 25/08/2025
Extrait du document
«
Chapitre 3 : Le Sujet, la Conscience
🧠
.Le sujet est usité: très ambivalent → il peut avoir des significations très contradictoires.
-
-
sujet affirmatif: sujet = acteur → le sujet libre autonome
sujet passif: sujet = un être soumis à une sujétion (l'assujettissement) = un objet instrumentalisée
Schéma “Sujet” et “Prédicat” “M.
Dumont est un homme, un prof de philo” = c’est que qu’il est, et ai été »
⇒ tous les éléments qui le définissent objectivement sont ces attributs (prédicats)
Une sorte de sujet auquel tous les prédicats seraient rapportables.
= sorte de base porteuse: en grec, ancêtre du mot sujet: “subjectum” et “hypokeimenon” = sous
→ l'âme c'est l'entité métaphysique qui caractériserait l'être humain dans sa dimension pensante et
transcendante.
Derrière sa propre manifestation dans le monde, qui s’appelle le sujet de mon corps, il y a en moi une seconde
substance qui semble inaccessible, qui est le sujet intérieur pur.
Problème cartésien: Dans quelle mesure la réalité est un réel, et pas un mécanisme de ma conscience
qui me ferait croire qu’il y aurait une réalité extérieure ?
“La vie est un songe” - Clemenceau → thème baroque de savoir si on rêve notre vie
Ce que nous croyons être une perception est une construction mentale =/= une illusion.
1) Sommes-nous des substances pensantes ?
I) L’homme est-il un sujet métaphysique? (alternatif: la vie est-elle un songe ?)
“Le Discours de la Méthode” 1637 = 1er ouvrage savant fr pour s'adresser à tous les hommes doués de raison.
A partir d’une question très simple de Descartes: si ce que j’appelle la “réalité” c’est ce dont j’ai conscience.
J’ai
rapport à la réalité: donc j’ai conscience à la réalité
L’attitude naïve: je vois ce qu’est autour de moi, je constate, comme si mon regard était intrinsèquement objectif
La conscience est plutôt MA propre représentation formatée et recadrée de la réalité ⇒ ça en dirait plus sur ma
conscience que la réalité elle-même.
scepticisme de Pyrrhon “tout n’est qu’apparence et apparence d’apparence”
Descartes: hypothèse du malin génie > Si tout ça était le résultat de l’illusion, comment je sais que je ne suis
pas dans cette illusion ?
Descartes: la conscience vient à l’argument de la réalité (ex: c’est vrai car c’est le maître Aristote qui l’a dit et
non pas par un examen personnel et rationnel de l'expérience du vrai)
Descartes: son scepticisme ne fait que croître.
Il commence à remettre en question et avoir des doutes sur tout
ce qui est représenté comme vrai.
Il fait un recommencement à zéro de la réflexion, il fait volontairement suspendre toute croyance.
= doute méthodique.
Accéder au scepticisme grâce au scepticisme.
Il veut un socle, un premier maillon de la chaîne des vérités.
Une certitude intellectuelle indubitable et par conséquent on pourra la considérer comme la 1ere des vérités.
Le doute est aussi une tabula rasa.
On remet une à une les choses sur le bureau en sachant ce qu'elles sont et
pourquoi on les met là.
1. se demander si les choses qui apparaissent sont bien telles qu'elles apparaissent ou bien je les
déforme.
ex: je prend un bâton, il est droit, je la plonge dans l'eau, il a l'air cassé alors qu'il ne l'est pas
→ double sens du mot vérité: il est vrai que le bâton m’a l'air cassé mais il n'est pas vrai qu'il le soit
2. Il m'apparaît qu'il y a qq chose autour de moi, mais peut être c'est des représentations dans ma tête:
ex: un jour lorsqu'il s'assoit dans son fauteuil il dit: “il m’est déjà arrivé de rêver que j'étais dans ce
fauteuil, alors qu'en faite j'étais tout nu dedans mon lit donc qu’est ce qui m’arrete de douter”
Descartes veut une procédure qui lui apporte la certitude sur des questions mathématiques et morales.
⇒ Il veut une certitude INDUBITABLE douteux = faux / indubitable = vrai
Arrive la question ultime → Comment pourrais je douter que j'existe si je n'existais pas → circularité / réflexivité
du sujet par rapport à lui même
⇒ Le fait que je doute de ma propre existence avere de façon indubitable cette existence car on ne saurait
penser sans être
À chaque fois qu'on demande si on existe, on affirme notre existence → auto affirmation réflexive
“Je pense donc je suis” - Descartes
Husserl: pour examiner la réalité, il faut remettre une fois en doute toute chose que nous retrouverons.
MANUEL p.82: Descartes “Le bon sens est la seule la chose du monde la mieux partagée”
Le bon sens = la raison, puissance de bien juger, distinguer le vrai et le faux
La capacité naturelle de juger est présente de façon absolument égale à tout homme
⇒ Pourquoi n’est-on pas tous d'accord?
= la manière dont on se sert de ce bon sens fait que nous avons des opinions différentes.
Il faut apprendre à penser, et à user de ce bon sens.
Hegel: est ce qu’il suffit d’avoir un bon sens pour être une bonne personne ? NON, il faut apprendre comment.
⇒ donc tous les hommes sont capables de philosopher
⇒ donc je suis une substance pensante = qqun qui peut faire de la réflexion
Le moi, l'âme, la substance transcendante c'est la même chose.
Est ce que Descartes a eu raison de faire de
l’homme une entité métaphysique et de distinguer la distinction non matérielle entre les corps et les âmes ? Ce
qu'il est essentiellement c'est un être pensant indépendant de toute matérialité.
Descartes à réifier (chosifier) le cogito “je pense”
Descartes se dit, il faut avoir un substratum / Substance = en soi et subsiste en soi-même
Il fait du sujet pensant, une chose, et une chose ne pense pas.
C'est une chose spirituelle donc c'est quand
même une chose.
hypostasier: transformer en substance → Descartes redevient métaphysicien
II) L'existence des corps et l'existence de Dieu
Dieu est omniscient (son entendement est infini) / omnipotent
> est ce qu’un être infiniment parfait est infiniment parfait s'il n’existe pas ?
Descartes: Dieu est un être infiniment parfait au plus haut degré inimaginable → mais ne prouve pas qu’il existe
Tout semble contingent (peut arriver ou ne pas arriver) =/= nécessité
Le cogito (je pense donc je suis) n’a pas besoin que Dieu existe, mais il s'auto affirme
Dieu peut créer à partir de rien (ex nihilo)
Descartes: un être infiniment parfait pourrait-il ne pas exister ? Descartes dit non car exister est une perfection
en soi.
Finalement ce qui permet de prouver qu’il y a le monde extérieur ⇒ véracité divine
⇒ Confiance morale à Dieu qui garantit qu'il y a un monde extérieur
> si on est en permanence dans l'illusion qu'il y a pas de monde autour de moi = Dieu a créé l’homme en sorte
qu’il se trompe tout temps
Si vrai: Dieu = être malin / trompeur qui fait exprès que l’homme se trompe
2) Comment le sujet humain détermine t - il la manière dont le choses lui apparaissent ( la
subjectivité transcendantale Kantienne )
I) La réfutation de l'idéalisme problématique cartésien par Kant
Idéalisme: doctrine philosophique qui dit que nous avons des idées
⇒ on insiste que c’est d’abord dans la représentation mentale que cela se passe
Réalisme (matérialiste): “il faut juste toucher les objets autour de soi”
Entre ces deux concepts: Kant développe l’idéalisme transcendantal = idées viennent bien de quelque part:
soit on les invente, soit comme dans les rêves, ça vient de l’extérieur
Kant ne doute pas de l’existence du monde extérieur.
Notre pensée (Kant appelle entendement) n’est pas originaire (ne créant pas à partir de lui même la matière de
ses propres pensées).
L’entendement humain est marqué par la finitude.
Descartes: lorsque l’on rêve, les matières du rêve viennent bien du réel (des expériences de la veille)
L’existence n’est pas un prédicat, contrairement à la bonté, l'omniscience, etc.
Kant: L’existence est un fait.
On doit constater l’existence à travers les canaux des 5 sens.
Notre esprit qui reçoit les alluvions de ce réel
extérieur va les élaborer pour fabriquer la perception de la réalité.
= critique de l’argument ontologique
La promotion de l'existence empirique: ce que Descartes nous dit c'est que la seule expérience que nous
faisons dans le monde réel c'est l'expérience sensible, nous n'avons pas l'intuition de Dieu.
Donc, le mode d'accès au réel de l’homme c’est ses sensations.
Kant dit que notre capacité de penser est intimement liée à une capacité de recevoir.
Qq chose de la réalité se
manifeste à nous car nous avons des organes pour le recevoir.
Ce n'est pas une apparence trompeuse, c'est un
apparaître.
Cette partie de la réalité qui apparaît, en grec, c'est le phenomenon
Derrière il y a la chose en soi.
Mais l'homme ne peut que se baser que sur ce qui apparaît
II) Sensibilité empirique et sensibilité transcendantale
(Les manières dont les hommes formate le réel)
● Sensibilité empirique: la première interface entre nous et le réel
= notre corps, et donc nos sens.
⇒ Voies d'accès, mais limité....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie_ Conscience: La conscience définit-elle l’Homme ?
- Philosophie : la conscience de notre liberté est-elle trompeuse ?
- philosophie : la conscience
- PROGRÈS DE LA CONSCIENCE DANS LA PHILOSOPHIE OCCIDENTALE (Le) de Léon Brunschvicg (résumé et analyse de l’œuvre)
- ?BOUDIEB Sarah Philosophie : dissertation Sujet : Pourquoi refuse-t-on la conscience