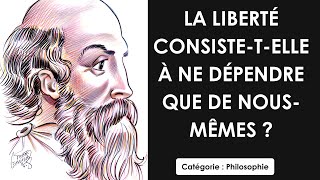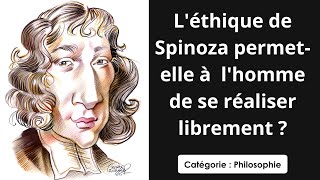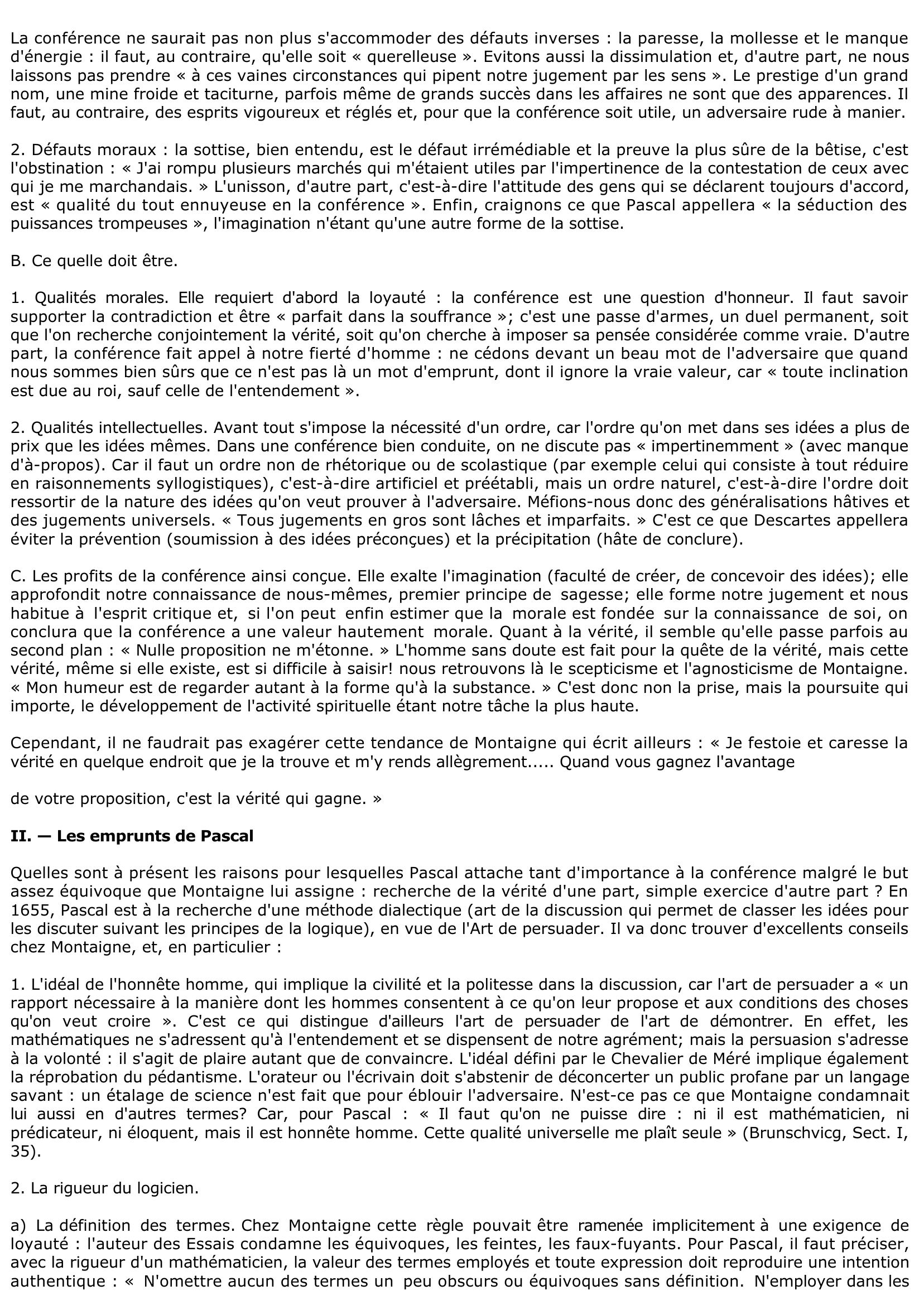Pourquoi Pascal appelle-t-il Montaigne « l'incomparable auteur de l'art de conférer ».
Publié le 22/02/2012
Extrait du document

Préparation et explication 1. Sujet délicat et qui demande qu'on soit déjà un peu familiarisé avec l'œuvre de ces deux maîtres de la pensée française, avec la subtilité de hauteur des Essais, la profondeur de celui des Pensées. Cette connaissance est indispensable pour comprendre le rapprochement qu'on nous invite à faire. Le pourquoi en effet implique la recherche des causes profondément enracinées dans l'œuvre comme dans l'homme. On peut se poser la question objectivement : « Montaigne est-il effectivement l'incomparable auteur? « et subjectivement : « Quelles raisons personnelles Pascal a-t-il de l'admirer? « L'expression dont il se sert montre la grandeur de son admiration et nous savons que Pascal ne prodigue pas les éloges. Cependant le débat est limité : il ne concerne qu'un des chapitres des Essais, et d'autre part le rapprochement entre « art de conférer « et « art de persuader « s'impose aussitôt. Rappelons que c'est de l'opuscule De l'esprit géométrique qu'est extraite la citation.

«
La conférence ne saurait pas non plus s'accommoder des défauts inverses : la paresse, la mollesse et le manqued'énergie : il faut, au contraire, qu'elle soit « querelleuse ».
Evitons aussi la dissimulation et, d'autre part, ne nouslaissons pas prendre « à ces vaines circonstances qui pipent notre jugement par les sens ».
Le prestige d'un grandnom, une mine froide et taciturne, parfois même de grands succès dans les affaires ne sont que des apparences.
Ilfaut, au contraire, des esprits vigoureux et réglés et, pour que la conférence soit utile, un adversaire rude à manier.
2.
Défauts moraux : la sottise, bien entendu, est le défaut irrémédiable et la preuve la plus sûre de la bêtise, c'estl'obstination : « J'ai rompu plusieurs marchés qui m'étaient utiles par l'impertinence de la contestation de ceux avecqui je me marchandais.
» L'unisson, d'autre part, c'est-à-dire l'attitude des gens qui se déclarent toujours d'accord,est « qualité du tout ennuyeuse en la conférence ».
Enfin, craignons ce que Pascal appellera « la séduction despuissances trompeuses », l'imagination n'étant qu'une autre forme de la sottise.
B.
Ce quelle doit être.
1.
Qualités morales.
Elle requiert d'abord la loyauté : la conférence est une question d'honneur.
Il faut savoirsupporter la contradiction et être « parfait dans la souffrance »; c'est une passe d'armes, un duel permanent, soitque l'on recherche conjointement la vérité, soit qu'on cherche à imposer sa pensée considérée comme vraie.
D'autrepart, la conférence fait appel à notre fierté d'homme : ne cédons devant un beau mot de l'adversaire que quandnous sommes bien sûrs que ce n'est pas là un mot d'emprunt, dont il ignore la vraie valeur, car « toute inclinationest due au roi, sauf celle de l'entendement ».
2.
Qualités intellectuelles.
Avant tout s'impose la nécessité d'un ordre, car l'ordre qu'on met dans ses idées a plus deprix que les idées mêmes.
Dans une conférence bien conduite, on ne discute pas « impertinemment » (avec manqued'à-propos).
Car il faut un ordre non de rhétorique ou de scolastique (par exemple celui qui consiste à tout réduireen raisonnements syllogistiques), c'est-à-dire artificiel et préétabli, mais un ordre naturel, c'est-à-dire l'ordre doitressortir de la nature des idées qu'on veut prouver à l'adversaire.
Méfions-nous donc des généralisations hâtives etdes jugements universels.
« Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits.
» C'est ce que Descartes appelleraéviter la prévention (soumission à des idées préconçues) et la précipitation (hâte de conclure).
C.
Les profits de la conférence ainsi conçue.
Elle exalte l'imagination (faculté de créer, de concevoir des idées); elleapprofondit notre connaissance de nous-mêmes, premier principe de sagesse; elle forme notre jugement et noushabitue à l'esprit critique et, si l'on peut enfin estimer que la morale est fondée sur la connaissance de soi, onconclura que la conférence a une valeur hautement morale.
Quant à la vérité, il semble qu'elle passe parfois ausecond plan : « Nulle proposition ne m'étonne.
» L'homme sans doute est fait pour la quête de la vérité, mais cettevérité, même si elle existe, est si difficile à saisir! nous retrouvons là le scepticisme et l'agnosticisme de Montaigne.« Mon humeur est de regarder autant à la forme qu'à la substance.
» C'est donc non la prise, mais la poursuite quiimporte, le développement de l'activité spirituelle étant notre tâche la plus haute.
Cependant, il ne faudrait pas exagérer cette tendance de Montaigne qui écrit ailleurs : « Je festoie et caresse lavérité en quelque endroit que je la trouve et m'y rends allègrement.....
Quand vous gagnez l'avantage
de votre proposition, c'est la vérité qui gagne.
»
II.
— Les emprunts de Pascal
Quelles sont à présent les raisons pour lesquelles Pascal attache tant d'importance à la conférence malgré le butassez équivoque que Montaigne lui assigne : recherche de la vérité d'une part, simple exercice d'autre part ? En1655, Pascal est à la recherche d'une méthode dialectique (art de la discussion qui permet de classer les idées pourles discuter suivant les principes de la logique), en vue de l'Art de persuader.
Il va donc trouver d'excellents conseilschez Montaigne, et, en particulier :
1.
L'idéal de l'honnête homme, qui implique la civilité et la politesse dans la discussion, car l'art de persuader a « unrapport nécessaire à la manière dont les hommes consentent à ce qu'on leur propose et aux conditions des chosesqu'on veut croire ».
C'est ce qui distingue d'ailleurs l'art de persuader de l'art de démontrer.
En effet, lesmathématiques ne s'adressent qu'à l'entendement et se dispensent de notre agrément; mais la persuasion s'adresseà la volonté : il s'agit de plaire autant que de convaincre.
L'idéal défini par le Chevalier de Méré implique égalementla réprobation du pédantisme.
L'orateur ou l'écrivain doit s'abstenir de déconcerter un public profane par un langagesavant : un étalage de science n'est fait que pour éblouir l'adversaire.
N'est-ce pas ce que Montaigne condamnaitlui aussi en d'autres termes? Car, pour Pascal : « Il faut qu'on ne puisse dire : ni il est mathématicien, niprédicateur, ni éloquent, mais il est honnête homme.
Cette qualité universelle me plaît seule » (Brunschvicg, Sect.
I,35).
2.
La rigueur du logicien.
a) La définition des termes.
Chez Montaigne cette règle pouvait être ramenée implicitement à une exigence deloyauté : l'auteur des Essais condamne les équivoques, les feintes, les faux-fuyants.
Pour Pascal, il faut préciser,avec la rigueur d'un mathématicien, la valeur des termes employés et toute expression doit reproduire une intentionauthentique : « N'omettre aucun des termes un peu obscurs ou équivoques sans définition.
N'employer dans les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Pascal a beaucoup utilisé les Essais de Montaigne, qui, cependant, lui était antipathique par certains côtés. Vous comparerez les deux écrivains et vous direz ce qui plaisait à l’auteur des Pensées et ce qui le choquait dans l’ouvrage de Montaigne.
- Dans une conférence donnée en 1947, et qui ne manqua pas de provoquer un beau scandale, l'écrivain polonais Gombrowicz affirmait : «... J'avoue que les vers me déplaisent et même qu'ils m'ennuient un peu. Non que je sois ignorant des choses de l'art et que la sensibilité poétique me fasse défaut. Lorsque la poésie apparaît mêlée à d'autres éléments, plus crus, plus prosaïques, comme dans les drames de Shakespeare, les livres de Dostoïevski, de Pascal, ou tout simplement dans le crépus
- philo art Pascal: “Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par l’imitation des choses dont on admire point les originaux”
- ENTRETIEN AVEC M. DE SACI SUR ÉPICTÈTE ET MONTAIGNE, 1728. Blaise Pascal
- ART DE PERSUADER (DE L’), Blaise Pascal (résumé)