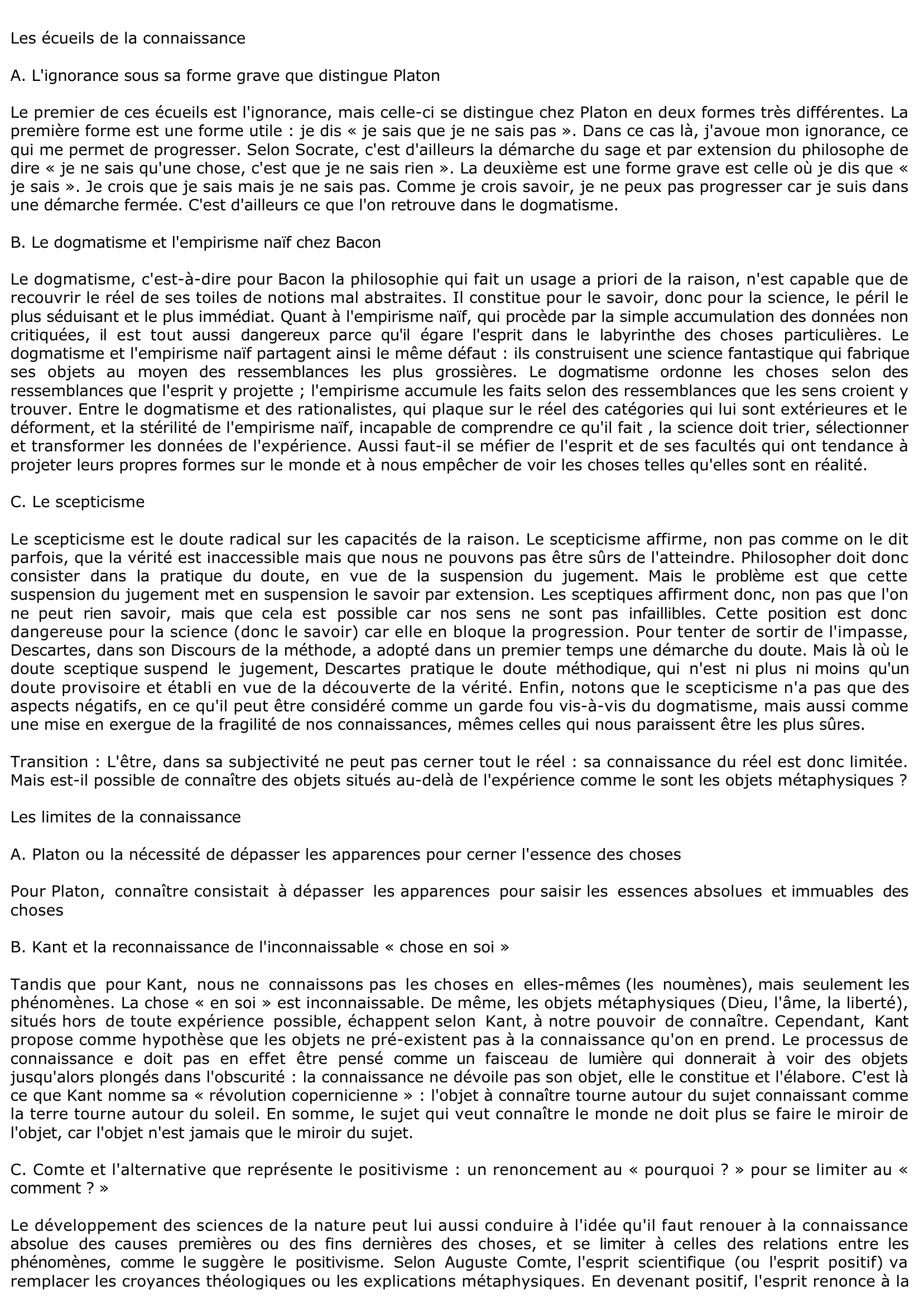Que puis je savoir ?
Publié le 01/03/2011

Extrait du document
Kant critiqua l'empirisme et apporta à la question de l'origine de la connaissance une réponse originale. Toute connaissance, affirma-t-il, débute avec l'expérience mais cela ne veut pas dire que toute connaissance dérive de l'expérience. Ou, formulé de manière moins abstraite, cette position se décline ainsi : notre connaissance des objets débute par la perception sensorielle mais toute connaissance des objets ne dérive pas de notre perception sensorielle. Dans la Critique de la raison pure, Kant souligne le fait que nous sommes en possession de connaissances a priori (c'est-à-dire indépendantes de l'expérience).
«
Les écueils de la connaissance
A.
L'ignorance sous sa forme grave que distingue Platon
Le premier de ces écueils est l'ignorance, mais celle-ci se distingue chez Platon en deux formes très différentes.
Lapremière forme est une forme utile : je dis « je sais que je ne sais pas ».
Dans ce cas là, j'avoue mon ignorance, cequi me permet de progresser.
Selon Socrate, c'est d'ailleurs la démarche du sage et par extension du philosophe dedire « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ».
La deuxième est une forme grave est celle où je dis que «je sais ».
Je crois que je sais mais je ne sais pas.
Comme je crois savoir, je ne peux pas progresser car je suis dansune démarche fermée.
C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans le dogmatisme.
B.
Le dogmatisme et l'empirisme naïf chez Bacon
Le dogmatisme, c'est-à-dire pour Bacon la philosophie qui fait un usage a priori de la raison, n'est capable que derecouvrir le réel de ses toiles de notions mal abstraites.
Il constitue pour le savoir, donc pour la science, le péril leplus séduisant et le plus immédiat.
Quant à l'empirisme naïf, qui procède par la simple accumulation des données noncritiquées, il est tout aussi dangereux parce qu'il égare l'esprit dans le labyrinthe des choses particulières.
Ledogmatisme et l'empirisme naïf partagent ainsi le même défaut : ils construisent une science fantastique qui fabriqueses objets au moyen des ressemblances les plus grossières.
Le dogmatisme ordonne les choses selon desressemblances que l'esprit y projette ; l'empirisme accumule les faits selon des ressemblances que les sens croient ytrouver.
Entre le dogmatisme et des rationalistes, qui plaque sur le réel des catégories qui lui sont extérieures et ledéforment, et la stérilité de l'empirisme naïf, incapable de comprendre ce qu'il fait , la science doit trier, sélectionneret transformer les données de l'expérience.
Aussi faut-il se méfier de l'esprit et de ses facultés qui ont tendance àprojeter leurs propres formes sur le monde et à nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont en réalité.
C.
Le scepticisme
Le scepticisme est le doute radical sur les capacités de la raison.
Le scepticisme affirme, non pas comme on le ditparfois, que la vérité est inaccessible mais que nous ne pouvons pas être sûrs de l'atteindre.
Philosopher doit doncconsister dans la pratique du doute, en vue de la suspension du jugement.
Mais le problème est que cettesuspension du jugement met en suspension le savoir par extension.
Les sceptiques affirment donc, non pas que l'onne peut rien savoir, mais que cela est possible car nos sens ne sont pas infaillibles.
Cette position est doncdangereuse pour la science (donc le savoir) car elle en bloque la progression.
Pour tenter de sortir de l'impasse,Descartes, dans son Discours de la méthode, a adopté dans un premier temps une démarche du doute.
Mais là où ledoute sceptique suspend le jugement, Descartes pratique le doute méthodique, qui n'est ni plus ni moins qu'undoute provisoire et établi en vue de la découverte de la vérité.
Enfin, notons que le scepticisme n'a pas que desaspects négatifs, en ce qu'il peut être considéré comme un garde fou vis-à-vis du dogmatisme, mais aussi commeune mise en exergue de la fragilité de nos connaissances, mêmes celles qui nous paraissent être les plus sûres.
Transition : L'être, dans sa subjectivité ne peut pas cerner tout le réel : sa connaissance du réel est donc limitée.Mais est-il possible de connaître des objets situés au-delà de l'expérience comme le sont les objets métaphysiques ?
Les limites de la connaissance
A.
Platon ou la nécessité de dépasser les apparences pour cerner l'essence des choses
Pour Platon, connaître consistait à dépasser les apparences pour saisir les essences absolues et immuables deschoses
B.
Kant et la reconnaissance de l'inconnaissable « chose en soi »
Tandis que pour Kant, nous ne connaissons pas les choses en elles-mêmes (les noumènes), mais seulement lesphénomènes.
La chose « en soi » est inconnaissable.
De même, les objets métaphysiques (Dieu, l'âme, la liberté),situés hors de toute expérience possible, échappent selon Kant, à notre pouvoir de connaître.
Cependant, Kantpropose comme hypothèse que les objets ne pré-existent pas à la connaissance qu'on en prend.
Le processus deconnaissance e doit pas en effet être pensé comme un faisceau de lumière qui donnerait à voir des objetsjusqu'alors plongés dans l'obscurité : la connaissance ne dévoile pas son objet, elle le constitue et l'élabore.
C'est làce que Kant nomme sa « révolution copernicienne » : l'objet à connaître tourne autour du sujet connaissant commela terre tourne autour du soleil.
En somme, le sujet qui veut connaître le monde ne doit plus se faire le miroir del'objet, car l'objet n'est jamais que le miroir du sujet.
C.
Comte et l'alternative que représente le positivisme : un renoncement au « pourquoi ? » pour se limiter au «comment ? »
Le développement des sciences de la nature peut lui aussi conduire à l'idée qu'il faut renouer à la connaissanceabsolue des causes premières ou des fins dernières des choses, et se limiter à celles des relations entre lesphénomènes, comme le suggère le positivisme.
Selon Auguste Comte, l'esprit scientifique (ou l'esprit positif) varemplacer les croyances théologiques ou les explications métaphysiques.
En devenant positif, l'esprit renonce à la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- j'aime presque autant douter que savoir
- La science ne vise-t-elle que la satisfaction de notre désir de savoir ?
- EMC ORAL : La transparence et le droit de savoir
- SUJET N° 7 : Le questionnement perpétuel peut-il être source de savoir ?
- Est-il donc impossible de savoir qui nous sommes ?