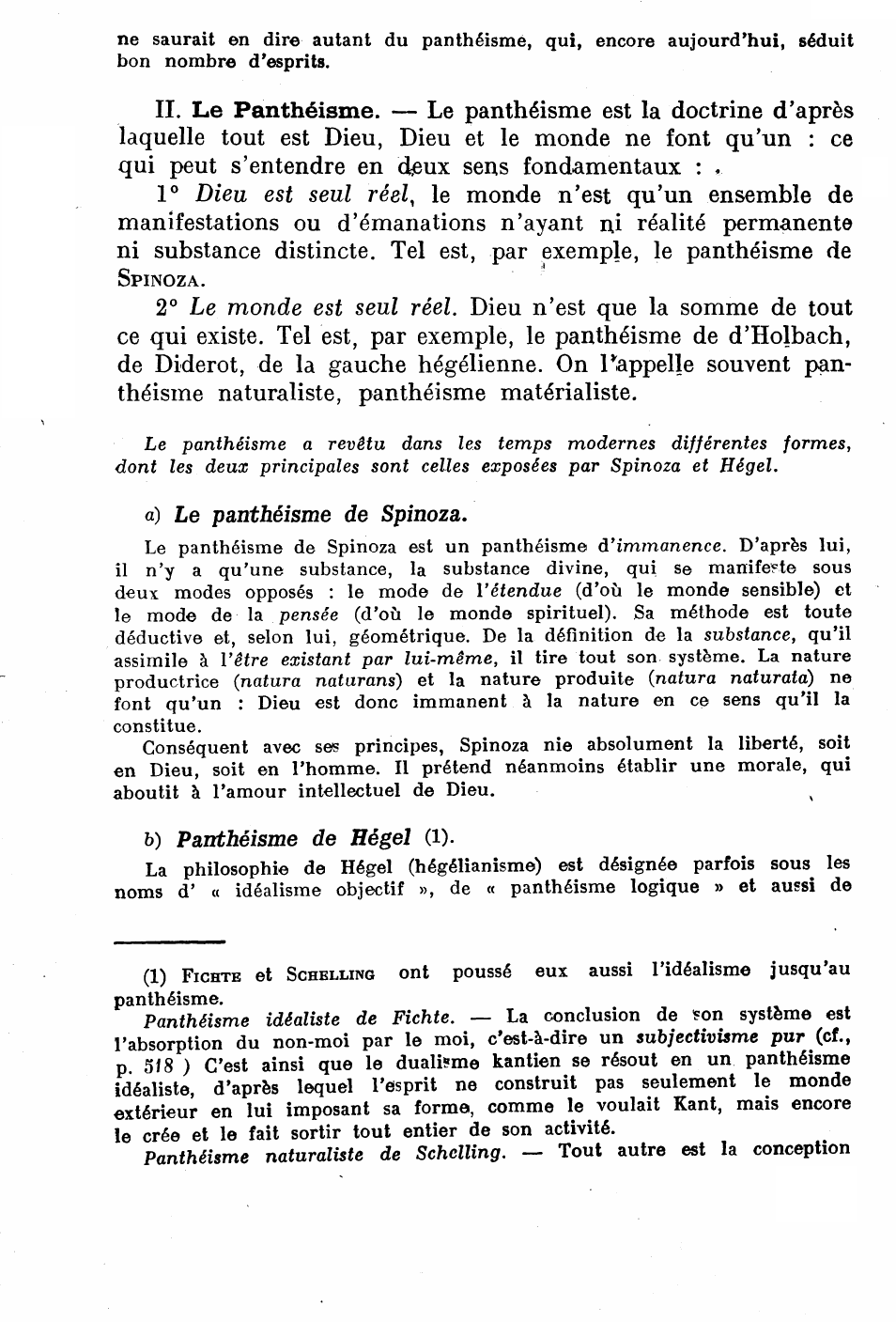RAPPORTS DE DIEU AVEC LE MONDE
Publié le 05/06/2012

Extrait du document

L'Idée s'extériorise d'abord eli nature, pour revenir sur elle-même sous forme de conscience. Mais Dieu n'est ni l'un ni l'autre de ces deux moments; il n'est ni Idée pure, ni pure Nature, il est Esprit et il est l'Esprit abmlu, c'est-à-dire qu'il est l'Idée devenue pleinement consciente de soi, la pensée se connaissant entièrement elle-même. Mais, à la différence de Spinoza, Hégel semble admettre que c'est seulement danse l'esprit humain que Dieu prend ainsi conscience de lui-même. C'est par l'art, par la religion, par la philomphie surtout, que cette oonscience se développe, et ainsi l'on peut dire que si Dieu n'est pas, à proprement parler, il se réalise chaque jour davantage dans l'humanité....

«
RAPPORTS :DE DIEU AVEC LE MONDE 577
ne saurait en dire autant du panthéisme, qui, encore aujourd'hui, séduit bon nombre d'esprits.
II.
Le Panthéisme.
-Le panthéisme est la doctrine d'après
laquelle tout est Dieu, Dieu et le monde ne font qu'un : ce
qui peut s'entendre en ®ux sens fondamentaux : .
P Dieu est seul réel, le monde n'est qu'un ensemble de
manifestations
ou d'émanations n'ayant ni réalité permanente
ni substance distincte.
Tel est, par exemple, le panthéisme de SPINOZA.
' -
2° Le monde est seul réel.
Dieu n'est que la somme de tout
ce qui existe.
Tel est, par exemple, le panthéisme de d'Holbach,
de Diderot, de la gauche hégélienne.
On 1 ~appelle souvent pan
théisme naturaliste, panthéisme matérialiste.
Le panthéisme a revêtu dans les temps modernes différentes formes, dont les deux principales sont celles exposées par Spinoza et Hégel.
a) Le panthéisme de Spinoza.
Le panthéisme de Spinoza est un panthéisme d'immanence.
D'après lui, il n'y a qu'une substance, la substance divine, qui se manife~te sous deux modes opposés : le mode de !'étendue (d'où le monde sensible) ct le mode de la pensée (d'où le monde spirituel).
Sa méthode est toute déductive et, selon lui, géométrique.
De la définition de la substance, qu'il assimile à l'être existant par lui-même, il tire tout son système.
La nature productrice (natura naturans) et la nature produite (natura naturata) ne font qu'un : Dieu est donc immanent à la nature en ce sens qu'il la constitue.
Conséquent avec ses principes, Spinoza nie absolument la liberté, soit en Dieu, soit en l'homme.
Il prétend néanmoins établir une morale, qui aboutit à l'amour intellectuel de Dieu.
b) Panthéisme de Hégel (1).
La philosophie de Hégel (hégélianisme) est désignée parfois sous les noms d' " idéalisme objectif "• de « panthéisme logique » et aussi de
(1) FICHTE et ScHELLING ont poussé eux aussi 1 'idéalisme jusqu 'au
panthéisme.
Panthéisme idéaliste de Fichte.
- La conclusion de ~on système est l'absorption du non-moi par le moi, c'est-à-dire un subjectivisme pur (cf.,
p.
518 ) C'est ainsi que le duali~me kantien se résout en un.
panthéisme idéaliste, d'après lequel l'esprit ne construit pas seulement le monde extérieur en lui imposant sa forme, comme le voulait Kant, mais encore le crée et le fait sortir tout entier de son activité.
Panthéisme naturaliste de Schelling.
- Tout autre est la conception.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Objet de la philosophie, ce qu'elle est, ce qu'elle était. Développer cette définition de la philosophie : La philosophie a pour objet l'homme moral, considéré en lui-même et dans ses rapports physiques fondamentaux avec le monde, dans la recherche de la vérité, dans ses rapports moraux avec ses semblables, et dans ses rapports religieux avec Dieu.
- Que pensez-vous de la façon dont Antoine Adam voit les rapports de la passion et de la raison au XVIIIe siècle : «Dans ce monde, oeuvre d'un Dieu infiniment sage et bon, comment les passions auraient-elles pu apparaître comme des forces mauvaises ? Comment les nouveaux moralistes auraient-ils opposé, comme ceux de l'ancienne génération, les passions à la raison ? Bien loin de les condamner, ils les proclamaient nécessaires et fécondes. Cette époque, que tant d'historiens accusent d'êtr
- DIEU ET LE MONDE de Wolfgang Gœthe (résumé et analyse)
- DIEU, AME ET MONDE (résumé et analyse)
- René Descartes (1596-1650): La méthode cartésienne Une métaphysique du doute Dieu, garant du monde physique