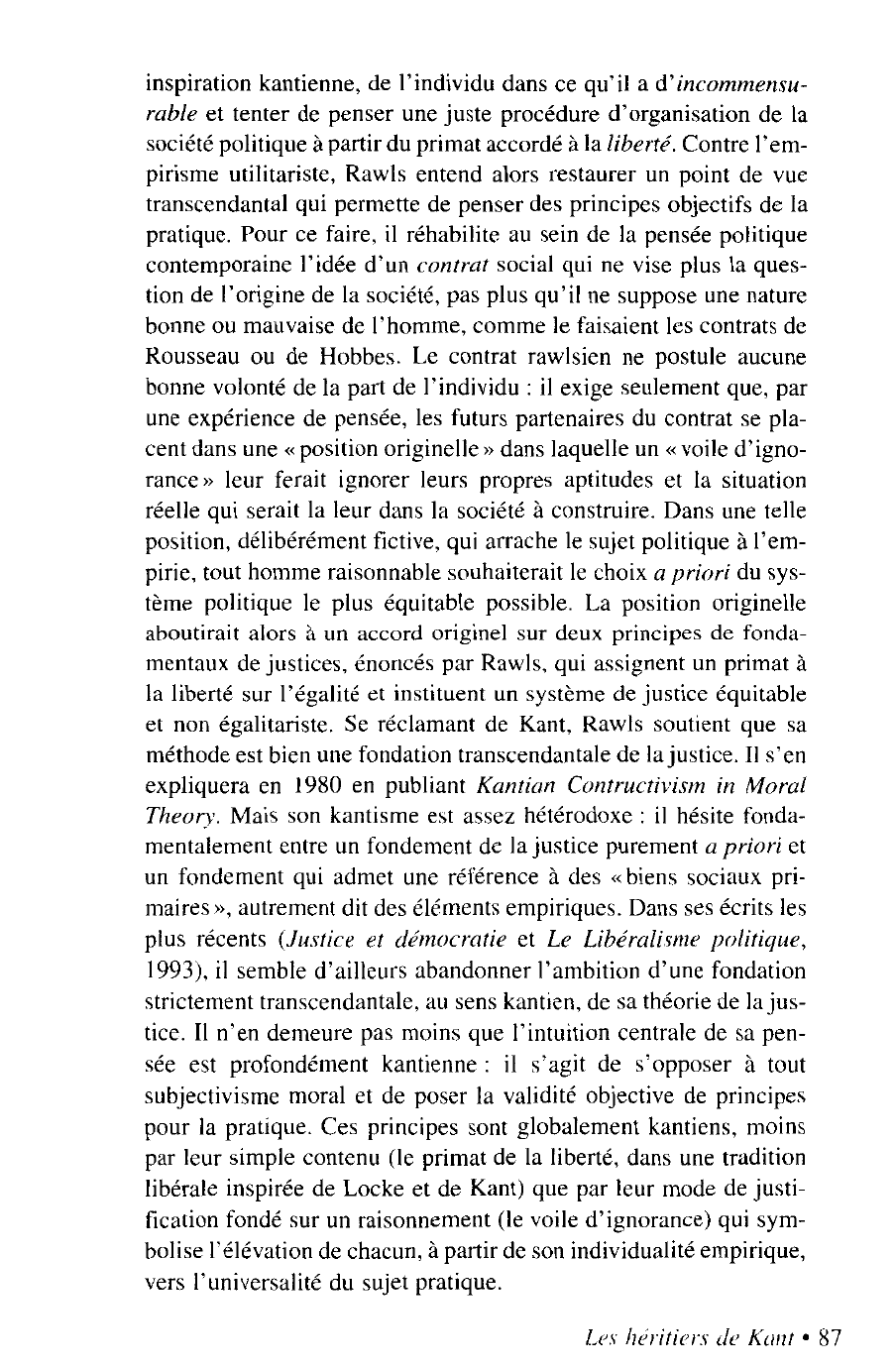RAWLS ET LE RETOUR À KANT
Publié le 25/03/2015

Extrait du document
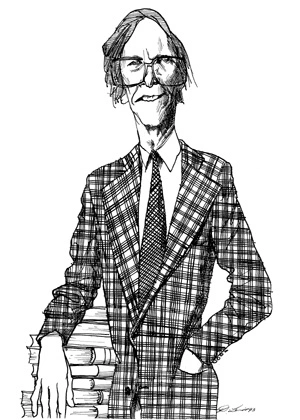
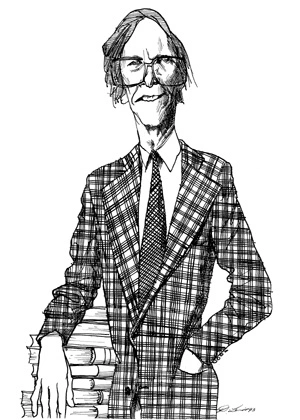
«
inspiration kantienne, de l'individu dans ce qu'il ad' incommensu
rable
et tenter de penser une juste procédure d'organisation de la
société politique à partir du primat accordé à la
liberté.
Contre l'em
pirisme utilitariste, Rawls entend alors restaurer un point de vue
transcendantal qui permette de
penser des principes objectifs de la
pratique.
Pour ce faire, il réhabilite au sein de la pensée politique
contemporaine
l'idée d'un contrat social qui ne vise plus laques
tion de l'origine de la société, pas plus qu'il ne suppose une nature
bonne ou mauvaise de l'homme, comme le faisaient les contrats de
Rousseau ou de Hobbes.
Le contrat rawlsien ne postule aucune
bonne volonté de la part de l'individu : il exige seulement que, par
une expérience de pensée, les futurs partenaires du contrat se pla
cent dans une« position originelle» dans laquelle un« voile d'igno
rance» leur ferait ignorer leurs propres aptitudes et la situation
réelle qui serait la leur dans la société à construire.
Dans une telle
position, délibérément fictive, qui arrache le sujet politique à
I'em
pirie, tout homme raisonnable souhaiterait le choix a priori du sys
tème politique le plus équitable possible.
La position originelle
aboutirait alors à un accord originel
sur deux principes de fonda
mentaux de justices, énoncés
par Rawls, qui assignent un primat à
la liberté sur l'égalité et instituent un système de justice équitable
et non égalitariste.
Se réclamant de Kant, Rawls soutient
que sa
méthode est bien une fondation transcendantale de la justice.
Il
s'en
expliquera en 1980 en publiant Kantian Contructivism in Moral
Theory.
Mais son kantisme est assez hétérodoxe : il hésite fonda
mentalement entre un fondement de la justice purement a priori et
un fondement qui
admet une référence à des «biens sociaux pri
maires», autrement dit des éléments empiriques.
Dans ses écrits les
plus récents
(Justice et démocratie et Le Libéralisme politique,
1993), il semble d'ailleurs abandonner l'ambition d'une fondation
strictement transcendantale, au sens kantien, de
sa théorie de la jus
tice.
Il n'en demeure pas moins que l'intuition centrale de sa pen
sée est
profondément kantienne: il s'agit de s'opposer à tout
subjectivisme moral et de
poser la validité objective de principes
pour la pratique.
Ces principes sont globalement kantiens, moins
par leur simple contenu (le primat de la liberté, dans une tradition
libérale inspirée de
Locke et de Kant) que par leur mode de justi
fication fondé
sur un raisonnement (le voile d'ignorance) qui sym
bolise l'élévation de chacun, à partir de son individualité empirique,
vers l'universalité du sujet pratique.
Les héritiers de Kant • 87.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Emmanuel KANT ( 1 724-1804) Théorie et pratique, chapitre II
- explication de texte Kant sur le bonheur comme idéal
- → Support : Emmanuel Kant, Fondements de la Métaphysique des Moeurs, 1785
- Kant, Réponse à la question : Qu'est-ce que les Lumières ?
- Je dus abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance Emmanuel Kant (1724-1804)