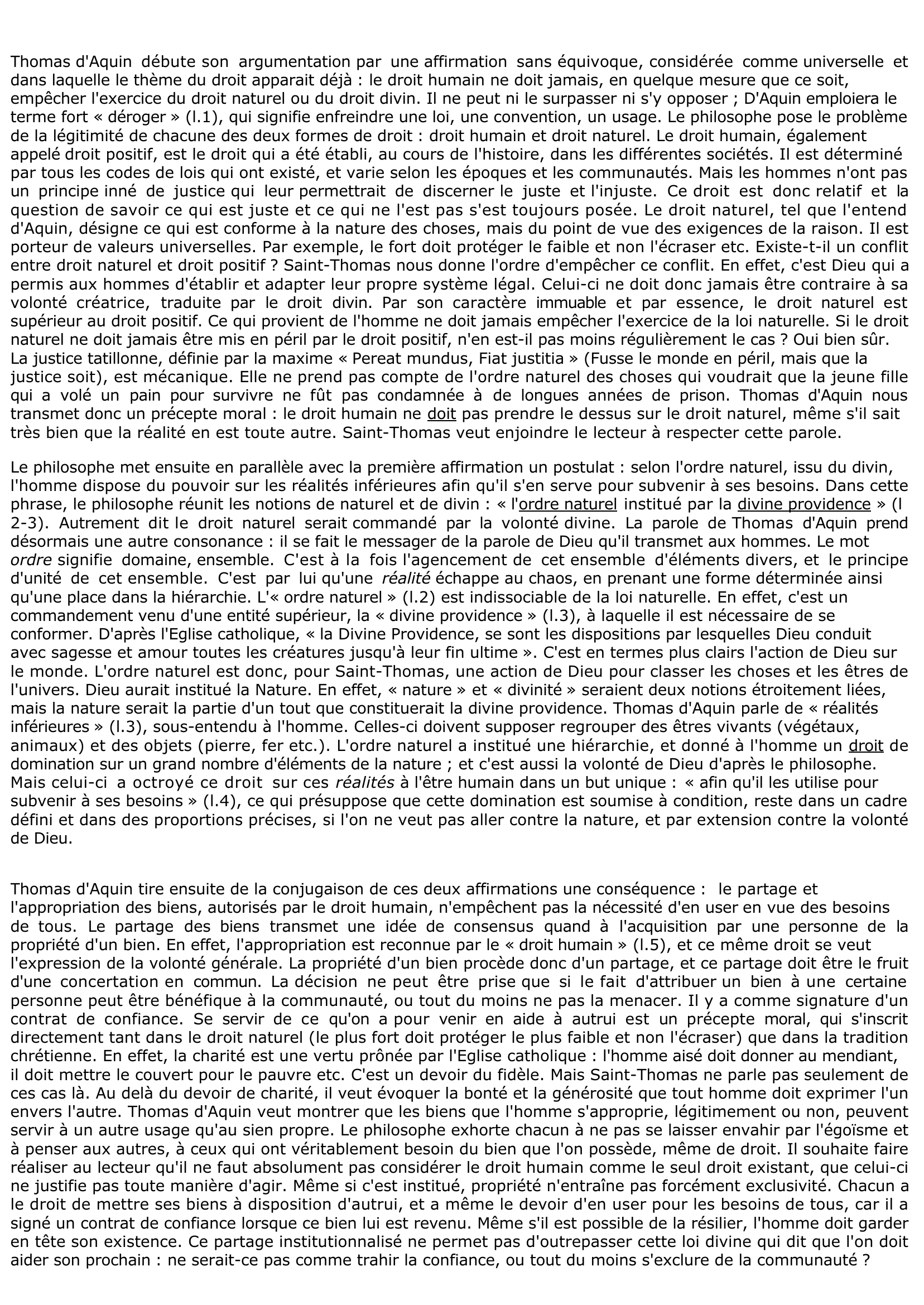Somme Théologique de Thomas d'Aquin: le droit humain et le droit divin (commentaire)
Publié le 14/05/2011

Extrait du document

La relation entre la propriété et les droits qui s'y rapportent est le thème abordé dans ce texte issu de l'ouvrage Somme théologique (IIa), écrit par Thomas d'Aquin. Dans ce texte, la philosophe nous montre que la propriété d'un bien, établie par le droit humain, ne doit pas empêcher l'exercice du droit divin, qui permet à chaque homme d'user du bien d'autrui en cas de nécessité. Le problème soulevé par ce texte est donc : la propriété d'un bien autorise-t-elle l'homme à enfreindre le droit naturel, et ainsi à ne pas respecter la volonté divine ? Dans un premier temps, Thomas d'Aquin nous présente des points généraux, essentiels à son argumentation : le droit naturel ou divin ne doit pas être remis en cause par le droit humain, et l'homme a un pouvoir de domination sur les « réalités inférieures «. Puis, le philosophe en vient au sujet qu'il veut évoquer : même si un bien est propriété d'un homme, si sa possession n'est pas nécessaire à sa vie, il a le devoir d'en user pour subvenir aux besoins du pauvre. Mais il nuance son propos en disant que chacun n'a pas la même possibilité d'aider son prochain et qu'il est impossible à un homme de venir en aide à tous. Cependant ce n'est pas parce que le but ne sera jamais totalement atteint qu'il faut abandonner. Pour nous démontrer le bien fondé de ses propos, il essaie enfin de nous sensibiliser au statut du pauvre en nous mettant dans une situation de nécessité vitale, où l'on doit prendre le bien d'un autre pour subvenir à nos propres besoins.

«
Thomas d'Aquin débute son argumentation par une affirmation sans équivoque, considérée comme universelle etdans laquelle le thème du droit apparait déjà : le droit humain ne doit jamais, en quelque mesure que ce soit,empêcher l'exercice du droit naturel ou du droit divin.
Il ne peut ni le surpasser ni s'y opposer ; D'Aquin emploiera leterme fort « déroger » (l.1), qui signifie enfreindre une loi, une convention, un usage.
Le philosophe pose le problèmede la légitimité de chacune des deux formes de droit : droit humain et droit naturel.
Le droit humain, égalementappelé droit positif, est le droit qui a été établi, au cours de l'histoire, dans les différentes sociétés.
Il est déterminépar tous les codes de lois qui ont existé, et varie selon les époques et les communautés.
Mais les hommes n'ont pasun principe inné de justice qui leur permettrait de discerner le juste et l'injuste.
Ce droit est donc relatif et laquestion de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas s'est toujours posée.
Le droit naturel, tel que l'entendd'Aquin, désigne ce qui est conforme à la nature des choses, mais du point de vue des exigences de la raison.
Il estporteur de valeurs universelles.
Par exemple, le fort doit protéger le faible et non l'écraser etc.
Existe-t-il un conflitentre droit naturel et droit positif ? Saint-Thomas nous donne l'ordre d'empêcher ce conflit.
En effet, c'est Dieu qui apermis aux hommes d'établir et adapter leur propre système légal.
Celui-ci ne doit donc jamais être contraire à savolonté créatrice, traduite par le droit divin.
Par son caractère immuable et par essence, le droit naturel estsupérieur au droit positif.
Ce qui provient de l'homme ne doit jamais empêcher l'exercice de la loi naturelle.
Si le droitnaturel ne doit jamais être mis en péril par le droit positif, n'en est-il pas moins régulièrement le cas ? Oui bien sûr.La justice tatillonne, définie par la maxime « Pereat mundus, Fiat justitia » (Fusse le monde en péril, mais que lajustice soit), est mécanique.
Elle ne prend pas compte de l'ordre naturel des choses qui voudrait que la jeune fillequi a volé un pain pour survivre ne fût pas condamnée à de longues années de prison.
Thomas d'Aquin noustransmet donc un précepte moral : le droit humain ne doit pas prendre le dessus sur le droit naturel, même s'il sait très bien que la réalité en est toute autre.
Saint-Thomas veut enjoindre le lecteur à respecter cette parole.
Le philosophe met ensuite en parallèle avec la première affirmation un postulat : selon l'ordre naturel, issu du divin,l'homme dispose du pouvoir sur les réalités inférieures afin qu'il s'en serve pour subvenir à ses besoins.
Dans cettephrase, le philosophe réunit les notions de naturel et de divin : « l' ordre naturel institué par la divine providence » (l 2-3).
Autrement dit le droit naturel serait commandé par la volonté divine.
La parole de Thomas d'Aquin prenddésormais une autre consonance : il se fait le messager de la parole de Dieu qu'il transmet aux hommes.
Le motordre signifie domaine, ensemble.
C'est à la fois l'agencement de cet ensemble d'éléments divers, et le principe d'unité de cet ensemble.
C'est par lui qu'une réalité échappe au chaos, en prenant une forme déterminée ainsi qu'une place dans la hiérarchie.
L'« ordre naturel » (l.2) est indissociable de la loi naturelle.
En effet, c'est uncommandement venu d'une entité supérieur, la « divine providence » (l.3), à laquelle il est nécessaire de seconformer.
D'après l'Eglise catholique, « la Divine Providence, se sont les dispositions par lesquelles Dieu conduitavec sagesse et amour toutes les créatures jusqu'à leur fin ultime ».
C'est en termes plus clairs l'action de Dieu surle monde.
L'ordre naturel est donc, pour Saint-Thomas, une action de Dieu pour classer les choses et les êtres del'univers.
Dieu aurait institué la Nature.
En effet, « nature » et « divinité » seraient deux notions étroitement liées,mais la nature serait la partie d'un tout que constituerait la divine providence.
Thomas d'Aquin parle de « réalitésinférieures » (l.3), sous-entendu à l'homme.
Celles-ci doivent supposer regrouper des êtres vivants (végétaux,animaux) et des objets (pierre, fer etc.).
L'ordre naturel a institué une hiérarchie, et donné à l'homme un droit de domination sur un grand nombre d'éléments de la nature ; et c'est aussi la volonté de Dieu d'après le philosophe.Mais celui-ci a octroyé ce droit sur ces réalités à l'être humain dans un but unique : « afin qu'il les utilise pour subvenir à ses besoins » (l.4), ce qui présuppose que cette domination est soumise à condition, reste dans un cadredéfini et dans des proportions précises, si l'on ne veut pas aller contre la nature, et par extension contre la volontéde Dieu.
Thomas d'Aquin tire ensuite de la conjugaison de ces deux affirmations une conséquence : le partage etl'appropriation des biens, autorisés par le droit humain, n'empêchent pas la nécessité d'en user en vue des besoinsde tous.
Le partage des biens transmet une idée de consensus quand à l'acquisition par une personne de lapropriété d'un bien.
En effet, l'appropriation est reconnue par le « droit humain » (l.5), et ce même droit se veutl'expression de la volonté générale.
La propriété d'un bien procède donc d'un partage, et ce partage doit être le fruitd'une concertation en commun.
La décision ne peut être prise que si le fait d'attribuer un bien à une certainepersonne peut être bénéfique à la communauté, ou tout du moins ne pas la menacer.
Il y a comme signature d'uncontrat de confiance.
Se servir de ce qu'on a pour venir en aide à autrui est un précepte moral, qui s'inscritdirectement tant dans le droit naturel (le plus fort doit protéger le plus faible et non l'écraser) que dans la traditionchrétienne.
En effet, la charité est une vertu prônée par l'Eglise catholique : l'homme aisé doit donner au mendiant,il doit mettre le couvert pour le pauvre etc.
C'est un devoir du fidèle.
Mais Saint-Thomas ne parle pas seulement deces cas là.
Au delà du devoir de charité, il veut évoquer la bonté et la générosité que tout homme doit exprimer l'unenvers l'autre.
Thomas d'Aquin veut montrer que les biens que l'homme s'approprie, légitimement ou non, peuventservir à un autre usage qu'au sien propre.
Le philosophe exhorte chacun à ne pas se laisser envahir par l'égoïsme età penser aux autres, à ceux qui ont véritablement besoin du bien que l'on possède, même de droit.
Il souhaite faireréaliser au lecteur qu'il ne faut absolument pas considérer le droit humain comme le seul droit existant, que celui-cine justifie pas toute manière d'agir.
Même si c'est institué, propriété n'entraîne pas forcément exclusivité.
Chacun ale droit de mettre ses biens à disposition d'autrui, et a même le devoir d'en user pour les besoins de tous, car il asigné un contrat de confiance lorsque ce bien lui est revenu.
Même s'il est possible de la résilier, l'homme doit garderen tête son existence.
Ce partage institutionnalisé ne permet pas d'outrepasser cette loi divine qui dit que l'on doitaider son prochain : ne serait-ce pas comme trahir la confiance, ou tout du moins s'exclure de la communauté ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SOMME THÉOLOGIQUE, Thomas d’Aquin (saint) (résumé & analyse)
- SOMME THÉOLOGIQUE de Thomas d’Aquin (Résumé et analyse)
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique
- Thomas d’Aquin, Somme théologique - l’usure
- Explication de texte: Thomas d’Aquin, Somme théologique