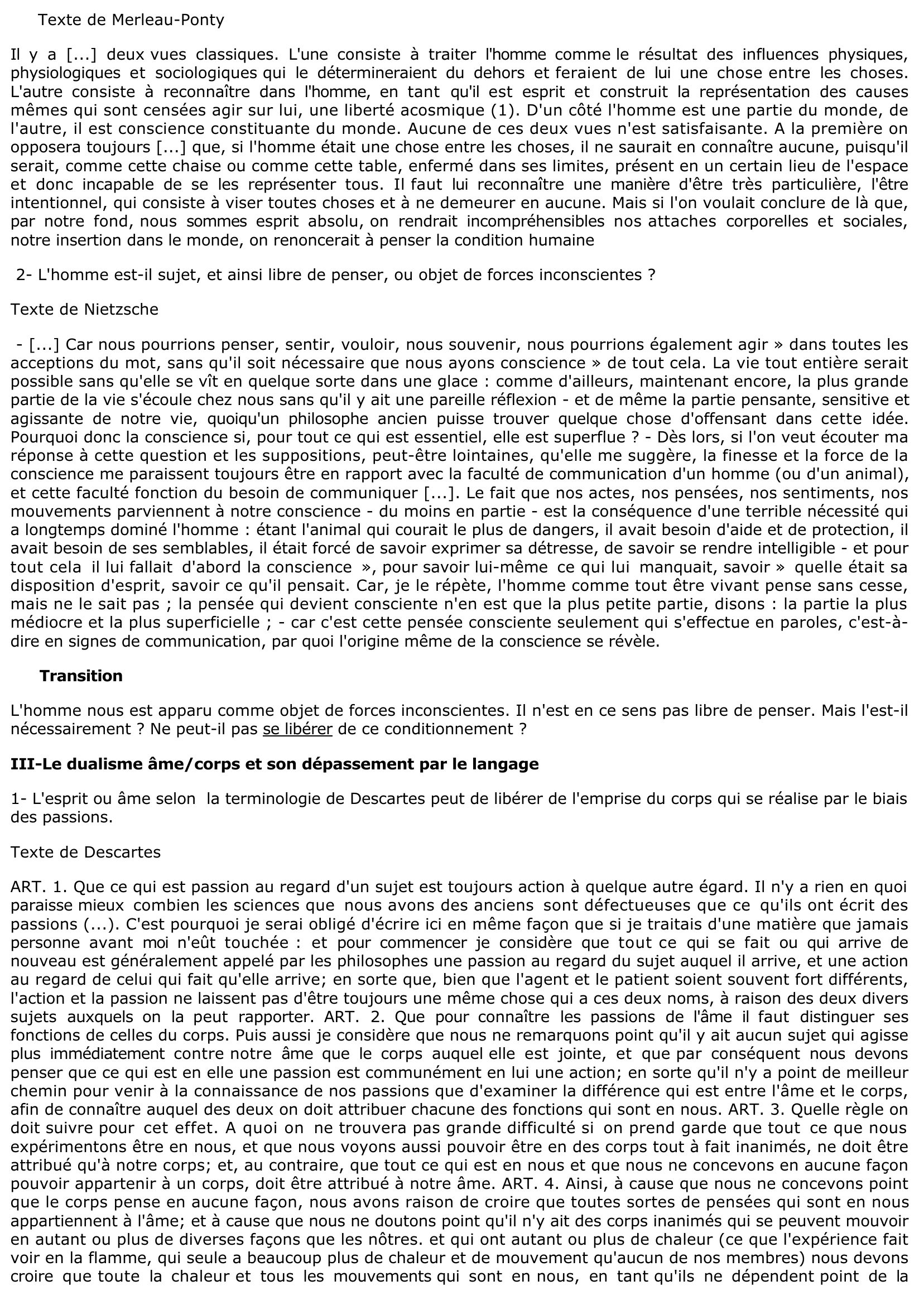Sommes-nous libres de penser ?
Publié le 27/02/2005

Extrait du document
Etre libre de faire quelque chose signifie ne pas en être empêcher par une quelconque contrainte. Le concept clef que l’on rencontre dans la question de savoir si nous sommes libres de penser est celui de penser. On peut définir l’acte de penser comme celui de former des idées dans son esprit. Penser semble être ce qu’il y a de plus familier à l’homme, être qui est doué de cette capacité. Etre cependant, on peut se demander si nous, hommes, sommes libres de penser, c'est-à-dire si nous ne rencontrons pas d’obstacles nous contraignant à ne pas pouvoir former d’idées dans notre esprit. En effet, l’être humain est cet être hybride qui est à la fois un esprit et un corps, esprit et corps qui sont toujours en mutuelle interaction. Or, notre corps et les corps extérieurs peuvent nous empêcher de penser. Comment ? Pourquoi ? Il va s’agir de mesurer les capacités de notre esprit à pouvoir agir de manière autonome.
«
Texte de Merleau-Ponty
Il y a [...] deux vues classiques.
L'une consiste à traiter l'homme comme le résultat des influences physiques,physiologiques et sociologiques qui le détermineraient du dehors et feraient de lui une chose entre les choses.L'autre consiste à reconnaître dans l'homme, en tant qu'il est esprit et construit la représentation des causesmêmes qui sont censées agir sur lui, une liberté acosmique (1).
D'un côté l'homme est une partie du monde, del'autre, il est conscience constituante du monde.
Aucune de ces deux vues n'est satisfaisante.
A la première onopposera toujours [...] que, si l'homme était une chose entre les choses, il ne saurait en connaître aucune, puisqu'ilserait, comme cette chaise ou comme cette table, enfermé dans ses limites, présent en un certain lieu de l'espaceet donc incapable de se les représenter tous.
Il faut lui reconnaître une manière d'être très particulière, l'êtreintentionnel, qui consiste à viser toutes choses et à ne demeurer en aucune.
Mais si l'on voulait conclure de là que,par notre fond, nous sommes esprit absolu, on rendrait incompréhensibles nos attaches corporelles et sociales,notre insertion dans le monde, on renoncerait à penser la condition humaine
2- L'homme est-il sujet, et ainsi libre de penser, ou objet de forces inconscientes ?
Texte de Nietzsche
- [...] Car nous pourrions penser, sentir, vouloir, nous souvenir, nous pourrions également agir » dans toutes lesacceptions du mot, sans qu'il soit nécessaire que nous ayons conscience » de tout cela.
La vie tout entière seraitpossible sans qu'elle se vît en quelque sorte dans une glace : comme d'ailleurs, maintenant encore, la plus grandepartie de la vie s'écoule chez nous sans qu'il y ait une pareille réflexion - et de même la partie pensante, sensitive etagissante de notre vie, quoiqu'un philosophe ancien puisse trouver quelque chose d'offensant dans cette idée.Pourquoi donc la conscience si, pour tout ce qui est essentiel, elle est superflue ? - Dès lors, si l'on veut écouter maréponse à cette question et les suppositions, peut-être lointaines, qu'elle me suggère, la finesse et la force de laconscience me paraissent toujours être en rapport avec la faculté de communication d'un homme (ou d'un animal),et cette faculté fonction du besoin de communiquer [...].
Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nosmouvements parviennent à notre conscience - du moins en partie - est la conséquence d'une terrible nécessité quia longtemps dominé l'homme : étant l'animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d'aide et de protection, ilavait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible - et pourtout cela il lui fallait d'abord la conscience », pour savoir lui-même ce qui lui manquait, savoir » quelle était sadisposition d'esprit, savoir ce qu'il pensait.
Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse,mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plusmédiocre et la plus superficielle ; - car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication, par quoi l'origine même de la conscience se révèle.
Transition
L'homme nous est apparu comme objet de forces inconscientes.
Il n'est en ce sens pas libre de penser.
Mais l'est-ilnécessairement ? Ne peut-il pas se libérer de ce conditionnement ?
III-Le dualisme âme/corps et son dépassement par le langage
1- L'esprit ou âme selon la terminologie de Descartes peut de libérer de l'emprise du corps qui se réalise par le biaisdes passions.
Texte de Descartes
ART.
1.
Que ce qui est passion au regard d'un sujet est toujours action à quelque autre égard.
Il n'y a rien en quoiparaisse mieux combien les sciences que nous avons des anciens sont défectueuses que ce qu'ils ont écrit despassions (...).
C'est pourquoi je serai obligé d'écrire ici en même façon que si je traitais d'une matière que jamaispersonne avant moi n'eût touchée : et pour commencer je considère que tout ce qui se fait ou qui arrive denouveau est généralement appelé par les philosophes une passion au regard du sujet auquel il arrive, et une actionau regard de celui qui fait qu'elle arrive; en sorte que, bien que l'agent et le patient soient souvent fort différents,l'action et la passion ne laissent pas d'être toujours une même chose qui a ces deux noms, à raison des deux diverssujets auxquels on la peut rapporter.
ART.
2.
Que pour connaître les passions de l'âme il faut distinguer sesfonctions de celles du corps.
Puis aussi je considère que nous ne remarquons point qu'il y ait aucun sujet qui agisseplus immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que par conséquent nous devonspenser que ce qui est en elle une passion est communément en lui une action; en sorte qu'il n'y a point de meilleurchemin pour venir à la connaissance de nos passions que d'examiner la différence qui est entre l'âme et le corps,afin de connaître auquel des deux on doit attribuer chacune des fonctions qui sont en nous.
ART.
3.
Quelle règle ondoit suivre pour cet effet.
A quoi on ne trouvera pas grande difficulté si on prend garde que tout ce que nousexpérimentons être en nous, et que nous voyons aussi pouvoir être en des corps tout à fait inanimés, ne doit êtreattribué qu'à notre corps; et, au contraire, que tout ce qui est en nous et que nous ne concevons en aucune façonpouvoir appartenir à un corps, doit être attribué à notre âme.
ART.
4.
Ainsi, à cause que nous ne concevons pointque le corps pense en aucune façon, nous avons raison de croire que toutes sortes de pensées qui sont en nousappartiennent à l'âme; et à cause que nous ne doutons point qu'il n'y ait des corps inanimés qui se peuvent mouvoiren autant ou plus de diverses façons que les nôtres.
et qui ont autant ou plus de chaleur (ce que l'expérience faitvoir en la flamme, qui seule a beaucoup plus de chaleur et de mouvement qu'aucun de nos membres) nous devonscroire que toute la chaleur et tous les mouvements qui sont en nous, en tant qu'ils ne dépendent point de la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Socrate - La rhétorique qui s'adresse au peuple d'Athènes et à celui des autres cités, c'est-à-dire des assemblées d'hommes libres, qu'en devons-nous penser ?
- Si notre liberté de penser dépend des conditions extérieures, dans quelles mesures pouvons nous encore dire que nous sommes libres ?
- Penser par nous-mêmes est-il suffisant pour faire de nous des êtres humains libres ?
- Penser le temps
- En quoi peut on dire que Gargantua de Rabelais prête autant a rire qu’il donne à penser ?