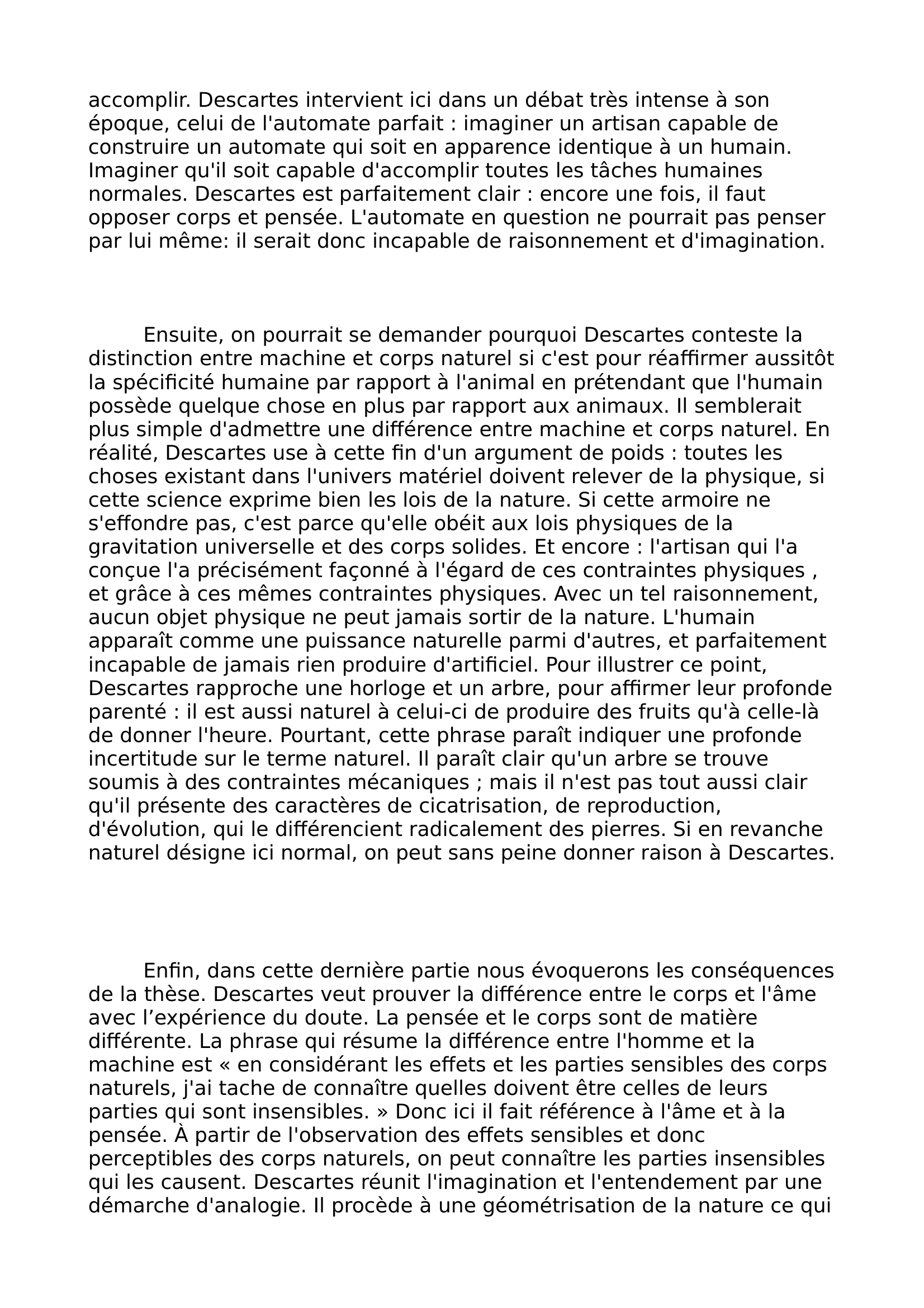Sujet texte Descartes
Publié le 11/12/2016

Extrait du document
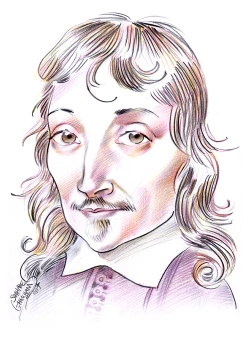
Bendjeddou Lamia TS2 Philosophie : Sujet texte Descartes montre dans cet extrait une comparaison entre les machines créées par l'industrie humaine et les corps faits par la nature. Il nie qu'il existe une très grande différence entre les machines construites par les artisans et les corps générés par la nature. On oppose de manière générale les objets naturels comme les êtres vivants et les produits tirés du travail humain. Les objets naturels se conçoivent par eux-mêmes et les produits tirés du travail humain sont fabriqués par une cause humaine. L'opposition entre nature et machine paraît évidente : les objets naturels atteignent une perfection supérieure à tout ce que l'industrie humaine a su produire. D'où le problème: Comment expliquer que l'on ait fait une différence entre les machines et les êtres vivants ? A mettre en question cette opposition, Descartes nie la différence entre le naturel et l'artificiel, entre le vivant et l'inerte, entre production mécanique et progrès organique. Il y quatre phrases dans ce texte que nous allons séparé en trois parties . Tout d'abord, Descartes présente son affirmation principale selon laquelle la seule différence entre machines et corps consiste en une question d'échelle. Ensuite, il justifie cette affirmation par le recours aux sciences physiques et il illustre cela par l'exemple de l&a...
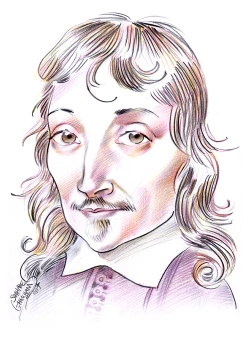
«
accomplir.
Descartes intervient ici dans un débat très intense à son
époque, celui de l'automate parfait : imaginer un artisan capable de
construire un automate qui soit en apparence identique à un humain.
Imaginer qu'il soit capable d'accomplir toutes les tâches humaines
normales.
Descartes est parfaitement clair : encore une fois, il faut
opposer corps et pensée.
L'automate en question ne pourrait pas penser
par lui même: il serait donc incapable de raisonnement et d'imagination.
Ensuite, on pourrait se demander pourquoi Descartes conteste la
distinction entre machine et corps naturel si c'est pour réaffirmer aussitôt
la spécificité humaine par rapport à l'animal en prétendant que l'humain
possède quelque chose en plus par rapport aux animaux.
Il semblerait
plus simple d'admettre une différence entre machine et corps naturel.
En
réalité, Descartes use à cette fin d'un argument de poids : toutes les
choses existant dans l'univers matériel doivent relever de la physique, si
cette science exprime bien les lois de la nature.
Si cette armoire ne
s'effondre pas, c'est parce qu'elle obéit aux lois physiques de la
gravitation universelle et des corps solides.
Et encore : l'artisan qui l'a
conçue l'a précisément façonné à l'égard de ces contraintes physiques ,
et grâce à ces mêmes contraintes physiques.
Avec un tel raisonnement,
aucun objet physique ne peut jamais sortir de la nature.
L'humain
apparaît comme une puissance naturelle parmi d'autres, et parfaitement
incapable de jamais rien produire d'artificiel.
Pour illustrer ce point,
Descartes rapproche une horloge et un arbre, pour affirmer leur profonde
parenté : il est aussi naturel à celui-ci de produire des fruits qu'à celle-là
de donner l'heure.
Pourtant, cette phrase paraît indiquer une profonde
incertitude sur le terme naturel.
Il paraît clair qu'un arbre se trouve
soumis à des contraintes mécaniques ; mais il n'est pas tout aussi clair
qu'il présente des caractères de cicatrisation, de reproduction,
d'évolution, qui le différencient radicalement des pierres.
Si en revanche
naturel désigne ici normal, on peut sans peine donner raison à Descartes.
Enfin, dans cette dernière partie nous évoquerons les conséquences
de la thèse.
Descartes veut prouver la différence entre le corps et l'âme
avec l’expérience du doute.
La pensée et le corps sont de matière
différente.
La phrase qui résume la différence entre l'homme et la
machine est « en considérant les effets et les parties sensibles des corps
naturels, j'ai tache de connaître quelles doivent être celles de leurs
parties qui sont insensibles.
» Donc ici il fait référence à l'âme et à la
pensée.
À partir de l'observation des effets sensibles et donc
perceptibles des corps naturels, on peut connaître les parties insensibles
qui les causent.
Descartes réunit l'imagination et l'entendement par une
démarche d'analogie.
Il procède à une géométrisation de la nature ce qui.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse de texte première méditation Descartes
- Explication de texte Descartes lettre à Chanut 6 juin 1647
- René DESCARTES, Principes de la philosophie (1644) Introduction / Problématisation Dans ce texte, Descartes s’attaque à un problème classique : pourquoi nous trompons-nous ?
- Explication texte Cogito Descartes
- Commentaire de texte : Extrait « Principes de la Philosophie » RENE DESCARTES